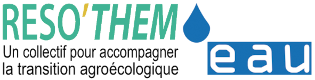"Forum Eau'riginal" au Pays des lacs (Montmorot - Jura)
Nom de la structure
EPL Lons Le Saunier- Montmorot
Téléphone
03 84 87 20 00
Contact (courriel)
armelle.lepine@educagri.fr
Contact2 (courriel)
marie.boyer@educagri.fr
Site Web
http://www.montmorot.educagri.fr/
Code postal
39570
Ville
Montmorot
Département
Jura
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- milieu naturel
Contexte
Un diagnostic environnemental et une enquête sociologique ont été réalisés en 2015 par 27 étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature (promotion 2014-2016) sur le bassin du Buronnet : à la restitution de ce travail, le constat d’une méconnaissance de la population locale sur la gestion de la ressource en eau sur son territoire est fait.
L'idée d’organiser un évènement sur le territoire du contrat de rivière pour aller plus loin est née. Dans quelle mesure un premier évènement à destination du grand public peut-il contribuer à sensibiliser et impliquer la population locale de la communauté de communes du Pays des lacs, sur la gestion collective de la ressource en eau et des milieux aquatiques, patrimoine commun ?
Le cadrage spatio-temporel du projet est proposé par les enseignantes au CD 39.
Les étudiants, encadrés par deux enseignantes (Marie Boyer - Module M54 Education à l’Environnement et Module M56 Valorisation et outils d’interprétation - et Armelle Lépine - Module M55 Gestion de Projet) ont proposé le 18 mars 2016 une journée de forum à la salle des fêtes de Clairveaux-les-lacs (position centrale au niveau de la communauté de communes, sur le territoire du contrat de rivière Ain amont)
Un diagnostic environnemental et une enquête sociologique ont été réalisés en 2015 par 27 étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature (promotion 2014-2016) sur le bassin du Buronnet : à la restitution de ce travail, le constat d’une méconnaissance de la population locale sur la gestion de la ressource en eau sur son territoire est fait.
L'idée d’organiser un évènement sur le territoire du contrat de rivière pour aller plus loin est née. Dans quelle mesure un premier évènement à destination du grand public peut-il contribuer à sensibiliser et impliquer la population locale de la communauté de communes du Pays des lacs, sur la gestion collective de la ressource en eau et des milieux aquatiques, patrimoine commun ?
Le cadrage spatio-temporel du projet est proposé par les enseignantes au CD 39.
Les étudiants, encadrés par deux enseignantes (Marie Boyer - Module M54 Education à l’Environnement et Module M56 Valorisation et outils d’interprétation - et Armelle Lépine - Module M55 Gestion de Projet) ont proposé le 18 mars 2016 une journée de forum à la salle des fêtes de Clairveaux-les-lacs (position centrale au niveau de la communauté de communes, sur le territoire du contrat de rivière Ain amont)
Objectif
Pour le territoire :
- Informer le public sur les risques liés à l’eau et les moyens de gestion de la ressource en eau mis en place
- Transmettre à la population locale l’importance de l’eau pour la biodiversité
- Sensibiliser le public à un usage éco-citoyen de la ressource en eau
- Favoriser le dialogue entre la population locale et les acteurs
Pour les étudiants BTS GPN :
- Concevoir et conduire un projet dans toutes ses dimensions
- Concevoir et mettre en œuvre des outils d’interprétation
Pour le territoire :
- Informer le public sur les risques liés à l’eau et les moyens de gestion de la ressource en eau mis en place
- Transmettre à la population locale l’importance de l’eau pour la biodiversité
- Sensibiliser le public à un usage éco-citoyen de la ressource en eau
- Favoriser le dialogue entre la population locale et les acteurs
Pour les étudiants BTS GPN :
- Concevoir et conduire un projet dans toutes ses dimensions
- Concevoir et mettre en œuvre des outils d’interprétation
Description de l'action
- Pré-forum (décembre 2015 à Janvier 2016) :
Conception et mise en œuvre de programmes pédagogiques sur l’eau (eau-biodiversité, eau-énergie, eau-pollution…) pour 4 classes de cycle 3 (CM1/CM2) et 3 classes de 5ème de Clairvaux les lacs. Ce pré-forum s’effectue dans le cadre des cours de M54 et conduit sur le territoire de Clairvaux-les-lacs par 5 groupes de 3 étudiants. Une restitution des travaux des primaires et collégiens est effectuée lors du forum.
- Forum : le vendredi 18 mars 2016 :
9h à 13h = Mise en place des ateliers et de la salle
13h30 à 16h = accueil des scolaires partenaires du projet
répartition des classes en petits groupes (8 élèves max) pour les faire tourner sur divers ateliers ludiques, scientifiques et expérimentaux dans une démarche participative maximale et venant ainsi enrichir les notions abordées lors du pré-forum (cf. pj)
18h à 21h = ouverture tout public
Habitants et acteurs de la communauté de communes du Pays des lacs (élus, techniciens, bénévoles associatifs…)
Implication des partenaires locaux sur le forum par la présentation de travaux, l’animation d’activités sur un parcours de 25 stations
- Pré-forum (décembre 2015 à Janvier 2016) :
Conception et mise en œuvre de programmes pédagogiques sur l’eau (eau-biodiversité, eau-énergie, eau-pollution…) pour 4 classes de cycle 3 (CM1/CM2) et 3 classes de 5ème de Clairvaux les lacs. Ce pré-forum s’effectue dans le cadre des cours de M54 et conduit sur le territoire de Clairvaux-les-lacs par 5 groupes de 3 étudiants. Une restitution des travaux des primaires et collégiens est effectuée lors du forum.
- Forum : le vendredi 18 mars 2016 :
9h à 13h = Mise en place des ateliers et de la salle
13h30 à 16h = accueil des scolaires partenaires du projet
répartition des classes en petits groupes (8 élèves max) pour les faire tourner sur divers ateliers ludiques, scientifiques et expérimentaux dans une démarche participative maximale et venant ainsi enrichir les notions abordées lors du pré-forum (cf. pj)
18h à 21h = ouverture tout public
Habitants et acteurs de la communauté de communes du Pays des lacs (élus, techniciens, bénévoles associatifs…)
Implication des partenaires locaux sur le forum par la présentation de travaux, l’animation d’activités sur un parcours de 25 stations
Résultats
93 scolaires et 250 participants tout public, dont 30% de jeune public
Evaluation par le public (48 % "bon", 52 % "excellent" - 94 % pour un renouvellement de l'évènement) et par les partenaires (lors du troisième comité technique)
93 scolaires et 250 participants tout public, dont 30% de jeune public
Evaluation par le public (48 % "bon", 52 % "excellent" - 94 % pour un renouvellement de l'évènement) et par les partenaires (lors du troisième comité technique)
Utilisation pédagogique
- Dans les modules du référentiel : illustration, des notions théoriques cours, cas concret.
Gestion de projet (M55)
Animation d’un public (M54)
Conception d’outils d’interprétation (M56)
- Dans les activités pluridisciplinarités en économie et animation : 21 heures, pour concevoir le projet
21 h x 27 étudiants soit 567 heures
21 h x 2 enseignants soit 42 heures
- Des heures au service de la réussite du projet (3 réunions de comité technique)
27 étudiants et 2 enseignants
Partenaires techniques présents (en moyenne 10 / réunion)
- Des heures pour la journée de l’évènement :
27 étudiants et 2 enseignants : préparation, animations, rangement
Partenaires techniques présents lors de l’évènement
- Dans les modules du référentiel : illustration, des notions théoriques cours, cas concret.
Gestion de projet (M55)
Animation d’un public (M54)
Conception d’outils d’interprétation (M56)
- Dans les activités pluridisciplinarités en économie et animation : 21 heures, pour concevoir le projet
21 h x 27 étudiants soit 567 heures
21 h x 2 enseignants soit 42 heures
- Des heures au service de la réussite du projet (3 réunions de comité technique)
27 étudiants et 2 enseignants
Partenaires techniques présents (en moyenne 10 / réunion)
- Des heures pour la journée de l’évènement :
27 étudiants et 2 enseignants : préparation, animations, rangement
Partenaires techniques présents lors de l’évènement
Autre valorisation
- création et diffusion des supports de communication (logo, flyers, banderoles,...)
- dossier de presse
- sites web et réseaux sociaux
- création et diffusion des supports de communication (logo, flyers, banderoles,...)
- dossier de presse
- sites web et réseaux sociaux
Perspective
- participation à un séminaire d'échange sur la rivière Ain (11 octobre 2016)
- participation d'un enseignant à une formation dans le cadre du programme Life Tourbières dans le Haut-Jura
- réinvestissement sur le territoire des contacts scolaires, pour des situations concrètes d'animation offertes aux étudiants vers toutes les classes primaires de Clairvaux
- renouvellement possible de l'évènement tous les 2 ans environ, pris en charge par les acteurs du territoire
- participation à un séminaire d'échange sur la rivière Ain (11 octobre 2016)
- participation d'un enseignant à une formation dans le cadre du programme Life Tourbières dans le Haut-Jura
- réinvestissement sur le territoire des contacts scolaires, pour des situations concrètes d'animation offertes aux étudiants vers toutes les classes primaires de Clairvaux
- renouvellement possible de l'évènement tous les 2 ans environ, pris en charge par les acteurs du territoire
Partenariats techniques/financiers
Partenaires techniques : implication lors des 3 réunions du comité technique pour le suivi du projet et /ou par la participation active à l’évènement.
Conseil départemental (39), Communauté de communes du pays des lacs, Mairie de Clairvaux, EDF GRH, Fédération de pêche (39), CNE Franche Comté, AGEK, CPIE du haut Jura, EDF-GDF, JNE, Amis de la rivière d’Ain, syndicats des eaux du Petit Lac, syndicat des eaux du Drouvenant, enseignants des établissements scolaires primaires de Clairvaux et Point de Poitte et du collège de Clairvaux, ONEMA
Partenaires financiers :
CD 39, Agence de l’eau AERMC, EDF-GRH, CC du Pays des lacs, communes de Clairvaux et Mesnois
Partenaires techniques : implication lors des 3 réunions du comité technique pour le suivi du projet et /ou par la participation active à l’évènement.
Conseil départemental (39), Communauté de communes du pays des lacs, Mairie de Clairvaux, EDF GRH, Fédération de pêche (39), CNE Franche Comté, AGEK, CPIE du haut Jura, EDF-GDF, JNE, Amis de la rivière d’Ain, syndicats des eaux du Petit Lac, syndicat des eaux du Drouvenant, enseignants des établissements scolaires primaires de Clairvaux et Point de Poitte et du collège de Clairvaux, ONEMA
Partenaires financiers :
CD 39, Agence de l’eau AERMC, EDF-GRH, CC du Pays des lacs, communes de Clairvaux et Mesnois
Fichier : fichierinitiative1_forum_eau_riginal_2016.pdf
Télécharger

Agriculture de conservation des sols : suivi des transferts d'intrants sol-eau selon différentes techniques de destruction des couverts végétaux (Amiens - Somme)
Nom de la structure
EPLEFPA Amiens
Téléphone
03 22 35 30 00
Contact (courriel)
guillaume.champion@educagri.fr
Contact2 (courriel)
vincent.debeugny@educagri.fr
Contact3 (courriel)
xavier.bortolin@educagri.fr
Site Web
https://www.leparacletamiens.com/
Code postal
80440
Ville
Cottenchy
Département
Somme
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
L'exploitation agricole du lycée Le Paraclet d'Amiens est engagée depuis 2019 dans le projet CASDAR TAE+ RECOUVE. Il s'agit ici, à proximité d'un point de captage d'eau potable et d'une zone humide (cf. fiche-action Déployer l'atelier eau de l'exploitation comme outil pédagogique dans une démarche agroécologique), de développer notamment l'agriculture de conservation des sols (ACS) en maximisant la couverture végétale et en semant directement les cultures dans ces couverts.
Ce type d’agriculture semble présenter un grand intérêt sur la maitrise de l’érosion et sur l’amélioration de la biodiversité du sol, mais reste à ce jour très dépendant des pesticides pour maitriser les couverts. Le projet vise à expérimenter d’autres modalités de destruction de couvert et d’en évaluer les impacts agronomiques, économiques et environnementaux. Dans l’objectif d’élargir le champ pédagogique de ce projet à d’autres formations, un suivi des nitrates et du glyphosate dans les eaux du sol des parcelles d'expérimentation CASDAR a été proposé et mis en place par l’établissement et les enseignants du BTSA GEMEAU...
Ce type d’agriculture semble présenter un grand intérêt sur la maitrise de l’érosion et sur l’amélioration de la biodiversité du sol, mais reste à ce jour très dépendant des pesticides pour maitriser les couverts. Le projet vise à expérimenter d’autres modalités de destruction de couvert et d’en évaluer les impacts agronomiques, économiques et environnementaux. Dans l’objectif d’élargir le champ pédagogique de ce projet à d’autres formations, un suivi des nitrates et du glyphosate dans les eaux du sol des parcelles d'expérimentation CASDAR a été proposé et mis en place par l’établissement et les enseignants du BTSA GEMEAU...
Objectif
- acquérir des données de performance autour de comparaison de techniques de destruction de couverts en ACS
- acquérir des données sur les transferts sol-eau d'intrants (nitrates, pesticides) en fonction des différentes techniques de destruction de couverts
- mobiliser plusieurs formation (BTSA GEMEAU, ANABIOTEC, STAV) autour d'une action expérimentale problématisée
- acquérir des données sur les transferts sol-eau d'intrants (nitrates, pesticides) en fonction des différentes techniques de destruction de couverts
- mobiliser plusieurs formation (BTSA GEMEAU, ANABIOTEC, STAV) autour d'une action expérimentale problématisée
Description de l'action
1/ Essai en bandes tournantes (5x 1 000 m2) sur des parcelles expérimentales de l’exploitation agricole soumises à différents traitements de destruction du couvert végétal (parcelle "Les hospices", semis couverts août 2019)
Type de mélange : avoine (10 kg/ha), phacélie (5 kg/ha), moutarde (7 kg/ha), vesce (12 kg/ha), radis (5 kg/ha)
parcelle 1 : destruction chimique (produit phytosanitaire contenant du glyphosate à 360 g/l)
parcelle 2 : destruction mécanique par broyeur mécanique
parcelle 3 : destruction mécanique par rouleau FAC
parcelle 4 : destruction par le gel
parcelle 5 : destruction par produit de biocontrôle (contenant de l'acide pélargonique)
2/ Suivi des concentrations en nitrates, glyphosate et son dérivé (l'AMPA) dans l'eau du sol, à 30 et 90 cm de profondeur dans 2 parcelles test (traitement glyphosate et témoin sans traitement). Choix final de prélèvements par bougies poreuses (après comparaison et validation des résultats prélèvement bougie poreuse/prélèvement carottage de terre) à 30 cm de profondeur.
Type de mélange : avoine (10 kg/ha), phacélie (5 kg/ha), moutarde (7 kg/ha), vesce (12 kg/ha), radis (5 kg/ha)
parcelle 1 : destruction chimique (produit phytosanitaire contenant du glyphosate à 360 g/l)
parcelle 2 : destruction mécanique par broyeur mécanique
parcelle 3 : destruction mécanique par rouleau FAC
parcelle 4 : destruction par le gel
parcelle 5 : destruction par produit de biocontrôle (contenant de l'acide pélargonique)
2/ Suivi des concentrations en nitrates, glyphosate et son dérivé (l'AMPA) dans l'eau du sol, à 30 et 90 cm de profondeur dans 2 parcelles test (traitement glyphosate et témoin sans traitement). Choix final de prélèvements par bougies poreuses (après comparaison et validation des résultats prélèvement bougie poreuse/prélèvement carottage de terre) à 30 cm de profondeur.
Résultats
(cf. § utilisation pédagogique, ci-dessous) Cette première année a permis de mettre en place et de valider les protocoles de collecte d'échantillons puis d’analyse du glyphosate et de son dérivé l’AMPA (dosage par HPLC avec détection fluorimétrique) et des nitrates (dosage par chromatographie ionique) ... ce qui a nécessité de très nombreuses adaptations.
Les techniques d’extraction des molécules par l’intermédiaire des bougies poreuses ont montré des résultats encourageants.
Les techniques d’extraction des molécules par l’intermédiaire des bougies poreuses ont montré des résultats encourageants.
Utilisation pédagogique
Le suivi par le dispositif de bougies poreuses permettant la collecte de l’eau du sol a révélé un potentiel pédagogique intéressant, permettant de mobiliser plusieurs formations, allant du BTSA GEMEAU dans la mise en œuvre du protocole et la collecte des échantillons au BTSA ANABIOTEC dans l’analyse en laboratoire des eaux du sol, en passant par les STAV dans le cadre des enseignements pluridisciplinaires.
Avec l’exploitation du lycée, un diagnostic du système de culture pourra être conduit par les apprenants dans le cadre de leur formation, sur les besoins en eau, la reconception du système de culture en lien avec le plan Ecophyto’ TER dans lequel est engagé l'établissement et sur les systèmes d'abreuvement du cheptel bovin.
Contribution des équipes et apprenants (Lycée et CFA) :
. GEMEAU, dans les protocoles de pose et de référencement des bougies poreuses (en fonction de la topographie de la parcelle) et de collecte des échantillons. Egalement : contribution au diagnostic sur le système d’exploitation et conception des systèmes de distribution de l’eau dans les pâtures de l’exploitation
. ANABIOTEC dans les protocoles de collecte et de mesure de la qualité des eaux (projet M58), restitution de leurs résultats en conseil d’exploitation
. STAV et CGEA dans le cadre de séances pluridisciplinaires, contribuant également aux campagnes de collecte et de mesure des échantillons d’eau dans le sol.
. APV : expérimentation et reconception du système de culture
. Ecodélégués et vie scolaire dans les activités et actions menées sur ou hors de l’EPL dans le cadre d’EPA 2
. Chargée de communication pour la mise en œuvre du plan
Avec l’exploitation du lycée, un diagnostic du système de culture pourra être conduit par les apprenants dans le cadre de leur formation, sur les besoins en eau, la reconception du système de culture en lien avec le plan Ecophyto’ TER dans lequel est engagé l'établissement et sur les systèmes d'abreuvement du cheptel bovin.
Contribution des équipes et apprenants (Lycée et CFA) :
. GEMEAU, dans les protocoles de pose et de référencement des bougies poreuses (en fonction de la topographie de la parcelle) et de collecte des échantillons. Egalement : contribution au diagnostic sur le système d’exploitation et conception des systèmes de distribution de l’eau dans les pâtures de l’exploitation
. ANABIOTEC dans les protocoles de collecte et de mesure de la qualité des eaux (projet M58), restitution de leurs résultats en conseil d’exploitation
. STAV et CGEA dans le cadre de séances pluridisciplinaires, contribuant également aux campagnes de collecte et de mesure des échantillons d’eau dans le sol.
. APV : expérimentation et reconception du système de culture
. Ecodélégués et vie scolaire dans les activités et actions menées sur ou hors de l’EPL dans le cadre d’EPA 2
. Chargée de communication pour la mise en œuvre du plan
Calendrier
2019-2022
Partenariats techniques/financiers
Fonds CASDAR TAE+ 2019-2022
Fichier : AgricultureDeConservationDesSolsSuiviDe_fichierinitiative1_amiens_couverts_et_bougies_poreuses.pdf
Télécharger
Fichier : AgricultureDeConservationDesSolsSuiviDe_fichierinitiative2_bougies_poreuses_amiens2.png
Télécharger


Agriculture et protection de captage (Chartres - Eure et Loir)
Nom de la structure
EPLEFPA de Chartres La Saussaye
Téléphone
02.37.33.72.36
Contact (courriel)
bruno.pontier@educagri.fr
Contact2 (courriel)
romain.perrineau@educagri.fr
Code postal
28630
Ville
SOURS
Département
Eure-et-Loir
Type d'initiative
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
L'exploitation en grandes cultures sur 140 ha de l'EPL est confrontée à un enjeu important de protection de la ressource en eau : située en zone vulnérable "nitrates", elle comprend 2 captages d'alimentation en eau potable, un pour la ville de Chartres, l'autre pour l'établissement lui-même...
Objectif
- Réduction de 50 % de l'IFT herbicide de l'exploitation pour 2014 (référence MAE 2008 : 1,7)
- Maintien de l'IFT hors herbicide de l'exploitation au niveau actuel de 50 % de la référence (référence MAE 2008 : 3,6)
- 100 % de couverture hivernale pour les intercultures longues et courtes après protéagineux en 2012
Description de l'action
- abandon des forages dans les couches calcaires (qualité d'eau dégradée)
- raccordement des assainissements individuels au réseau
- sécurisation des stockages de produits polluants
- aire de lavage-remplissage du pulvérisateur et phytobac de traitement des effluents
- agriculture intégrée sur l'exploitation : mixité (cultures annuelles, pérennes, élevage), diversification des cultures (actuellement 9 espèces différentes dont 3 protéagineux), rotation longue et assolement équilibré, bandes enherbées, haies, travail du sol sans retournement au maximum, conduite de la fumure plus fractionnée, désherbage mécanique, utilisation des produits phyto en dernier recours,...
- passage en agriculture biologique sur les 30 ha du périmètre de protection rapproché (10 ha en 2010, 10 ha en 2011, 10 ha en 2012). Dispositif expérimental en système autonome (sans intrants, uniquement désherbages mécaniques, limitation des interventions mécaniques) et en système productif (avec intrants, désherbages mécaniques et binage, multiplication des interventions mécaniques - labours, déchaumage - , utilisation de produits autorisés en AB)
Utilisation pédagogique
Utilisation pédagogique par l'ensemble des classes des filières professionnelle et technologique agricoles de l'établissement (lycée / CFPPA), comparaison de systèmes, techniques innovantes de production. Classes d'eau.
Autre valorisation
- expérimentation en place sur 20 ha : comparaison de systèmes (raisonné, intégré, intégré + désherbage mécanique, et semis direct sous couvert)
- création de références pour la profession
- lien avec le réseau d’exploitations DEPHY de la chambre d’agriculture : 2 fermes étudiées par les BTSA ACSE / an
- article de valorisation CASDAR TAE (2017) : https://www.adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/centre-val-de-loire/chartres-grandes-cultures.html
Partenariats techniques/financiers
- Chambre d'agriculture
- Agence de l'eau Seine Normandie
- Chartres métropole
- AFB
- CASDAR TAE ens. agricole
Lien vers vidéo de présentation (1)
https://www.dropbox.com/s/pnvgnkev8s1ises/EPL%20CHARTRES_2.mp4?dl=0
Lien vers vidéo de présentation(2)
https://www.youtube.com/embed/eiqiEwz011g
Vidéo de présentation (2)
Agroforesterie et protection de captage (Pamiers - Ariège)
Nom de la structure
EPLEFPA Pamiers Ariège Pyrénées
Téléphone
0534013800
Contact (courriel)
maxime.joulot@educagri.fr
Contact2 (courriel)
frederic.vavasseur@educagri.fr
Site Web
http://www.lyceeagricolepamiers.fr/
Code postal
09100
Ville
Pamiers
Département
Ariège
Type d'initiative
- milieu naturel
- qualité de l'eau
- risques
- systèmes de culture
Contexte
L'exploitation bovin-lait de l'EPLEFPA de Pamiers étant située en zone vulnérable, des efforts importants ont été engagés depuis 1992 pour développer des pratiques respectueuses de l'environnement, et plus particulièrement de la qualité de l'eau. Les efforts consentis sont allés au-delà des exigences liées à la zone vulnérable : développement des surfaces en herbe (15 ha en 2000, 50 ha aujourd'hui), moins 70% de produits phytosanitaires dans le cadre des dernières mesures agro-environnementales et démarches Ecophyto. Depuis 2010, l’exploitation est engagée dans un groupe DEPHY porté par la chambre d’agriculture de l’Ariège. Elle est aussi membre de 2 GIEE (Bois paysan et Conser’Sol) pour aller dans le sens de la transition agroécologique.
La présence d’un point de captage d’eau potable de la ville de Pamiers, réactivé en 2017 induit sur 12ha (sur les 70 ha au total de l'exploitation), correspondant à la zone de protection rapprochée, des contraintes d’usage très drastiques : apport de graines uniquement, pas d'épandage, quasiment pas de pâturage, pas d'abreuvement...
La présence d’un point de captage d’eau potable de la ville de Pamiers, réactivé en 2017 induit sur 12ha (sur les 70 ha au total de l'exploitation), correspondant à la zone de protection rapprochée, des contraintes d’usage très drastiques : apport de graines uniquement, pas d'épandage, quasiment pas de pâturage, pas d'abreuvement...
Objectif
- Assurer la pérennité d’une exploitation agricole en lien avec un enjeu environnemental fort
- Proposer une solution alternative à la gestion des zones vulnérables et points de captage d’eau potable
Description de l'action
- reconception du système de production de l’exploitation du lycée : conversion des 12ha de l'îlot en AB et conception d’un système agroforestier autofertile tout en maintenant l'autonomie fourragère de l'exploitation (noyers, pommiers, robiniers et rotations légumineuses-céréales-prairies à graminées)
- évaluation multicritères d’un système alternatif
- communication, valorisation, diffusion de résultats
Résultats
cf. plan d'action en pj
labellisation CASDAR transition agro-écologique de l'enseignement agricole en 2016 (projet sur 2016-2019)
labellisation CASDAR transition agro-écologique de l'enseignement agricole en 2016 (projet sur 2016-2019)
Utilisation pédagogique
implication des apprenants formation initiale (toutes filières : aménagement, forêt, production et services aux personnes et aux territoires) sur le terrain (TP, TD : lectures de paysage, suivis des sols, des cultures et de la faune, participation aux choix des itinéraires techniques et culturaux) et formation adultes (agriculteurs installés ou en cours d'installation : travail sur le plan de gestion du projet agroforestier)
Autre valorisation
- article sur le site adt (archives actualités)
- valorisation auprès des professionnels, des scolaires (parrainage des arbres), du grand public : journées techniques, panneaux, revues locales et techniques,... (action 3)
- intervention témoignage à la Journée "PNDAR-CASDAR - Comprendre, Protéger, Valoriser les sols agricoles" (2 février 2023)
Calendrier
2016-2019
Partenariats techniques/financiers
INRA UMR System, DDT, CA 09, collectivités locales, Réseau des fermes DEPHY, GIEE Conser'sol, police de l'eau, agence de l'eau Adour-Garonne, CASDAR TAE,...
Fichier : fichierinitiative1_Plan_d_action_AAP_2016_Pamiers.pdf
Télécharger
Fichier : diaporama_bilan_CASDAR.pdf
Télécharger
Lien vers vidéo de présentation (1)
http://www.dailymotion.com/video/x654cak
Vidéo de présentation (1)
Amélioration de la qualité de l'eau du Tréboul : changements de pratiques agricoles et ZTHA (Castelnaudary - Aude)
Nom de la structure
EPLEFPA de Castelnaudary
Téléphone
04 68 94 59 00
Contact (courriel)
vincent.jehanno@educagri.fr
Contact2 (courriel)
quentin.sarter@educagri.fr
Site Web
http://www.epl.lauragais.educagri.fr
Code postal
11490
Ville
Castelnaudary
Département
Aude
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
Le Tréboul, affluent du Fresquel, est défini comme en mauvais état de qualité des eaux, cela autant pour le paramètre nitrates que pour le paramètre pesticides. Un des deux îlots de l’exploitation agricole de l’établissement, d'une surface de 15 ha, borde ce cours d’eau.
Au niveau du territoire de ce bassin versant, l’exploitation agricole de l’EPL est engagée dans une logique de partenariat avec la chambre d’agriculture de l’Aude, l’ADAOA (Alliance pour le Développement Agricole de l’Ouest-Audois) et la coopérative Arterris. Elle est membre de deux groupes d'agriculteurs : le groupe Dephy (test de nouvelles pratiques économes en produits phytosanitaires) et le groupe Tréboul (limitation des transferts d'azote et de pesticides dans les eaux), initiateurs du GIEE sur le thème de l'aménagement concerté des activités agricoles sur le bassin-versant...
Au niveau du territoire de ce bassin versant, l’exploitation agricole de l’EPL est engagée dans une logique de partenariat avec la chambre d’agriculture de l’Aude, l’ADAOA (Alliance pour le Développement Agricole de l’Ouest-Audois) et la coopérative Arterris. Elle est membre de deux groupes d'agriculteurs : le groupe Dephy (test de nouvelles pratiques économes en produits phytosanitaires) et le groupe Tréboul (limitation des transferts d'azote et de pesticides dans les eaux), initiateurs du GIEE sur le thème de l'aménagement concerté des activités agricoles sur le bassin-versant...
Objectif
- Mettre en oeuvre un système de culture innovant, conçu dans le respect des « bonnes pratiques agro-environnementales » et adapté au contexte de production du Lauragais sur l’îlot de l’exploitation bordant le Tréboul (IFT maximum de 2,5)
- Aménager le parcellaire afin de réduire les transferts de polluants vers les masses d’eau.
Description de l'action
Diversification de l'assolement (réduction de la part des céréales à paille à un maximum de 40% de la surface des assolements et intégration de 25% minimum de légumineuses )
Evolution des pratiques de désherbage (désherbage mécanique).
Bassin 1 : végétalisation naturelle, profondeur maximum de 90cm. Objectif : favoriser la sédimentation et la biodégradation (dont dénitrification)
Bassin 2 : végétalisation artificielle, profondeur réduite (maximum 50cm). Objectif : favoriser la photodégradation
- Localisation et surface drainée : en sortie de collecteur des 6,5ha drainés
- Dimensions :
5m x 20m emprise totale avec les berges de 100m²
0,15% de la surface drainée
Volume : 21.75 m3 soit 3,3 m3/ha drainé
- Dispositif d’analyse :
Préleveurs automatiques en entrée et en sortie de mare (niveau de prélèvement variable selon débit de drainage) : collecte dans un flacon de 10L, relevé tous les 15 jours et analyses en laboratoire ou en régie : suivi des concentrations en nitrates et phosphore
Débitmètres en entrée/sortie : mesure de hauteur d’eau par ultrason dans un canal venturi (calcul du débit par le rapport hauteur/débit)
- Une bande enherbée de 2 à 5 m implantée autour du dispositif afin de faciliter l’accueil du public et des élèves.
- Mise en place (en co-conception avec l'ingénieur Dephy) d'un nouveau système de production sur l'îlot de 15 ha (2015) :
Diversification de l'assolement (réduction de la part des céréales à paille à un maximum de 40% de la surface des assolements et intégration de 25% minimum de légumineuses )
Evolution des pratiques de désherbage (désherbage mécanique).
- Recrutement d'un animateur pour l'action sur le territoire ouest-audois (dont un mi-temps sur le site pilote de l'exploitation) (2016)
- Réalisation d'un diagnostic environnemental, avec diagnostic des écoulements, du fonctionnement actuel du réseau de drainage et des fossés (zones tampons existantes)
- Aménagement d'une zone tampon humide artificielle (ZTHA) :
Bassin 1 : végétalisation naturelle, profondeur maximum de 90cm. Objectif : favoriser la sédimentation et la biodégradation (dont dénitrification)
Bassin 2 : végétalisation artificielle, profondeur réduite (maximum 50cm). Objectif : favoriser la photodégradation
- Localisation et surface drainée : en sortie de collecteur des 6,5ha drainés
- Dimensions :
5m x 20m emprise totale avec les berges de 100m²
0,15% de la surface drainée
Volume : 21.75 m3 soit 3,3 m3/ha drainé
- Dispositif d’analyse :
Préleveurs automatiques en entrée et en sortie de mare (niveau de prélèvement variable selon débit de drainage) : collecte dans un flacon de 10L, relevé tous les 15 jours et analyses en laboratoire ou en régie : suivi des concentrations en nitrates et phosphore
Débitmètres en entrée/sortie : mesure de hauteur d’eau par ultrason dans un canal venturi (calcul du débit par le rapport hauteur/débit)
- Une bande enherbée de 2 à 5 m implantée autour du dispositif afin de faciliter l’accueil du public et des élèves.
Utilisation pédagogique
Les bacs pro Agroéquipement et CGEA, ainsi que les BPREA (formations adultes) ont déjà été associés à la re-conception des assolements et de la rotation.
Concernant la ZTHA, Les élèves seront fortement impliqués dans les tâches suivantes :
- Suivi des débits dans les drains et en sortie de la mare : analyse des résultats, pertes par évaporation, infiltration, fonctionnement hydraulique d’une parcelle drainée…
- Suivi des concentrations en nitrates et en phosphore en sortie de drains et en sortie de la mare : estimation des pertes par lessivage/ruissellement, analyse du lien entre apports et concentrations dans les eaux de drainage
- Organisation de journées d’information/sensibilisation par les élèves auprès d’un public d’agriculteurs (dont groupes « Tréboul » et « Preuilhe/Rebenty » animés par la chambre d’agriculture)
Concernant la ZTHA, Les élèves seront fortement impliqués dans les tâches suivantes :
- Suivi des débits dans les drains et en sortie de la mare : analyse des résultats, pertes par évaporation, infiltration, fonctionnement hydraulique d’une parcelle drainée…
- Suivi des concentrations en nitrates et en phosphore en sortie de drains et en sortie de la mare : estimation des pertes par lessivage/ruissellement, analyse du lien entre apports et concentrations dans les eaux de drainage
- Organisation de journées d’information/sensibilisation par les élèves auprès d’un public d’agriculteurs (dont groupes « Tréboul » et « Preuilhe/Rebenty » animés par la chambre d’agriculture)
Autre valorisation
2020 : réalisation de flyers, d'un poster et d'un livret sur les actions de l'exploitation (cf pj)
films : 2020 et 2022
films : 2020 et 2022
Perspective
Le site a vocation à devenir une vitrine à caractère démonstratif et expérimental, au titre du premier aménagement qui serait réalisé sur le bassin-versant, avec un enjeu territorial fort.
Il conviendra de réaliser un suivi simple de manière à évaluer l'efficacité de la ZTHA dans le contexte pédo-climatique du Lauragais. La mesure du taux d’abattement des nitrates constitue un indicateur simple pour attester de l’efficacité d’un tel dispositif.
Il conviendra de réaliser un suivi simple de manière à évaluer l'efficacité de la ZTHA dans le contexte pédo-climatique du Lauragais. La mesure du taux d’abattement des nitrates constitue un indicateur simple pour attester de l’efficacité d’un tel dispositif.
Partenariats techniques/financiers
- Agence de l'eau RMC
- chambre d'agriculture Aude
- coopérative Arterris
- ADAOA (Alliance pour le Développement Agricole de l’Ouest-Audois)
- SAGE et syndicat du bassin-versant du Fresquel
- conseil régional
- chambre d'agriculture Aude
- coopérative Arterris
- ADAOA (Alliance pour le Développement Agricole de l’Ouest-Audois)
- SAGE et syndicat du bassin-versant du Fresquel
- conseil régional
Fichier : AmeliorationDeLaQualiteDeLEauDuTreboul_fichierinitiative1_livret_projets_exploitation_recadre.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative2_projetZTHA.pdf
Télécharger
Fichier : AmeliorationDeLaQualiteDeLEauDuTreboul_fichierinitiative3_poster_projets_exploitation_recadre.pdf
Télécharger
Fichier : AmeliorationDeLaQualiteDeLEauDuTreboul_fichierinitiative4_fiches_projets_exploitation_recadre.pdf
Télécharger
Vidéo de présentation (1)
Vidéo de présentation (2)
Amélioration des hydrosystèmes sur l'exploitation (Rochefort Montagne - Puy-de-Dôme)
Nom de la structure
E.P.L.E.F.P.A. de Rochefort Montagne
Téléphone
04.73.65.82.89
Contact (courriel)
lpa.rochefort-montagne@educagri.fr
Contact2 (courriel)
fabien.brosse@educagri.fr
Contact3 (courriel)
sylvie.hausard@educagri.fr
Site Web
https://lyceerochefortmontagne.fr/
Adresse postale
Le Marchedial
Code postal
63210
Ville
ROCHEFORT MONTAGNE
Département
Puy-de-Dôme
Type d'initiative
- milieu naturel
- qualité de l'eau
Contexte
Situé dans le parc naturel régional des volcans d'Auvergne, le lycée agricole de Rochefort montagne forme de futurs éleveurs et gestionnaires de l'environnement.
Son exploitation agricole, en agriculture biologique, produit des ovins de race locale (rava), du lait et des produits laitiers (fromage et yaourts issu de l'atelier pédagogique). Elle dispose également d'un rucher pédagogique.
En 2016, une réflexion sur une meilleure valorisation pédagogique de l'exploitation aboutit à la création d'un atelier "Puits de carbone et biodiversité" sur l'exploitation du Marchedial, avec l'objectif d'associer les élèves des deux filières sur un projet commun.
Un "tiers-temps" enseignant permet d'animer le dispositif qui regroupe la direction du lycée et de l'exploitation et les enseignants volontaires pour mener des projets avec leurs classes. Les pistes d'action sont le piégeage du carbone via la gestion du réseau de haies et des actions d'agroforesterie ainsi que le renforcement des services écosystémiques : amélioration du fonctionnement des hydrosystèmes, meilleure gestion des prairies,...
Son exploitation agricole, en agriculture biologique, produit des ovins de race locale (rava), du lait et des produits laitiers (fromage et yaourts issu de l'atelier pédagogique). Elle dispose également d'un rucher pédagogique.
En 2016, une réflexion sur une meilleure valorisation pédagogique de l'exploitation aboutit à la création d'un atelier "Puits de carbone et biodiversité" sur l'exploitation du Marchedial, avec l'objectif d'associer les élèves des deux filières sur un projet commun.
Un "tiers-temps" enseignant permet d'animer le dispositif qui regroupe la direction du lycée et de l'exploitation et les enseignants volontaires pour mener des projets avec leurs classes. Les pistes d'action sont le piégeage du carbone via la gestion du réseau de haies et des actions d'agroforesterie ainsi que le renforcement des services écosystémiques : amélioration du fonctionnement des hydrosystèmes, meilleure gestion des prairies,...
Objectif
- renforcer le rôle et les services rendus par l'ensemble des milieux hydriques sur l'exploitation.
- montrer aux apprenants et sur le territoire une exploitation agricole fonctionnant dans le respect de l’environnement (réglementation Loi sur l'eau entre autre).
Le diagnostic mené par la classe de BTS Gestion et protection de la nature a mis en évidence des atouts et des points noirs qui ont débouché les objectifs opérationnels suivants:
- améliorer le réseau de mares
- gérer les points noirs (zones d'embourbement, traversée à gué, présence de résineux à proximité du cours d'eau, berges dégradées,...)
- améliorer l'alimentation en eau des animaux au pâturage
- améliorer la traversée des engins et des animaux du cours d'eau
- restaurer la ripisylve
- montrer aux apprenants et sur le territoire une exploitation agricole fonctionnant dans le respect de l’environnement (réglementation Loi sur l'eau entre autre).
Le diagnostic mené par la classe de BTS Gestion et protection de la nature a mis en évidence des atouts et des points noirs qui ont débouché les objectifs opérationnels suivants:
- améliorer le réseau de mares
- gérer les points noirs (zones d'embourbement, traversée à gué, présence de résineux à proximité du cours d'eau, berges dégradées,...)
- améliorer l'alimentation en eau des animaux au pâturage
- améliorer la traversée des engins et des animaux du cours d'eau
- restaurer la ripisylve
Description de l'action
La mise en place de cet atelier et des actions qui en découlent est entièrement conçu et réalisé par les étudiants et élèves du lycée en démarche de projet :
- 2016/2017 : plan des gestion des haies de l'exploitation et recherche de valorisation des produits des haies (projet litière avec la plaquette produite), actions d'amélioration des haies existantes et plantations.
- 2017/2018 : amélioration des hydrosystèmes (cf. ci-dessous et documents en pj)
- 2018/2019 : verger conservatoire, site de démonstration de méthodes de lutte alternatives contre le campagnol terrestre
+ mise en place de suivis écologiques et réalisation de buttes de permaculture.
Les étudiants de BTS ayant travaillé sur le diagnostic ont proposé des pistes d'amélioration au directeur d'exploitation.
Après validation par le conseil d'exploitation, un dossier de demande de subvention a été déposé auprès de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, avec l'appui du technicien du contrat territorial de la rivière Sioule.
Les actions d'amélioration ont été réalisées dans le cadre d'un chantier de génie écologique de grande ampleur qui a associé 8 classes du lycée, les salariés et le directeur d'exploitation ainsi que de nombreux enseignants, avec l'appui technique du technicien rivière du secteur. Chaque groupe d'étudiants encadrait des élèves de différentes classes sur des projets en relation avec leur formation.
- 2016/2017 : plan des gestion des haies de l'exploitation et recherche de valorisation des produits des haies (projet litière avec la plaquette produite), actions d'amélioration des haies existantes et plantations.
- 2017/2018 : amélioration des hydrosystèmes (cf. ci-dessous et documents en pj)
- 2018/2019 : verger conservatoire, site de démonstration de méthodes de lutte alternatives contre le campagnol terrestre
+ mise en place de suivis écologiques et réalisation de buttes de permaculture.
Les étudiants de BTS ayant travaillé sur le diagnostic ont proposé des pistes d'amélioration au directeur d'exploitation.
Après validation par le conseil d'exploitation, un dossier de demande de subvention a été déposé auprès de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, avec l'appui du technicien du contrat territorial de la rivière Sioule.
Les actions d'amélioration ont été réalisées dans le cadre d'un chantier de génie écologique de grande ampleur qui a associé 8 classes du lycée, les salariés et le directeur d'exploitation ainsi que de nombreux enseignants, avec l'appui technique du technicien rivière du secteur. Chaque groupe d'étudiants encadrait des élèves de différentes classes sur des projets en relation avec leur formation.
Résultats
- une mare d'ombre restaurée,
- une mare créée en supprimant une zone d'embourbement
- 1 zone d'abreuvoir assainie et stabilisée
- 3 abreuvoirs en descente créés (dont 2 sur l'ancien passage à gué)
- 1 passerelle tracteur et bétail installée (prototype sur le département)
- des résineux éliminés
- 1 ancien abreuvoir dans le cours d'eau réhabilité : création de méandre, pose de toile de coco et de fascines de saule, retalutage de la berge.
- 1 encoche d'érosion traitée par pose d'un peigne végétal
- 1 200 m de ripisylve préservée par suppression de l'ancien barbelé et pose de clôture électrique à distance pour permettre à la ripisylve de se régénérer.
- une mare créée en supprimant une zone d'embourbement
- 1 zone d'abreuvoir assainie et stabilisée
- 3 abreuvoirs en descente créés (dont 2 sur l'ancien passage à gué)
- 1 passerelle tracteur et bétail installée (prototype sur le département)
- des résineux éliminés
- 1 ancien abreuvoir dans le cours d'eau réhabilité : création de méandre, pose de toile de coco et de fascines de saule, retalutage de la berge.
- 1 encoche d'érosion traitée par pose d'un peigne végétal
- 1 200 m de ripisylve préservée par suppression de l'ancien barbelé et pose de clôture électrique à distance pour permettre à la ripisylve de se régénérer.
Utilisation pédagogique
- BTS GPN2 : modules M51-M52-M53-M54
- Terminales GMNF : support pour le passage du CACES (minipelle)
- Seconde Production animales : module EP3 et pluris - chantier clôtures
- Seconde NJPF : module EP2 - préparation du chantier
- BTS GPN1 : modules M53 et M54
- diagnostic : Expertises naturaliste (M51)
- concerttion territoriale (M52)
- conception et encadrement d'un chantier de génie écologique (M53), support du CCF E6-2.
- réalisation de supports de communication (M54)
- expertises naturalistes (IBGN)
- chantier de génie écologique (chantier école)
- Terminales GMNF : support pour le passage du CACES (minipelle)
- Seconde Production animales : module EP3 et pluris - chantier clôtures
- Seconde NJPF : module EP2 - préparation du chantier
- BTS GPN1 : modules M53 et M54
- participation au chantier et article de presse
Autre valorisation
- meilleures conditions de travail des ouvriers agricoles (passage sécurisé des animaux, points d'abreuvement évitant les transports d'eau,...)
- amélioration du confort des vaches laitières : meilleures conditions de franchissement et d'abreuvement
- travail de conception et réalisation en partenariat étroit avec le technicien du contrat territorial de la rivière Sioule
- visite des techniciens rivières de 4 syndicats pendant le déroulement des travaux (avril 2018)
- visite de techniciens et d'élus du contrat territorial Sioule à l'automne 2018
- reconnaissance du savoir faire du lycée (filière GMNF) qui est demandé par les différents syndicats de rivière
- le lycée dispose désormais d'une plateforme de démonstration avec des travaux exemplaires : support de travail pour les classes du lycée et pour les visites de classes (Vet Agro Sup)
- reconnaissance du lycée dans le domaine de la biodiversité et plus largement "élevage et biodiversité" : intégration dans le séminaire I-Site sur les controverses en élevage ; groupe de travail INRA-Vet Agro Sup pour concevoir et tester ensemble de nouveaux systèmes bovins laitiers
- mares disponibles pour réaliser des suivis écologiques et des animations
- amélioration des connaissances des enseignants participants au projet
- travail de groupe entre les enseignants
- chantier très fédérateur au sein du lycée
. article de valorisation sur prix "coup de coeur du jury" du Grand prix 2020 génie écologique et sur visite d'un groupe OFB (2020)
. vidéo (2024, 4'38)
- amélioration du confort des vaches laitières : meilleures conditions de franchissement et d'abreuvement
- travail de conception et réalisation en partenariat étroit avec le technicien du contrat territorial de la rivière Sioule
- visite des techniciens rivières de 4 syndicats pendant le déroulement des travaux (avril 2018)
- visite de techniciens et d'élus du contrat territorial Sioule à l'automne 2018
- reconnaissance du savoir faire du lycée (filière GMNF) qui est demandé par les différents syndicats de rivière
- le lycée dispose désormais d'une plateforme de démonstration avec des travaux exemplaires : support de travail pour les classes du lycée et pour les visites de classes (Vet Agro Sup)
- reconnaissance du lycée dans le domaine de la biodiversité et plus largement "élevage et biodiversité" : intégration dans le séminaire I-Site sur les controverses en élevage ; groupe de travail INRA-Vet Agro Sup pour concevoir et tester ensemble de nouveaux systèmes bovins laitiers
- mares disponibles pour réaliser des suivis écologiques et des animations
- amélioration des connaissances des enseignants participants au projet
- travail de groupe entre les enseignants
- chantier très fédérateur au sein du lycée
. article de valorisation sur prix "coup de coeur du jury" du Grand prix 2020 génie écologique et sur visite d'un groupe OFB (2020)
. vidéo (2024, 4'38)
Calendrier
2017 : diagnostic écologique et agronomique, proposition d'actions et préparation des demandes de subvention
2018 : préparation et réalisation des travaux (avril) ; visites à partir de l'automne ; attente des subventions. Suivis écologiques.
2018 : préparation et réalisation des travaux (avril) ; visites à partir de l'automne ; attente des subventions. Suivis écologiques.
Perspective
Le chantier a été réalisé dans son intégralité avec les classes du lycée.
Il s'intègre pleinement dans l'atelier "Puits de carbone et biodiversité, un outil pour enseigner autrement" dont les effets écologiques et économiques restent à suivre.
Des suivis écologiques ont été mis en place (IBGN, suivi écrevisses, suivi loutre et campagnol amphibie, suivi amphibiens, suivi odonates) et sont réalisés chaque année par des classes (IBGN) ou des groupes d'étudiants de BTS Gestion et protection de la nature (autres suivis) avec des protocoles que nous essayons de normaliser afin qu'ils soient reproductibles.
Le suivi économique de l'atelier puits de carbone et biodiversité est à consolider avec l'arrivée de Mathilde Campedelli, cheffe de projet de partenariat (dispositif DGER) qui travaille sur le pilotage de l'exploitation via son bilan carbone (2019-2022)
Il s'intègre pleinement dans l'atelier "Puits de carbone et biodiversité, un outil pour enseigner autrement" dont les effets écologiques et économiques restent à suivre.
Des suivis écologiques ont été mis en place (IBGN, suivi écrevisses, suivi loutre et campagnol amphibie, suivi amphibiens, suivi odonates) et sont réalisés chaque année par des classes (IBGN) ou des groupes d'étudiants de BTS Gestion et protection de la nature (autres suivis) avec des protocoles que nous essayons de normaliser afin qu'ils soient reproductibles.
Le suivi économique de l'atelier puits de carbone et biodiversité est à consolider avec l'arrivée de Mathilde Campedelli, cheffe de projet de partenariat (dispositif DGER) qui travaille sur le pilotage de l'exploitation via son bilan carbone (2019-2022)
Partenariats techniques/financiers
Cette action a été réalisée en partenariat étroit avec l'animateur du contrat de rivière Sioule auquel elle a été intégrée.
Elle a été soutenue financièrement par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.
Elle a été soutenue financièrement par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.
Fichier : AmeliorationDesHydrosystemesSurLExploitati_fichierinitiative1_montage-final-double-abreuvoir-en-descente.pdf
Télécharger
Fichier : AmeliorationDesHydrosystemesSurLExploitati_fichierinitiative2_montage-final-fascines.pdf
Télécharger
Fichier : AmeliorationDesHydrosystemesSurLExploitati_fichierinitiative3_montage-final-nouvelle-mare.pdf
Télécharger
Fichier : AmeliorationDesHydrosystemesSurLExploitati_fichierinitiative4_traversee.pdf
Télécharger


Aménagement d'étang pour approvisionnement en eau de l'exploitation horticole (Dardilly - Rhône)
Nom de la structure
EPL Lyon-Dardilly-Ecully
Téléphone
04.78.66.64.29
Contact (courriel)
xavier.bunker@educagri.fr
Code postal
69570
Ville
Dardilly
Département
Rhône
Type d'initiative
- économie d'eau
- traitement des effluents
- milieu naturel
- qualité de l'eau
Contexte
L’étang de la Brocardière est situé au sein du lycée horticole de Dardilly. L’alimentation de l’étang est sûrement multiple (fossés, écoulements saisonniers et eaux de ruissellement collectées, notamment d'un bassin de décantation des eaux de ruissellement de l'ex-autoroute A6). Les eaux de l'étang sont captées pour le système d’arrosage des serres et pépinières de l'exploitation. Les eaux d'exhaure des installations sont pour l'instant rejettées à l'exutoire de l'étang, qui se déverse dans le ruisseau de Serres (classé Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - ZNIEFF - et Espace Naturel Sensible des Vallons de Serres et Planches).
Objectif
- améliorer la qualité de l'eau dans l'étang et restituée au milieu naturel
- restaurer la biodiversité et rendre possible les marnages de l'étang
- garantir un volume d'eau (et une qualité) dans l'étang suffisant pour pourvoir aux besoins de l'exploitation et diminuer la dépendance par rapport à l'eau du réseau d'eau potable (actuellement, 90% des besoins en eau de l'exploitation - 6 300 m3 sur 7 000 - sont pompés dans l'étang )
- restaurer la biodiversité et rendre possible les marnages de l'étang
- garantir un volume d'eau (et une qualité) dans l'étang suffisant pour pourvoir aux besoins de l'exploitation et diminuer la dépendance par rapport à l'eau du réseau d'eau potable (actuellement, 90% des besoins en eau de l'exploitation - 6 300 m3 sur 7 000 - sont pompés dans l'étang )
Description de l'action
- inventaires et observations faunistiques (1998 par CORA FS, 2000 par CSP, 2005 par CORA FS) : 55 espèces d'oiseaux (dont passereaux), mammifères (fouine, blaireau,...), poissons (cyprinidés, percidés), amphibiens (grenouille verte, grenouille agile, crapaud commun, triton palmé), mollusques (anodonte), reptiles (lézards, couleuvres). Présence d'espèces végétales exotiques envahissantes : ailante, renouée,...
- étude de la qualité des eaux et des sédiments de l'étang (2001 CEMAGREF et 2012 Ept'eau) : étang eutrophe, désoxygénation en profondeur (l'été), contamination des sédiments par des métaux lourds (restant en dessous des seuils) due aux eaux autoroutières, augmentation du volume de ces sédiments (estimation à ce jour, par extrapolation, à 2 500 m3 soit environ 20% du volume potentiel de l'étang).
- suivi de la qualité de l'eau dans l'étang et le ruisseau se Serres (campagne 2019, GREBE): fortes variations de T°c, pH, conductivité ; présence de nutriments, de métaux lourds, de pesticides (due aux apports sur le bassin-versants), en très faibles quantités mais rémanents.
- réalisation d'une étude de faisabilité par le bureau Biotec (2019, cf. § Perspectives) et engagement des premiers travaux : connexion des eaux de l'exploitation (eaux pluviales et d'exhaure) avec l'étang, réalisation d'un couplage eau d'étang (avec régulation du pH)-eau du réseau, réalisation d'un système économe d'irrigation par goutte à goutte pour la pépinière pleine terre
- étude de la qualité des eaux et des sédiments de l'étang (2001 CEMAGREF et 2012 Ept'eau) : étang eutrophe, désoxygénation en profondeur (l'été), contamination des sédiments par des métaux lourds (restant en dessous des seuils) due aux eaux autoroutières, augmentation du volume de ces sédiments (estimation à ce jour, par extrapolation, à 2 500 m3 soit environ 20% du volume potentiel de l'étang).
- suivi de la qualité de l'eau dans l'étang et le ruisseau se Serres (campagne 2019, GREBE): fortes variations de T°c, pH, conductivité ; présence de nutriments, de métaux lourds, de pesticides (due aux apports sur le bassin-versants), en très faibles quantités mais rémanents.
- réalisation d'une étude de faisabilité par le bureau Biotec (2019, cf. § Perspectives) et engagement des premiers travaux : connexion des eaux de l'exploitation (eaux pluviales et d'exhaure) avec l'étang, réalisation d'un couplage eau d'étang (avec régulation du pH)-eau du réseau, réalisation d'un système économe d'irrigation par goutte à goutte pour la pépinière pleine terre
Utilisation pédagogique
- par les BTSA GEMEAU du LEGTA de Vienne (38) sur la phase d'étude du projet (au printemps 2018, reconnaissance
des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées du bassin versant étudié en préalable aux investigations topographiques)
- par les bac STAV sur les diagnostics de faune et de flore
- présentation du projet par Biotec aux licences pro "Restauration des milieux aquatiques", projet tutoré d'un des étudiants sur le montage du dossier finalisé
- par les apprenants de la filière Aménagement paysager pour contribuer aux végétalisations prévues et pour la gestion des espèces exotiques envahissantes
- par les bac STAV sur les diagnostics de faune et de flore
- présentation du projet par Biotec aux licences pro "Restauration des milieux aquatiques", projet tutoré d'un des étudiants sur le montage du dossier finalisé
- par les apprenants de la filière Aménagement paysager pour contribuer aux végétalisations prévues et pour la gestion des espèces exotiques envahissantes
Autre valorisation
Article (site adt.educagri.fr)
Perspective
La pousuite du projet consiste à :
- remise à ciel ouvert des eaux d’exhaure des serres et pépinière par l'aménagement d'une noue filtrante végétalisée les acheminant en amont de l'étang (et non plus à l'exutoire) dans une zone humide "tampon"
- débroussaillage et terrassement en déblai-remblai pour aménager des micro-terrasses au niveau de la zone humide tampon, à fort potentiel auto-épurateur
- végétalisation de la zone humide par plantation d'hélophytes indigèenes et adaptés (traitement biologique complémentaire des eaux de ruissellement)
- recréation de berges en pente douce en déblai-remblai et d'une queue de retenue (en réutilisant les sédiments du fond de l'étang après curage)
- amélioration de la biodiversité autour de l'étang : gestion des espèces exotiques envahissantes
- aménagements spécifiques : cheminements bois, passages à gué, ré-aménagement de l'exutoire de l'étang vers le ruisseau de Serres
- suivi et gestion des aménagements, valorisation (panneaux, sensibilisation des apprenants)
- remise à ciel ouvert des eaux d’exhaure des serres et pépinière par l'aménagement d'une noue filtrante végétalisée les acheminant en amont de l'étang (et non plus à l'exutoire) dans une zone humide "tampon"
- débroussaillage et terrassement en déblai-remblai pour aménager des micro-terrasses au niveau de la zone humide tampon, à fort potentiel auto-épurateur
- végétalisation de la zone humide par plantation d'hélophytes indigèenes et adaptés (traitement biologique complémentaire des eaux de ruissellement)
- recréation de berges en pente douce en déblai-remblai et d'une queue de retenue (en réutilisant les sédiments du fond de l'étang après curage)
- amélioration de la biodiversité autour de l'étang : gestion des espèces exotiques envahissantes
- aménagements spécifiques : cheminements bois, passages à gué, ré-aménagement de l'exutoire de l'étang vers le ruisseau de Serres
- suivi et gestion des aménagements, valorisation (panneaux, sensibilisation des apprenants)
Partenariats techniques/financiers
INRAe, bureau Biotec, collectivités locales, associations naturalistes, Agence de l'eau RMC
Fichier : AmenagementDEtangEtAutonomieEnEauDeLEx_fichierinitiative1_shemas-projet.pdf
Télécharger
Fichier : AmenagementDEtangEtAutonomieEnEauDeLEx_fichierinitiative2_amenagement_zh.pdf
Télécharger

Lien vers vidéo de présentation (1)
https://www.dailymotion.com/video/k5Mms7KDun2eZMxhJet
Vidéo de présentation (1)
Aménagement d'une trame verte et bleue par génie écologique (Saint-Flour - Cantal)
Nom de la structure
EPL Louis Mallet, Saint Flour
Téléphone
04 71 60 08 45
Contact (courriel)
leonard.guilloux@educagri.fr
Contact2 (courriel)
arnaud.dumaitre@educagri.fr
Contact3 (courriel)
jerome.vigouroux@educagri.fr
Site Web
http://www.lycee-agricole-stflour.fr
Code postal
15104
Ville
Saint Flour
Département
Cantal
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- traitement des effluents
- milieu naturel
Contexte
- le site de l'EPL comprend des zones humides dont une mare (la mare "de l'internat") qui abrite plusieurs espèces d'amphibiens dont le triton crêté, espèce d'intérêt communautaire, inscrite à l'annexe II de la Directive habitat faune flore. Comme le souligne le document d'objectif du site de la Planèze de Saint Flour, l'enjeu de l'espèce dans la région est crucial car elle se trouve ici en limite sud de son aire de répartition. Cette mare était menacée d'assèchement en été notamment...
- l'étang dit "de l'exploitation" souffrait de pollution en matières organiques, due au lessivage des eaux blanches et de la plateforme de stabulation
- les eaux pluviales du parking de l'établissement étaient évacuées, sans traitement et sans gestion des flux, en menaçant la zone d'implantation de la pépinière dédiée à la production de plants d'espèces locales adaptées pour les haies.
Objectif
Créer une trame verte et bleue permettant la sauvegarde et des flux de biodiversité sur le site de l'EPL...et sur le territoire
Créer une trame verte et bleue permettant la sauvegarde et des flux de biodiversité sur le site de l'EPL...et sur le territoire
Description de l'action
- restauration de la qualité des eaux de l'étang de l'exploitation : aménagement d'un bassin de filtration (planté d'iris, massettes, roseaux) au niveau du ruissellement des eaux de l'ancien bâtiment de l'exploitation, puis au niveau du nouveau bâtiment
- récupération des eaux de pluie des bâtiments internat et atelier technologique pour assurer la pérennité de la mare
- récupération et gestion des eaux de ruissellement du parking, pour ne pas trop inonder la zone pépinière installée et avoir une réserve d'arrosage estival
- conventionnement avec le CEN Auvergne, qui s'engage à gérer le site de façon compatible avec la conservation des habitats et des espèces présents (l'EPL réalisant le plan de gestion et les chantiers d'entretien et d'aménagement nécessaires entrant dans le champ des compétences des différentes filières étudiantes du lycée)
Résultats
- retour à une bonne qualité de milieu pour la mare et pour l'étang, permettant la sauvegarde voire le développement des populations d'amphibiens et d'oiseaux.
- ré-empoissonnement en gardons de l'étang, en partenariat avec la Fédération de pêche du Cantal
- observation d'une loutre (vraisemblablement remontée depuis la Truyère)
- début de la production en pépinière d'espèces locales, à proximité du parking, en partenariat avec la Mission haies
Utilisation pédagogique
Les chantiers de génie écologique sont réalisés par les élèves de bac pro GMNF, le lien pédagogique étant fait également avec la filière bac pro CGEA
Les chantiers de génie écologique sont réalisés par les élèves de bac pro GMNF, le lien pédagogique étant fait également avec la filière bac pro CGEA
Autre valorisation
Le savoir-faire des élèves diffuse sur le territoire avec les chantiers-écoles réalisés à la demande d'agriculteurs et/ou de la communauté de commune de Saint-Flour, du syndicat interdépartemental de gestion de l'Allagnon, de la fédération de pêche du Cantal, du Conservatoire des espaces naturels d'Auvergne
Le savoir-faire des élèves diffuse sur le territoire avec les chantiers-écoles réalisés à la demande d'agriculteurs et/ou de la communauté de commune de Saint-Flour, du syndicat interdépartemental de gestion de l'Allagnon, de la fédération de pêche du Cantal, du Conservatoire des espaces naturels d'Auvergne
Perspective
- réalisation d'une noue pluviale, véritable corridor entre mare et étang (terrassement, déplacement de clôture, apport de compost, préparation du sol, récupération de plants de typhas, joncs, frêne et saule, sciage de bordures pour l'approvisionnement en eau de la noue)
- développement en parallèle de la trame verte avec plantations de haies sur l'exploitation
- optimisation de la filtration des effluents du (nouveau) bâtiment de l'exploitation par un lagunage, en sortie des bassins de filtration et en amont de l'étang
- développement du site internet dédié lycee-environnement-stflour.fr
Partenariats techniques/financiers
Communauté de commune de Saint-Flour, Syndicat interdépartemental de gestion de l'Allagnon (SIGAL), Fédération de pêche du Cantal, Conservatoire des espaces naturels d'Auvergne, Conseil régional,
Agences de l'eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne (partenaires indirects)
Communauté de commune de Saint-Flour, Syndicat interdépartemental de gestion de l'Allagnon (SIGAL), Fédération de pêche du Cantal, Conservatoire des espaces naturels d'Auvergne, Conseil régional,
Agences de l'eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne (partenaires indirects)
Fichier : fichierinitiative1_projet_noues_parking.png
Télécharger
Fichier : fichierinitiative2_projet_batiment_exploitation.pdf
Télécharger
Lien vers vidéo de présentation (1)
http://dai.ly/x4cblam
Vidéo de présentation (1)
StFlour_2016 par eau-ea
StFlour_2016 par eau-ea
Aménagement hydraulique agricole au Bénin (Gouville - Eure)
Nom de la structure
EPL de l'Eure (CFA de Chambray)
Téléphone
02 32 35 61 90
Contact (courriel)
anthony.letellier@educagri.fr
Contact2 (courriel)
emmanuel.bon@educagri.fr
Site Web
http://www.eplea-eure.educagri.fr/
Code postal
27240
Ville
Gouville
Département
Eure
Type d'initiative
- international
Contexte
Dans le cadre du MIL (Module d'Initiative Locale) et du PIC (Projet d'Initiative et de Communication) du BTS GEMEAU (Gestion et Maîtrise de l'Eau) en alternance, les apprentis du CFA de Chambray portent un projet hydraulique d'aide au développement dans la région de Comé au Bénin, en partenariat avec le CCFD (Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement).
Dans le cadre du MIL (Module d'Initiative Locale) et du PIC (Projet d'Initiative et de Communication) du BTS GEMEAU (Gestion et Maîtrise de l'Eau) en alternance, les apprentis du CFA de Chambray portent un projet hydraulique d'aide au développement dans la région de Comé au Bénin, en partenariat avec le CCFD (Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement).
Objectif
Mettre en place un projet de solidarité internationale ayant pour objectif la conception et la réalisation d'un système d'acheminement et d'irrigation.
Mettre en place un projet de solidarité internationale ayant pour objectif la conception et la réalisation d'un système d'acheminement et d'irrigation.
Description de l'action
Les installations permettent de prélever l'eau (forage, pompage), de la stocker (château d'eau) et de l'acheminer jusqu'aux parcelles de terre fertile destinées à la culture maraîchère.
Elles permettront aux bénéficiaires du projet de produire des cultures maraichères qu'ils pourront consommer ou vendre durant la saison sèche. Cela permettra aussi de développer à échelle réduite une ou plusieurs techniques d'irrigation. Ces dernières serviront de tests. Les producteurs de la région pourront ensuite choisir la solution convenant le mieux à leurs parcelles et à leurs productions. De plus, les installations sont construites grâce à des matériaux locaux, permettant ainsi l'entretien et la reproduction. Ce choix, validé par nos partenaires, permettra au projet de s'ancrer dans le long terme.
Les installations permettent de prélever l'eau (forage, pompage), de la stocker (château d'eau) et de l'acheminer jusqu'aux parcelles de terre fertile destinées à la culture maraîchère.
Elles permettront aux bénéficiaires du projet de produire des cultures maraichères qu'ils pourront consommer ou vendre durant la saison sèche. Cela permettra aussi de développer à échelle réduite une ou plusieurs techniques d'irrigation. Ces dernières serviront de tests. Les producteurs de la région pourront ensuite choisir la solution convenant le mieux à leurs parcelles et à leurs productions. De plus, les installations sont construites grâce à des matériaux locaux, permettant ainsi l'entretien et la reproduction. Ce choix, validé par nos partenaires, permettra au projet de s'ancrer dans le long terme.
Utilisation pédagogique
Le projet est partie prenante de la formation BTSA (module MIl et PIC), et évalué en tant que tel
Le projet est partie prenante de la formation BTSA (module MIl et PIC), et évalué en tant que tel
Autre valorisation
- Site internet
- conférence de restitution au retour du séjour
- réalisation d'un documentaire (sur place)
Calendrier
2010-2012
2010-2012
Partenariats techniques/financiers
- Comité Catholique contre la Faim et pour le Developpement (CCFD)
- Syndicat agricole "Synergie paysanne" (SYNPA)
- Conseil Régional Haute Normandie
- Collectivités locales
- Entreprises privées
Biodiversité et irrigation dans les territoires ruraux de Vaucluse (Carpentras -Vaucluse)
Nom de la structure
LEGTA Carpentras
Téléphone
04.90.60.80.80
Contact (courriel)
alain.nicolas@educagri.fr
Site Web
http://campus.louisgiraud.online.fr
Code postal
84200
Ville
Carpentras
Département
Vaucluse
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- milieu naturel
Contexte
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention-cadre entre la Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche, l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture et l'Union nationale des CPIE.
En Provence, le développement de l'irrigation a permis la création d'un réseau dense de canaux qui ont fortement contribué au développement de l'agriculture et indirectement à la création d'un paysage et de milieux spécifiques : les haies, les roselières, les labyrinthes de petits canaux, contribuent fortement à la singularité des paysages agricoles en Provence et à la biodiversité locale. Aujourd'hui, les mutations économiques, sociales et techniques liées à la recherche d'économies d'eau transforment les pratiques traditionnelles d'irrigation.
Les rôles positifs et négatifs sur les paysages et milieux naturels des ouvrages hydrauliques restent donc aujourd'hui à mieux connaître de manière globale et surtout à mieux faire connaître au niveau des décideurs, des agriculteurs, des gestionnaires de territoire, et auprès des habitants. Une prise de conscience collective est nécessaire pour pérenniser les pratiques traditionnelles d'irrigation, favoriser ses impacts positifs et minimiser ses impacts négatifs.
Dans ce contexte, le CPIE des Pays de Vaucluse, la Chambre d'Agriculture de Vaucluse et le Lycée Agricole Louis Giraud de Carpentras-Serres ont proposé le projet « Biodiversité et irrigation en Vaucluse» visant à mieux prendre en compte la biodiversité et le paysage dans l'entretien et l'utilisation des canaux d'irrigation et de drainage, et faire connaître le lien entre irrigation et biodiversité.
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention-cadre entre la Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche, l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture et l'Union nationale des CPIE.
En Provence, le développement de l'irrigation a permis la création d'un réseau dense de canaux qui ont fortement contribué au développement de l'agriculture et indirectement à la création d'un paysage et de milieux spécifiques : les haies, les roselières, les labyrinthes de petits canaux, contribuent fortement à la singularité des paysages agricoles en Provence et à la biodiversité locale. Aujourd'hui, les mutations économiques, sociales et techniques liées à la recherche d'économies d'eau transforment les pratiques traditionnelles d'irrigation.
Les rôles positifs et négatifs sur les paysages et milieux naturels des ouvrages hydrauliques restent donc aujourd'hui à mieux connaître de manière globale et surtout à mieux faire connaître au niveau des décideurs, des agriculteurs, des gestionnaires de territoire, et auprès des habitants. Une prise de conscience collective est nécessaire pour pérenniser les pratiques traditionnelles d'irrigation, favoriser ses impacts positifs et minimiser ses impacts négatifs.
Dans ce contexte, le CPIE des Pays de Vaucluse, la Chambre d'Agriculture de Vaucluse et le Lycée Agricole Louis Giraud de Carpentras-Serres ont proposé le projet « Biodiversité et irrigation en Vaucluse» visant à mieux prendre en compte la biodiversité et le paysage dans l'entretien et l'utilisation des canaux d'irrigation et de drainage, et faire connaître le lien entre irrigation et biodiversité.
Objectif
- faire, dans le cadre d'une recherche action, un état des lieux des connaissances sur la biodiversité et les modes actuels de gestion des canaux
- présenter les pratiques et les actions à mettre en oeuvre pour le maintien et l'amélioration de la bio-diversité
- valoriser les résultats obtenus et sensibiliser les différents acteurs du territoire et les habitants à la connaissance et la préservation de la biodiversité et des paysages dans les canaux d'irrigation.
Description de l'action
- Collecte d'informations : recherche bibliographique, rencontre d'acteurs (mise en place d'une série de grilles d'entretiens)
- Inventaire de terrain : à travers une initiation pédagogique, identification des enjeux en terme de biodiversité, remarquable ou ordinaire sur les sites retenus
- Réunion de restitution des résultats des diagnostics, co-animée par la Chambre d'Agriculture, le CPIE et le Lycée Agricole et valorisant les travaux (relevés de terrain, entretiens) des élèves et étudiants
- réalisation d'une plaquette d'information sur « Biodiversité et irrigation »
Utilisation pédagogique
Au total plus de 20 sorties ont été faites sur différentes sections du canal de Carpentras.
Toutes les classes ont participé : Seconde générale, 1ere STAV AVE, BTS 1 & 2 SER, BTS 1 AP.
- Pendant la période d'octobre à décembre les inventaires de la faune (pêches électriques avec l'Université de Provence), de la flore et du paysage ont été effectués.
- Sur la seconde période de Janvier à Mars les élèves et étudiants ont travaillé sur l'identification, la classification, des espèces présentes. Ils ont également travaillé sur le canal et son environnement historique, culturel et social.
Ils ont préparé des synthèses pour la journée de rendu du 7 avril 2011.
Au total plus de 20 sorties ont été faites sur différentes sections du canal de Carpentras.
Toutes les classes ont participé : Seconde générale, 1ere STAV AVE, BTS 1 & 2 SER, BTS 1 AP.
- Pendant la période d'octobre à décembre les inventaires de la faune (pêches électriques avec l'Université de Provence), de la flore et du paysage ont été effectués.
- Sur la seconde période de Janvier à Mars les élèves et étudiants ont travaillé sur l'identification, la classification, des espèces présentes. Ils ont également travaillé sur le canal et son environnement historique, culturel et social.
Ils ont préparé des synthèses pour la journée de rendu du 7 avril 2011.
Autre valorisation
HTTP://WWW.CPIE.FR/IMG/PDF/ACTIONAGRI_BIODIVERSITEUNCPIEVFWEB.PDF
- plaquette (cf. à télécharger)
- pages web :
HTTP://WWW.CPIE.FR/IMG/PDF/ACTIONAGRI_BIODIVERSITEUNCPIEVFWEB.PDF
Calendrier
2010-2011 (action réalisée)
2010-2011 (action réalisée)
Perspective
- étude de faisabilité d'un guide des bonnes pratiques destiné à être édité et diffusé auprès de l'ensemble des gestionnaires d'ouvrages hydrauliques du Vaucluse
- créer ou renforcer un volet «biodiversité» dans les contrats de canaux proposés par l'Agence de l'Eau et la Région aux gestionnaires d'ouvrages hydrauliques
- contribuer au schéma régional de cohérence écologique en enrichissant les données sur la trame verte et bleue en Vaucluse
Partenariats techniques/financiers
techniques :
- Canal de Carpentras
- Université de Provence
- Chambre d'agriculture de Vaucluse
- Centre méditerranéen de l'environnement
financiers :
- Conseil régional PACA
- Centre méditerranéen de l'environnement
techniques :
- Canal de Carpentras
- Université de Provence
- Chambre d'agriculture de Vaucluse
- Centre méditerranéen de l'environnement
financiers :
- Conseil régional PACA
- Centre méditerranéen de l'environnement
Fichier : fichierinitiative1_plaquette_biodiv_irrigation.pdf
Télécharger
Changements climatiques et végétaux : Quelles réponses scientifiques et techniques ? (Angers - Maine-et-Loire)
Nom de la structure
EPLEFPA Angers le Fresne
Téléphone
02 41 68 60 00
Contact (courriel)
anne.hersent@educagri.fr
Contact2 (courriel)
eric.duclaud@educagri.fr
Contact3 (courriel)
lionel.gonzales@educagri.fr
Code postal
49000
Ville
Angers
Département
Maine-et-Loire
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- économie d'eau
- risques
Contexte
L’exploitation horticole du lycée du Fresne ainsi que les producteurs du territoire doivent faire face depuis plusieurs années aux conséquences du changement climatique et notamment au manque d’eau. Cette problématique est récurrente et s’aggrave. Les interrogations quotidiennes des apprenants dans nos cours, les inquiétudes exposées des professionnels lors de visites montrent que le manque d’eau est un sujet prégnant. Au-delà de ces constats, le SAGE nous engage dans cette démarche de concertation. Ainsi, nous devons mettre en place des projets collectifs et structurants...
Objectif
Volet pédagogique : sensibiliser et impliquer activement les apprenants, jeunes citoyens et futurs professionnels
Volet sociologique : enquêter auprès des professionnels irrigants de la commune de Saint Gemmes (en vue d'un plan d'action à moyen et long terme)
Volet scientifique : expérimenter la résilience et la réponse au stress hydrique de plants d'ornement ou de maraichage
Volet sociologique : enquêter auprès des professionnels irrigants de la commune de Saint Gemmes (en vue d'un plan d'action à moyen et long terme)
Volet scientifique : expérimenter la résilience et la réponse au stress hydrique de plants d'ornement ou de maraichage
Description de l'action
Volet pédagogique :
Présentation du projet en plénière à la réunion de rentrée
implication des BTS PH sur le volet sociologique (enquête et portraits des professionnels),
Implication des classes Prépas et des L3 sur le volet scientifique (essai de végétaux en stress hydrique)
Présentation des expérimentations des Prépas aux classes de BTS PH 2, avec retour critique de ceux-ci
Intégration de la problématique et du projet dans le cadre de la Semaine développement durable avec les bac pro et les bac STAV
Travail des BTS PH 1 sur le compte-rendu d’expérimentation des Prépas.
Présentation de l'avancée du projet en plénière à la réunion de fin d'année
Volet sociologique :
Quelle est la perception des producteurs sur la place de l’eau dans leur exploitation ? (cf. document à télécharger)
Appui de M. Le Guen (sociologue)
Réalisé par un groupe de BTS PH dans le cadre d'un PIC
Etapes : Connaissance du territoire et de ses acteurs ; co-construction de l’enquête ; tests et ajustements ; enquêtes/portraits de professionnels sur le territoire ; dépouillement ; retranscription ; restitution-communication des résultats (aux professionnels et aux partenaires) ; réalisation et diffusion de l'exposition "portraits" (8 kakemonos)
Volet scientifique :
Nous échangeons avec notre partenaire, l’équipe STREMHO de l’Institut de Recherches en Horticulture et Semences (IRHS) qui évalue l’existence d’une mémorisation de stress hydriques passés sous forme de marques épigénétiques dans le génome des plantes et sa transmission à des clones par propagation végétative. Si une telle mémorisation et transmission étaient démontrées, ces recherches ouvriraient à de nouveaux itinéraires de production incluant une pré-adaptation des plants au stress hydrique, pour une meilleure adaptation chez le consommateur final. L’application de cette méthode à deux espèces végétales (pétunia et tomate buissonnante) est lancée dans notre nouvel outil de production de l’exploitation du Fresne, le phytotron, en partenariat avec l’IRHS. L’exploitation de l’EPLEFPA est donc pleinement mobilisée comme support pédagogique et d’expérimentation. Nos apprenants aux profils variés participent activement et concrètement à ce projet à travers la mise en place et le suivi d’essais (cf. document à télécharger)
Présentation du projet en plénière à la réunion de rentrée
implication des BTS PH sur le volet sociologique (enquête et portraits des professionnels),
Implication des classes Prépas et des L3 sur le volet scientifique (essai de végétaux en stress hydrique)
Présentation des expérimentations des Prépas aux classes de BTS PH 2, avec retour critique de ceux-ci
Intégration de la problématique et du projet dans le cadre de la Semaine développement durable avec les bac pro et les bac STAV
Travail des BTS PH 1 sur le compte-rendu d’expérimentation des Prépas.
Présentation de l'avancée du projet en plénière à la réunion de fin d'année
Volet sociologique :
Quelle est la perception des producteurs sur la place de l’eau dans leur exploitation ? (cf. document à télécharger)
Appui de M. Le Guen (sociologue)
Réalisé par un groupe de BTS PH dans le cadre d'un PIC
Etapes : Connaissance du territoire et de ses acteurs ; co-construction de l’enquête ; tests et ajustements ; enquêtes/portraits de professionnels sur le territoire ; dépouillement ; retranscription ; restitution-communication des résultats (aux professionnels et aux partenaires) ; réalisation et diffusion de l'exposition "portraits" (8 kakemonos)
Volet scientifique :
Nous échangeons avec notre partenaire, l’équipe STREMHO de l’Institut de Recherches en Horticulture et Semences (IRHS) qui évalue l’existence d’une mémorisation de stress hydriques passés sous forme de marques épigénétiques dans le génome des plantes et sa transmission à des clones par propagation végétative. Si une telle mémorisation et transmission étaient démontrées, ces recherches ouvriraient à de nouveaux itinéraires de production incluant une pré-adaptation des plants au stress hydrique, pour une meilleure adaptation chez le consommateur final. L’application de cette méthode à deux espèces végétales (pétunia et tomate buissonnante) est lancée dans notre nouvel outil de production de l’exploitation du Fresne, le phytotron, en partenariat avec l’IRHS. L’exploitation de l’EPLEFPA est donc pleinement mobilisée comme support pédagogique et d’expérimentation. Nos apprenants aux profils variés participent activement et concrètement à ce projet à travers la mise en place et le suivi d’essais (cf. document à télécharger)
Résultats
cf. documents à télécharger
Utilisation pédagogique
Très large implication de la communauté enseignante (cf. plaquettes à télécharger), de l'exploitation et des apprenants des bac pro, STAV, BTS PH, classe prépa et L3 (voir ci-dessus, volet pédagogique)
Autre valorisation
- Journées plénières de rentrée et de fin d'année scolaire
- Restitution publique de l'enquête et diffusion de l'exposition "portraits de professionnels" (kakemonos)
- article sur site adt
- Restitution publique de l'enquête et diffusion de l'exposition "portraits de professionnels" (kakemonos)
- article sur site adt
Calendrier
action conduite dans le cadre d'un dispositif "Tiers-temps" (2020-2023)
Perspective
Poursuite des actions sur les 3 volets : exploitation et transfert des résultats, multiplication et clonage des plants dans le phytotron de l'exploitation, diffusion vers les professionnels du territoire
Partenariats techniques/financiers
- équipe STREMHO de l’IRHS
- UMT STRAtège
- Philippe LEGUERN, sociologue
- Chambre d’Agriculture
- Association Pôle Végétal Loire Maine
- DDT du Maine et Loire
- Syndicat Mixte des Basses vallées angevines
- Fédération Régionale des Chasseurs, LPO
- professionnels de la filière horticole du territoire
- Mairie de Saint-Gemmes-sur-Loire
- Vegepolys Valley
Action menée dans le cadre d'un dispositif tiers-temps, soutenu par la DGER
+ Participation de la Bergerie Nationale et de Réso'Them au comité de pilotage
- UMT STRAtège
- Philippe LEGUERN, sociologue
- Chambre d’Agriculture
- Association Pôle Végétal Loire Maine
- DDT du Maine et Loire
- Syndicat Mixte des Basses vallées angevines
- Fédération Régionale des Chasseurs, LPO
- professionnels de la filière horticole du territoire
- Mairie de Saint-Gemmes-sur-Loire
- Vegepolys Valley
Action menée dans le cadre d'un dispositif tiers-temps, soutenu par la DGER
+ Participation de la Bergerie Nationale et de Réso'Them au comité de pilotage
Fichier : ChangementsClimatiquesEtVegetauxQuellesR_fichierinitiative1_enquete_portraits.pdf
Télécharger
Fichier : ChangementsClimatiquesEtVegetauxQuellesR_fichierinitiative2_experimentation_stress_hydrique.pdf
Télécharger
Fichier : ChangementsClimatiquesEtVegetauxQuellesR_fichierinitiative3_cr_expe_tomates.pdf
Télécharger
Fichier : ChangementsClimatiquesEtVegetauxQuellesR_fichierinitiative4_plaquettes_com_interne.pdf
Télécharger


Chantier solidaire avec l'Inde : Phytoépuration (Saint Herblain - Loire Atlantique)
Nom de la structure
EPL Jules Rieffel
Téléphone
02 40 94 99 30
Contact (courriel)
florent.dionizy@educagri.fr
Site Web
http://www.julesrieffel.educagri.fr
Code postal
44800
Ville
Saint Herblain
Département
Loire-Atlantique
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- traitement des effluents
- international
- milieu naturel
- qualité de l'eau
Contexte
Le projet en Inde est de créer des bassins de phytoépuration ou lagunage (traitement de l'eau par les plantes) afin de rendre l'autonomie en eau aux habitants de Matéura, petit village d'environs 130 habitants des montagnes du nord de l'Inde.
Le village qui a l'eau courante depuis 2007 ne dispose en effet d'aucune infrastructure pour recueillir et traiter les eaux usées. Ces eaux se déversent donc dans les champs et la rivière en contrebas. Traiter les eaux usées devient donc un problème urgent afin de préserver l'environnement et la qualité de vie des gens.
Le projet en Inde est de créer des bassins de phytoépuration ou lagunage (traitement de l'eau par les plantes) afin de rendre l'autonomie en eau aux habitants de Matéura, petit village d'environs 130 habitants des montagnes du nord de l'Inde.
Le village qui a l'eau courante depuis 2007 ne dispose en effet d'aucune infrastructure pour recueillir et traiter les eaux usées. Ces eaux se déversent donc dans les champs et la rivière en contrebas. Traiter les eaux usées devient donc un problème urgent afin de préserver l'environnement et la qualité de vie des gens.
Objectif
Mettre en place une action environnementale dans un pays en développement
Description de l'action
- août 2009 : 3 membres de l'association "Pani" sont partis à Matéura dans le but d'engager concrètement le projet. Dans un premier temps un gros travail de sensibilisation à été fait, afin de que les locaux s'investissent totalement, le but étant qu'ils reprennent et qu'ils gèrent eux-mêmes ces bassins. Les bassins ont également commencés à être creusés...
- mai 2010 : 16 élèves apprentis BPA paysagistes sont venus pour terminer les bassins.
- été 2013 : 3e séjour de jeunes de st Herblain. tournage d'un film DVD (educagri éditions)
Utilisation pédagogique
Expérimentation de la technique et réalisation par les apprentis du CFA (cf. ci dessus)
Expérimentation de la technique et réalisation par les apprentis du CFA (cf. ci dessus)
Autre valorisation
Articles de presse, blog (http://assopani.canalblog.com), DVD educagri editions
Articles de presse, blog (http://assopani.canalblog.com), DVD educagri editions
Perspective
Les villageois sont enthousiastes vis-vis de ce projet,certains réclament le même projet dans les villages alentours. Nous avons bon espoir que Matéura servent de modèle...
Les villageois sont enthousiastes vis-vis de ce projet,certains réclament le même projet dans les villages alentours. Nous avons bon espoir que Matéura servent de modèle...
Partenariats techniques/financiers
- LPA Guérande et LPA Château-Gontier
- Association "Pani"
- CPIE Pays de Nantes
- France Europea
- collectivités locales de la région d'Imachai Pradesh
- SMIDAP
Lien vers vidéo de présentation (1)
http://editions.educagri.fr/fr/dvd-video/4820-la-phytoepuration-de-saint-herblain-a-mateura-dvd.html
Classe d'eau éleveurs dans l'Auxois et le Châtillonnais (Chatillon sur Seine - Côte d'Or)
Nom de la structure
LEGTA La Barotte Haute Côte d'Or
Téléphone
03 80 91 53 03
Contact (courriel)
eric.demouron@educagri.fr
Contact2 (courriel)
sofie.aublin@educagri.fr
Contact3 (courriel)
geraldine.sachot@educagri.fr
Adresse postale
route de Langres
Code postal
21400
Ville
Chatillon sur Seine
Département
Côte-d'Or
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
Contexte
Principales problématiques liées au public cible :
- Montrer qu'il est possible de concilier agriculture et en particulier élevage avec la préservation de la ressource en eau dans la Châtillonnais et dans l'Auxois
- Approfondir les problématiques pesticides, fertilisation et gestion physique des cours d'eau dans ces 2 zones
Principales problématiques liées au public cible :
- Montrer qu'il est possible de concilier agriculture et en particulier élevage avec la préservation de la ressource en eau dans la Châtillonnais et dans l'Auxois
- Approfondir les problématiques pesticides, fertilisation et gestion physique des cours d'eau dans ces 2 zones
Objectif
- Apporter des connaissances fondamentales sur la problématique de l'eau afin d'aider les agriculteurs à comprendre les enjeux liés à cette ressource.
- Aller à la rencontre des acteurs de l'eau afin de faciliter la connaissance des institutions et des réglementations.
- Développer un projet sur l'exploitation des participants qui le souhaitent.
Description de l'action
D'une durée de 5 jours cette classe d'eau va aborder les enjeux de l'eau et de l'agriculture (en particulier l'élevage). A chaque jour correspond un programme spécifique avec des interventions et des visites de terrain ; la restitution aura pour cadre « Les Journées Châtillonnaises » afin de valoriser la production collective des éleveurs qui sera réalisée pendant cette session et de dresser le bilan de ces journées dont le dispositif s'inscrit dans le cadre des projets « classe d'eau » de l'Agence de l'eau Seine-Normandie
D'une durée de 5 jours cette classe d'eau va aborder les enjeux de l'eau et de l'agriculture (en particulier l'élevage). A chaque jour correspond un programme spécifique avec des interventions et des visites de terrain ; la restitution aura pour cadre « Les Journées Châtillonnaises » afin de valoriser la production collective des éleveurs qui sera réalisée pendant cette session et de dresser le bilan de ces journées dont le dispositif s'inscrit dans le cadre des projets « classe d'eau » de l'Agence de l'eau Seine-Normandie
Résultats
- Meilleure connaissance des problématiques locales liées à l'eau et l'élevage
- Réalisation d'un aménagement d'abreuvement sur les parcelles du lycée
Utilisation pédagogique
Lien fort entre la classe d'eau éleveur et celle des élèves + lien aux actions du projet d'établissement en démarche globale de développement durable
Lien fort entre la classe d'eau éleveur et celle des élèves + lien aux actions du projet d'établissement en démarche globale de développement durable
Autre valorisation
- DVD Educagri éditions
- Diaporama
- 4 pages sur les enjeux de l'eau et l'agriculture
Calendrier
Ces journées ont eu lieu les vendredi 25 janvier, mardi 16 avril, mardi 23 avril, jeudi 30 mai et samedi 29 juin 2013.
Ces journées ont eu lieu les vendredi 25 janvier, mardi 16 avril, mardi 23 avril, jeudi 30 mai et samedi 29 juin 2013.
Perspective
Reconduite du dispositif tous les ans
Reconduite du dispositif tous les ans
Partenariats techniques/financiers
Cette session professionnelle est la première organisée sur le territoire hydrographique Seine-amont en partenariat avec le Syndicat Intercommunal pour la Réalisation des Travaux d'Aménagement de la Vallée de l'Armançon (SIRTAVA), le Syndicat Intercommunal des Cours d'Eau Châtillonnais (SICEC) et la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or. Le coût financier de ces journées d'échanges est entièrement pris en charge par les organisateurs.
Cette session professionnelle est la première organisée sur le territoire hydrographique Seine-amont en partenariat avec le Syndicat Intercommunal pour la Réalisation des Travaux d'Aménagement de la Vallée de l'Armançon (SIRTAVA), le Syndicat Intercommunal des Cours d'Eau Châtillonnais (SICEC) et la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or. Le coût financier de ces journées d'échanges est entièrement pris en charge par les organisateurs.
Fichier : fichierinitiative1_programme_journees_eleveurs_VDF_2013.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative2_Cadrage_classe_deau_eleveur.doc
Télécharger
Fichier : fichierinitiative3_La_Barotte-projet_etablissement_en_DD_et_EDD.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative4_4pages_classe_eau_eleveurs_2014.pdf
Télécharger
Lien vers vidéo de présentation (1)
http://www.dailymotion.com/video/xyqcgk_labarotte-classe-eau-eleveurs_school#.UV1QEhlZc7A
Vidéo de présentation (1)
Conservation du triton crêté (Sées - Orne)
Nom de la structure
EPL d'Alençon-Sées
Téléphone
02 33 81 74 00
Contact (courriel)
renaud.jegat@educagri.fr
Site Web
http://www.alencon-sees.educagri.fr
Code postal
61 500
Ville
Sées
Département
Orne
Type d'initiative
- milieu naturel
Contexte
L'état de conservation du triton crêté, espèce intégralement protégée en France, a été jugé inadéquat pour la région atlantique lors du bilan de l'état de conservation des espèces (directive 92-43 du 21 mai 1992 dite « habitat, faune et flore »). Le lycée agricole de Sées a su conserver une population de triton crêté malgré les profondes modifications du paysage. depuis les années soixante. Il porte volontairement aujourd'hui la responsabilité de sa pérennité.
L'état de conservation du triton crêté, espèce intégralement protégée en France, a été jugé inadéquat pour la région atlantique lors du bilan de l'état de conservation des espèces (directive 92-43 du 21 mai 1992 dite « habitat, faune et flore »). Le lycée agricole de Sées a su conserver une population de triton crêté malgré les profondes modifications du paysage. depuis les années soixante. Il porte volontairement aujourd'hui la responsabilité de sa pérennité.
Description de l'action
- connaissance de la population : action effectuée après une prise de contact avec des experts locaux et nationaux des amphibiens : mesures d'abondance relative (comptages à la lampe-torche) et estimations de l'abondance absolue (techniques de capture-marquage-recapture)
- aménagement du biotope : création de deux mares, réalisation de corridors entre ces mares et d'abris (travaux réalisés en 2009). La première mare, dédiée à la conservation, est interdite d'accès. La seconde, située le long d'un sentier d'interprétation, sera fréquentée par les élèves. Entre ces deux nouvelles mares et la mare existante, situées à environ 200 m les unes des autres, des haies ont été plantées en 2008 pour servir d'abri. Les travaux ont été exécutés par une entreprise (creusement des mares), par les employés de la ferme (transport de terre, clôtures) et par des élèves (plantation des haies, petits aménagements)
- communication autour et sur le projet : création, dès 2008, d'un site Internet (http://triton-crete-sees.pagesperso-orange.fr/topic/index.html), rédaction d'articles de presse
Résultats
Première reproduction dans le nouvelles mares observées en 2010. Population estimée à 300 adultes.
Première reproduction dans le nouvelles mares observées en 2010. Population estimée à 300 adultes.
Utilisation pédagogique
- support de travaux pratiques, démonstration, sensibilisation pour les élèves et étudiants des formations environnementales
- sensibilisation pour les élèves, étudiants et apprentis des autres formations
Autre valorisation
- journées de démonstration pour les agriculteurs (sensibilisation aux composantes environnementales de l'exploitation)
- groupes scolaires fréquentant le centre équestre (sensibilisation
- site internet (cf. ci dessus), plaquette
- articles de presse locale et spécialisée
Partenariats techniques/financiers
- parc naturel régional Normandie-Maine
- conservatoire fédératif des espaces naturels de Basse-Normandie
- CPIE du Cotentin
- MAAPRAT, MEDDTL
Fichier : fichierinitiative1_poster_triton.pdf
Télécharger
Conversion à l'AB et qualité de l'eau (Nîmes - Gard)
Nom de la structure
EPLEFPA de Nîmes-Rodilhan
Téléphone
04 66 20 67 67
Contact (courriel)
riadh.ourabah@educagri.fr
Site Web
http://www.epl.nimes.educagri.fr
Code postal
30230
Ville
Rodilhan
Département
Gard
Type d'initiative
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
Le verger de Donadille appartient au lycéee agricole de Nîmes-Rodilhan. Il est situé en bordure d'un ruisseau (Le Buffalon) drainant la nappe de la Vistrenque (nappe classée depuis 1994 en « zone vulnérable aux nitrates d'origine agricole » selon la directive nitrate de 1991). La conversion en AB des 6,5 ha (pommiers et oliviers) s'est effectuée en septembre 2010...
Le verger de Donadille appartient au lycéee agricole de Nîmes-Rodilhan. Il est situé en bordure d'un ruisseau (Le Buffalon) drainant la nappe de la Vistrenque (nappe classée depuis 1994 en « zone vulnérable aux nitrates d'origine agricole » selon la directive nitrate de 1991). La conversion en AB des 6,5 ha (pommiers et oliviers) s'est effectuée en septembre 2010...
Objectif
Montrer l'impact sur la qualité de l'eau de la conversion à l'AB d'un verger de pommiers jusque là mené selon les principes de l'agriculture raisonnée (Global Gap).
Montrer l'impact sur la qualité de l'eau de la conversion à l'AB d'un verger de pommiers jusque là mené selon les principes de l'agriculture raisonnée (Global Gap).
Description de l'action
Recherche des pesticides (ainsi que du nitrate et du cuivre) présents dans l'eau de percolation, sous le verger de pommiers, avant et après conversion.
Protocole prévu :
- prélèvement d'eau à l'aplomb du verger à l'aide de bougies
poreuses (14 bougies poreuses implantées), de pompes à vide et de flacons de prélèvement
- constitution de 2 échantillons : l'un d'eau prélevée à 30 cm, l'autre d'eau prélevée à 100 cm.
- Volume nécessaire en 1ère année : 5 litres par échantillon (analyses
complexes nécessitant plusieurs passages sur le spectrophotomètre).
Recherche des pesticides (ainsi que du nitrate et du cuivre) présents dans l'eau de percolation, sous le verger de pommiers, avant et après conversion.
Protocole prévu :
- prélèvement d'eau à l'aplomb du verger à l'aide de bougies
poreuses (14 bougies poreuses implantées), de pompes à vide et de flacons de prélèvement
- constitution de 2 échantillons : l'un d'eau prélevée à 30 cm, l'autre d'eau prélevée à 100 cm.
- Volume nécessaire en 1ère année : 5 litres par échantillon (analyses
complexes nécessitant plusieurs passages sur le spectrophotomètre).
Utilisation pédagogique
Les BTSA GEMEAU du lycée et du CFA ont suivi cette démonstration :
- implantation des bougies poreuses par les BTSA GEMEAU du lycée et leurs
professeurs (agronomie, hydrologie)
- prélèvement d'eau par les BTSA GEMEAU du lycée
- analyse d'eau par les BTSA GEMEAU du CFA et leur professeur de chimie
- analyse des résultats par les BTSA GEMEAU du lycée et leurs professeurs
(hydrologie, agronomie, maths...)
Les BTSA GEMEAU du lycée et du CFA ont suivi cette démonstration :
- implantation des bougies poreuses par les BTSA GEMEAU du lycée et leurs
professeurs (agronomie, hydrologie)
- prélèvement d'eau par les BTSA GEMEAU du lycée
- analyse d'eau par les BTSA GEMEAU du CFA et leur professeur de chimie
- analyse des résultats par les BTSA GEMEAU du lycée et leurs professeurs
(hydrologie, agronomie, maths...)
Autre valorisation
- journées portes ouvertes de l'établissement
- actions de démonstration auprès des autres apprenants et stagiaires, et auprès d'agriculteurs locaux
Calendrier
Molécules recherchées :
. cuivre
. liste CERPE régionale*
. molécules utilisées avant la conversion du verger
. cuivre
. liste CERPE régionale
. cuivre
. molécules de la liste CERPE retrouvées en année 0
Dates de prélèvements :
Trois périodes ont été retenues :
* CERPE : Cellule d'Etude et de Recherche sur la pollution des Eaux par les Produits Phytosanitaires, présente dans chaque région elle est copilotée par la DRAAF et la DREAL.
Molécules recherchées :
- en Mai 2010 avant la conversion (point 0) :
. cuivre
. liste CERPE régionale*
- en Octobre 2010 (la conversion ayant démarré en Septembre
. molécules utilisées avant la conversion du verger
. cuivre
. liste CERPE régionale
- pendant la conversion (années 1, 2, 3) :
. cuivre
. molécules de la liste CERPE retrouvées en année 0
Dates de prélèvements :
Trois périodes ont été retenues :
- en Février : avant les traitements
- au printemps : Avril-Mai, en pleine période de traitement
- à l'automne au moment des fortes pluies
* CERPE : Cellule d'Etude et de Recherche sur la pollution des Eaux par les Produits Phytosanitaires, présente dans chaque région elle est copilotée par la DRAAF et la DREAL.
Perspective
Participation envisagée au RMT DEVAB
Participation envisagée au RMT DEVAB
Partenariats techniques/financiers
techniques :
techniques :
- CEMAGREF de Lyon (équipe pollutions diffuses)
- DREAL Languedoc-Roussillon
- INRA de Mirecourt
- Syndicat de nappe Costières-Vistrenque
- Agence de l'eau RMC (Projet «De nouvelles idées pour développer l'agriculture biologique et réduire la pollution de l'eau par les pesticides»)
- Conseil régional LR (lycée 21)
Fichier : fichierinitiative1_fiche_demo_eau.pdf
Télécharger
Création d’un système expérimental de pompage par bélier hydraulique (Vienne - Isère)
Nom de la structure
EPLEFPA AGROTEC de Vienne-Seyssuel
Téléphone
04 74 85 18 63
Contact (courriel)
olivier.tardy@educagri.fr
Contact2 (courriel)
sophie.bruder@educagri.fr
Contact3 (courriel)
remi.gueorgiou@educagri.fr
Site Web
http://www.vienne.educagri.fr/
Code postal
38217
Ville
Vienne
Département
Isère
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- international
- systèmes de culture
Contexte
Le pôle de ressources Aménagement et gestion des eaux de l'établissement AGROTEC (qui bénéficie du dispositif "tiers-temps" de la DGER du ministère de l'agriculture sur 2012-2015) souhaite compléter ses installations hydrotechniques de formation professionnelle par le projet expérimental Hydro Ram, en collaboration avec l'ONG Hydraulique Sans Frontières (le mot ram signifie bélier en anglais). Il s'agit de créer un système de pompage robuste, peu onéreux et autonome en énergie fondé sur l’utilisation de béliers
hydrauliques, à destination des pays en voie de développement et de l’agriculture en secteurs isolés.
Le pôle de ressources Aménagement et gestion des eaux de l'établissement AGROTEC (qui bénéficie du dispositif "tiers-temps" de la DGER du ministère de l'agriculture sur 2012-2015) souhaite compléter ses installations hydrotechniques de formation professionnelle par le projet expérimental Hydro Ram, en collaboration avec l'ONG Hydraulique Sans Frontières (le mot ram signifie bélier en anglais). Il s'agit de créer un système de pompage robuste, peu onéreux et autonome en énergie fondé sur l’utilisation de béliers
hydrauliques, à destination des pays en voie de développement et de l’agriculture en secteurs isolés.
Objectif
- humanitaire : aider au développement agricole et à l’accès à l’eau de populations isolées
- écologique : utiliser un système économe en énergie, permettre une autonomie de maintenance
- pédagogique : créer une installation support de projets de recherche et de travaux pratiques
Description de l'action
Fondé sur le phénomène physique du coup de bélier (amplifié pour générer un mouvement continu de pompage par oscillations hydrauliques, le projet Hydro Ram vise à rendre son usage plus simple pour aider l’agriculture dans les pays en voie de développement ou dans des secteurs agricoles isolés : simplicité des pièces et de la maintenance, usage de canalisations semi-rigides en polyéthylène (facilement disponibles sur le marché et d’une mise en œuvre aisée), fourniture d'un outil de pré-dimensionnement pour aider à la préparation des chantiers. Seul le clapet de choc, au cœur du bélier, sera développé afin de maîtriser à distance l’assistance technique et de réduire les coûts.
Des élèves-ingénieurs de l’École nationale supérieure des arts et métiers de Cluny et de l’École nationale supérieure de l’énergie, de l’eau et de l’environnement de Grenoble apportent également leur réflexion sur le projet.
Phases :
Validation du concept : canalisations semi-rigides, pièces standard.
Vérification de la conception et de la modélisation théorique (en lien avec les projets travaillés à l’ENSAM et l’ENSE3).
Tenue en endurance du système de pompage, notamment le clapet de choc.
Caractérisation des performances : rendement, débit.
Installation du prototype sur le site (avec prise d'eau et bassins intermédiaires sur le cours d'eau et alimentation d'une fontaine et branchement sur le réseau d'irrigation)
Expérimentation et exploitation des données
Développement et diffusion
Fondé sur le phénomène physique du coup de bélier (amplifié pour générer un mouvement continu de pompage par oscillations hydrauliques, le projet Hydro Ram vise à rendre son usage plus simple pour aider l’agriculture dans les pays en voie de développement ou dans des secteurs agricoles isolés : simplicité des pièces et de la maintenance, usage de canalisations semi-rigides en polyéthylène (facilement disponibles sur le marché et d’une mise en œuvre aisée), fourniture d'un outil de pré-dimensionnement pour aider à la préparation des chantiers. Seul le clapet de choc, au cœur du bélier, sera développé afin de maîtriser à distance l’assistance technique et de réduire les coûts.
Des élèves-ingénieurs de l’École nationale supérieure des arts et métiers de Cluny et de l’École nationale supérieure de l’énergie, de l’eau et de l’environnement de Grenoble apportent également leur réflexion sur le projet.
Phases :
Validation du concept : canalisations semi-rigides, pièces standard.
Vérification de la conception et de la modélisation théorique (en lien avec les projets travaillés à l’ENSAM et l’ENSE3).
Tenue en endurance du système de pompage, notamment le clapet de choc.
Caractérisation des performances : rendement, débit.
Installation du prototype sur le site (avec prise d'eau et bassins intermédiaires sur le cours d'eau et alimentation d'une fontaine et branchement sur le réseau d'irrigation)
Expérimentation et exploitation des données
Développement et diffusion
Utilisation pédagogique
par tous les apprenants de l'établissement (BTS GEMEAU, licences professionnelles) et les stagiaires de formation continue...
par tous les apprenants de l'établissement (BTS GEMEAU, licences professionnelles) et les stagiaires de formation continue...
Autre valorisation
en lien avec les actions de l'association Hydraulique Sans Frontières
en lien avec les actions de l'association Hydraulique Sans Frontières
Calendrier
Démarrage du projet en 2016
Démarrage du projet en 2016
Partenariats techniques/financiers
- acteurs institutionnels (Région Rhône-Alpes et collectivités du Pays Viennois),
- économiques (industriels, entreprises de travaux, gestionnaires de réseaux)
- de la recherche et de la formation (écoles d’ingénieurs, associations, bureaux d’études)
Fichier : fichierinitiative1_HydroRam_diaporama_projet.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative2_HydroRam_poster_projet.pdf
Télécharger

Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates (Somme-Vesle - Marne / Rethel - Ardennes)
Nom de la structure
EPLEFPA de RETHEL - EPLEFPA de Somme-Vesle
Téléphone
03 24 39 60 00
Contact (courriel)
Etienne.ROUSSEL@educagri.fr
Contact2 (courriel)
Gerard.POIRSON@educagri.fr
Site Web
http://www.lyceeagricole-rethel.fr
Code postal
08300
Ville
Rethel
Département
Ardennes
Type d'initiative
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
Le travail a porté sur l'intérêt des CIPAN pour limiter l'impact d'intercultures présentant des risques importants pour la qualité de l'eau. Les deux situations étudiées sont des situations fréquentes dans les petites régions agricoles où se situent les exploitations.
Le travail a porté sur l'intérêt des CIPAN pour limiter l'impact d'intercultures présentant des risques importants pour la qualité de l'eau. Les deux situations étudiées sont des situations fréquentes dans les petites régions agricoles où se situent les exploitations.
Description de l'action
Deux types d'intercultures ont été étudiées :
Deux types d'intercultures ont été étudiées :
- l'interculture pois-blé où la légumineuse laisse une quantité importante d'azote minéral dans le sol à la récolte
- l'interculture blé-betterave, avec épandage de matière organique pendant l'interculture.
Résultats
Dans le cadre de l'interculture pois-blé, les CIPAN n'ont pas d'impact sur le rendement en grain du blé (ni sur le taux de protéine). Les CIPAN ont confirmé leur intérêt environnemental en réduisant en moyenne chaque année, de 70 a 100 kg/ha d'azote minéral lessivé pendant l'hiver. L'implantation d'une CIPAN dans le cadre de l'interculture blé-betteraves avec épandage de matière organique permet d'épurer le sol de 70 kg/ha d'azote lors de sa destruction en décembre et de piéger 50 kg/ha d'azote en moyenne dans son appareil végétatif. Il n'y a pas eu d'impact sur le rendement de la betterave.
Dans le cadre de l'interculture pois-blé, les CIPAN n'ont pas d'impact sur le rendement en grain du blé (ni sur le taux de protéine). Les CIPAN ont confirmé leur intérêt environnemental en réduisant en moyenne chaque année, de 70 a 100 kg/ha d'azote minéral lessivé pendant l'hiver. L'implantation d'une CIPAN dans le cadre de l'interculture blé-betteraves avec épandage de matière organique permet d'épurer le sol de 70 kg/ha d'azote lors de sa destruction en décembre et de piéger 50 kg/ha d'azote en moyenne dans son appareil végétatif. Il n'y a pas eu d'impact sur le rendement de la betterave.
Utilisation pédagogique
Les apprenants ont participé à la mise en place de l'action de démonstration et à son suivi.
Les apprenants ont participé à la mise en place de l'action de démonstration et à son suivi.
Autre valorisation
L'action a été présentée dans le cadre des journées portes ouvertes.
L'action a été présentée dans le cadre des journées portes ouvertes.
Calendrier
action terminée (2004-2007)
action terminée (2004-2007)
Partenariats techniques/financiers
Action intégrée dans le cadre du réseau des exploitations des EPLEFPA de Champagne-Ardenne
Action intégrée dans le cadre du réseau des exploitations des EPLEFPA de Champagne-Ardenne
- Agence de l'Eau Seine-Normandie
- Institut technique de la betterave
- INRA
- Chambres d'agriculture de la Marne et des Ardennes
- CHPTE de Liège, CARAH de Ath, instituts belges de formation agricole, etc.
Fichier : fichierinitiative1_poster_Rethel-Somme_CIPAN.pdf
Télécharger
Débattre sur l'eau, l'agriculture et les changements climatiques avec le dispositif pédagogique "Comm'un débat" (Limoges - Haute Vienne)
Nom de la structure
EPLEFPA de Limoges et du Nord Hte Vienne - EPLEFPA de Montmorillon (Vienne) - EPLEFPA de Bressuire (Deux-Sèvres)
Téléphone
05 55 48 44 00
Contact (courriel)
celine.thibault@educagri.fr
Contact2 (courriel)
noemie.ouvrard@agriculture.gouv.fr
Contact3 (courriel)
marc.beteau@ifree.asso.fr
Code postal
87430
Ville
Verneuil-sur-Vienne
Département
Haute-Vienne
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- économie d'eau
- milieu naturel
- qualité de l'eau
Contexte
Les enjeux de préservation de la ressource en eau, en qualité et en quantité, sont accrus avec le contexte de changement climatique. Les acteurs des territoires y ont un rôle majeur à jouer, autant par une prise de conscience de l’impact de leurs pratiques que par leur participation à une meilleure gestion commune. En tant que futurs professionnels, les apprenants des établissements d’enseignement agricole sont directement concernés par la gestion de cette ressource et des tensions qu’elle suscite autour de l’accroissement des usages. Les préparer à dialoguer autour de ces enjeux, c’est leur donner les moyens d’adapter dans la durée et surtout d'anticiper leurs actions à l’évolution du contexte.
En s’appuyant sur son expérience du dialogue territorial et sur sa pratique éducative, l’Ifrée a impulsé et piloté la conception d'un dispositif de sensibilisation, "Comm'un débat". Une équipe-projet composée d’enseignants de 3 établissements agricoles (Limoges-les-Vaseix, Bressuire et Montmorillon) et de 3 éducateurs à l’environnement (IFREE et CPIE des Pays Creusois) a conçu et testé cette méthodologie de débat pour aboutir à une version opérationnelle pouvant être déployée et expérimentée à plus grande échelle.
En s’appuyant sur son expérience du dialogue territorial et sur sa pratique éducative, l’Ifrée a impulsé et piloté la conception d'un dispositif de sensibilisation, "Comm'un débat". Une équipe-projet composée d’enseignants de 3 établissements agricoles (Limoges-les-Vaseix, Bressuire et Montmorillon) et de 3 éducateurs à l’environnement (IFREE et CPIE des Pays Creusois) a conçu et testé cette méthodologie de débat pour aboutir à une version opérationnelle pouvant être déployée et expérimentée à plus grande échelle.
Objectif
Sensibiliser les apprenants des établissements d’enseignement agricole aux enjeux de l’eau dans un contexte de changements climatiques
Description de l'action
Le dispositif pédagogique est construit autour d'un jeu de rôle :
• Un débat à partir d’une situation-problème concrète (sécheresse estivale extrème, rejets de station d'épuration dépassant les normes, inondations de prairies humides à l'automne,...), chaque élève incarnant un acteur du territoire (éleveur, maire, pêcheur, technicien de rivière,...)
• Débattre pour mieux comprendre la situation, amener les élèves à percevoir l’intérêt de croiser les points de vue
• Amener les élèves à exprimer comment ils comprennent la situation,leurs représentations et pouvoir les confronter dans le respect
• Identifier collectivement les aspects à approfondir pour vérifier leurs affirmations, répondre à leurs questionnements.
Au delà du jeu de rôle : une démarche sur plusieurs séances
• Approfondir collectivement les questions et les aspects soulevées lors du débat : intervenants, recherches documentaires, apports en classe, … (à l'issue du débat, les élèves n'auront pas produit de nouvelles connaissances mais auront verbalisé et confronté leurs représentations, y compris celles erronées ou incomplètes, permettant de travailler dessus pour les faire évoluer)
• Explorer les pistes de solutions possibles en tenant compte de ce que cela implique pour chacun des personnages du jeu
• Analyser ce que le débat aura apporté à chacun (en terme de compréhension des enjeux eau et de dialogue).
Un déroulé sur 4 à 6 séances, s’intégrant dans les différents enseignements existants.
• Un débat à partir d’une situation-problème concrète (sécheresse estivale extrème, rejets de station d'épuration dépassant les normes, inondations de prairies humides à l'automne,...), chaque élève incarnant un acteur du territoire (éleveur, maire, pêcheur, technicien de rivière,...)
• Débattre pour mieux comprendre la situation, amener les élèves à percevoir l’intérêt de croiser les points de vue
• Amener les élèves à exprimer comment ils comprennent la situation,leurs représentations et pouvoir les confronter dans le respect
• Identifier collectivement les aspects à approfondir pour vérifier leurs affirmations, répondre à leurs questionnements.
Au delà du jeu de rôle : une démarche sur plusieurs séances
• Approfondir collectivement les questions et les aspects soulevées lors du débat : intervenants, recherches documentaires, apports en classe, … (à l'issue du débat, les élèves n'auront pas produit de nouvelles connaissances mais auront verbalisé et confronté leurs représentations, y compris celles erronées ou incomplètes, permettant de travailler dessus pour les faire évoluer)
• Explorer les pistes de solutions possibles en tenant compte de ce que cela implique pour chacun des personnages du jeu
• Analyser ce que le débat aura apporté à chacun (en terme de compréhension des enjeux eau et de dialogue).
Un déroulé sur 4 à 6 séances, s’intégrant dans les différents enseignements existants.
Utilisation pédagogique
Une approche en lien avec les enseignements :
• Gestion des ressources naturelles, modes de production et besoins en eau, les choix d’aménagement et la préservation des milieux naturels...
• Les acteurs d’un territoire et leurs interactions, l’éducation à la citoyenneté et au dialogue dans une monde complexe
• L’acquisition de compétences réflexives, d’expression et de mobilisation des connaissances, la prise de parole, l’écoute et la capacité à coopérer
Des cadres d’intervention :
• Le débat en jeu de rôle lors des temps en pluridisciplinarité les stages « territoire » ou l’enseignement socioculturel
• L’approfondissement des notions lors des enseignements concernés par chaque sujet
• La valorisation de cette expérience pédagogique innovante dans le cadre de l’ESC, de la préparation aux épreuves orales
• Gestion des ressources naturelles, modes de production et besoins en eau, les choix d’aménagement et la préservation des milieux naturels...
• Les acteurs d’un territoire et leurs interactions, l’éducation à la citoyenneté et au dialogue dans une monde complexe
• L’acquisition de compétences réflexives, d’expression et de mobilisation des connaissances, la prise de parole, l’écoute et la capacité à coopérer
Des cadres d’intervention :
• Le débat en jeu de rôle lors des temps en pluridisciplinarité les stages « territoire » ou l’enseignement socioculturel
• L’approfondissement des notions lors des enseignements concernés par chaque sujet
• La valorisation de cette expérience pédagogique innovante dans le cadre de l’ESC, de la préparation aux épreuves orales
Autre valorisation
2024 :
. Formation d'enseignants de Nlle Aquitaine sur 2 sessions de formation (janvier)
. Mise en pratique accompagnée par les enseignants formés (janvier à mars)
. Bilan et partage des premières expériences (mai à octobre)
. Enrichissement de l’outil en vue de son édition finale (fin 2024)
fiche pollen
. Formation d'enseignants de Nlle Aquitaine sur 2 sessions de formation (janvier)
. Mise en pratique accompagnée par les enseignants formés (janvier à mars)
. Bilan et partage des premières expériences (mai à octobre)
. Enrichissement de l’outil en vue de son édition finale (fin 2024)
fiche pollen
Calendrier
2021-2023 : conception
2023-2024 : déploiement
2023-2024 : déploiement
Partenariats techniques/financiers
. IFREE (pilotage de projet),
. L'Escuro CPIE des Pays Creusois (co-conception)
. DRAAF Nlle Aquitaine (partenaire technique)
. Financements : Agences de l'eau Loire-Bretagne et région Nlle Aquitaine (conception et déploiement), Agence de l'eau Adour Garonne (déploiement)
. L'Escuro CPIE des Pays Creusois (co-conception)
. DRAAF Nlle Aquitaine (partenaire technique)
. Financements : Agences de l'eau Loire-Bretagne et région Nlle Aquitaine (conception et déploiement), Agence de l'eau Adour Garonne (déploiement)


De la protection d'un captage par la reconception des systèmes de production au développement de filières de valorisation des produits (Bourg-en-Bresse - Ain)
Nom de la structure
EPLEFPA Bourg-en-Bresse
Téléphone
0474455080
Contact (courriel)
mathilde.astier@educagri.fr
Site Web
http://www.sardieres.fr
Code postal
01000
Ville
Bourg-en-Bresse
Département
Ain
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- traitement des effluents
- milieu naturel
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
Le projet "PROCADé" de l'EPLEFPA s’inscrit en complémentarité avec les programmes engagés sur le territoire (Programme Bio et Eau piloté par la communauté d’agglomération de Bourg-en-Bresse, plan d’action protection du bassin d'alimentation de captage de Péronnas et de Lent porté par la ville de Bourg-en-Bresse, contrat de rivière piloté par le Syndicat du Bassin Versant de la Reyssouze). Ces programmes visent à développer des pratiques agricoles et non agricoles contribuant à une bonne qualité de l’eau des zones de captage d’eau potable et rivières, en réduisant les pollutions diffuses en nitrates et pesticides et luttant contre les pesticides d’origine non agricoles. Il bénéficie du financement pour 2017-2020 d'un poste d'ingénieur chef de projet de partenariat par la DGER...
Objectif
- développer sur l'exploitation de l'EPLEFPA et sur le territoire des pratiques agricoles et non agricoles contribuant à une bonne qualité de l’eau des zones de captage d’eau potable et rivières
- valoriser les produits agricoles dans une approche filière
- capitaliser et diffuser vers les acteurs professionnels et en formation
Description de l'action
- axe 1 : réalisation d'une étude socio-technico-économique "état des lieux" sur les pratiques (et changements de pratiques) agricoles sur le territoire
- axe 2 : mise en place d'une plateforme technologique agro-écologie sur l'exploitation (avec notamment acquisition et mise à disposition auprès d'agriculteurs de désherbineuse, herse hétrille, houe rotative)
- axe 3 : mise en place d'une zone tampon humide artificielle (porté par syndicat du bassin-versant de la Reyssouze) sur un cours d'eau, affluent de la Reyssouze, qui passe sur l'exploitation, analyses et suivi
- axe 4 : transfert et pédagogie innovante (co-construction de situations pédagogiques pour accompagner enseignants et formateurs), valorisation des résultats
- axe 5 : développement des filières de transformation/commercialisation pour produits issus de nouvelles pratiques (avec cahier des charges) et AB
Utilisation pédagogique
Le projet permettra de mobiliser l’ensemble des filières de formation de l’établissement pour améliorer les modalités pédagogiques des formations dispensées, les enrichir sur les problématiques liées à la qualité de l’eau tout en favorisant l’innovation pédagogique et l’appui sur les réalités professionnelles locales (avec mise en place de nouveaux modules MAP, MIL, EIE,...).
En particulier, sur 2019-2020, avec un accompagnement de la Bergerie nationale, proposition d'une activité pédagogique innovante "Glyph'eau" auprès des apprentis en 1ère année de BTS ACSE sur deux semaines, avec comme problématique de départ : « agriculture de conservation et glyphosate : que répondre à la société sur la question du glyphosate ? ». Les BTS ACSE ont été sollicités par un agriculteur en agriculture de conservation pour l’aider dans sa communication auprès du grand public. Des temps d’enquêtes et d’échanges auprès d’une diversité d’acteurs ont permis d’explorer la complexité de la controverse et ont permis d’élaborer des réponses, illustrant différentes positions d’acteurs et différentes stratégies de conduite de systèmes de culture, chacune plus ou moins dépendante du glyphosate et plus ou moins durable dans leur rapport aux ressources communes et au territoire. Pour en savoir plus : fiche pollen et film reportage sur l'action
En particulier, sur 2019-2020, avec un accompagnement de la Bergerie nationale, proposition d'une activité pédagogique innovante "Glyph'eau" auprès des apprentis en 1ère année de BTS ACSE sur deux semaines, avec comme problématique de départ : « agriculture de conservation et glyphosate : que répondre à la société sur la question du glyphosate ? ». Les BTS ACSE ont été sollicités par un agriculteur en agriculture de conservation pour l’aider dans sa communication auprès du grand public. Des temps d’enquêtes et d’échanges auprès d’une diversité d’acteurs ont permis d’explorer la complexité de la controverse et ont permis d’élaborer des réponses, illustrant différentes positions d’acteurs et différentes stratégies de conduite de systèmes de culture, chacune plus ou moins dépendante du glyphosate et plus ou moins durable dans leur rapport aux ressources communes et au territoire. Pour en savoir plus : fiche pollen et film reportage sur l'action
Autre valorisation
Journées de démonstration pour les acteurs du territoire, formation en ligne, supports de communication divers,...
page Facebook :Passion Méteil CGEA1
page Facebook :Passion Méteil CGEA1
Calendrier
2017-2020
Partenariats techniques/financiers
Collectivités, DDT, CA 01, Syndicat du bassin-versant de la Reyssouze, URCPIE, ADABIO, Centre de développement de l'agro-écologie, ADEAR Ain, Terre d'alliances, FRAPNA, Société ICARE 2, EPLEFPA de Vienne,...
Agence de l'eau RMC, réseau rural national, LEADER,...
Agence de l'eau RMC, réseau rural national, LEADER,...
Fichier : DeLaProtectionDUnCaptageParLaReconcepti_fichierinitiative1_quoidenouveau_1.pdf
Télécharger
Fichier : DeLaProtectionDUnCaptageParLaReconcepti_fichierinitiative2_glyph-eau_bourgenbresse.pdf
Télécharger
Fichier : DeLaProtectionDUnCaptageParLaReconcepti_fichierinitiative3_glypheau__bourgenbresse_poster.pdf
Télécharger
Fichier : DeLaProtectionDUnCaptageParLaReconcepti_fichierinitiative4_projet_bts_acse_glypho_et_societe.pdf
Télécharger
Lien vers vidéo de présentation (1)
https://www.facebook.com/355554735001868/videos/2318372548439924/
Lien vers vidéo de présentation(2)
https://www.youtube.com/watch?v=8v4-RI3aBb8&feature=youtu.be
Déployer l'atelier eau de l'exploitation comme outil pédagogique dans une démarche agroécologique (Amiens - Somme)
Nom de la structure
EPLEFPA Amiens
Téléphone
03 22 35 30 00
Contact (courriel)
amaury.deletombe@educagri.fr
Contact2 (courriel)
aurelie.parnet@educagri.fr
Contact3 (courriel)
michel.bellanger@educagri.fr
Site Web
http://www.leparacletamiens.fr
Code postal
80440
Ville
Cottenchy
Département
Somme
Type d'initiative
- traitement des effluents
- milieu naturel
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
L'exploitation agricole du lycée Le Paraclet d'Amiens comporte l'unique atelier eau de l'ensemble des exploitations des lycées agricoles français. Cet atelier est composé d'un captage (puits réhabilité en 2003) situé au coeur du système de polyculture élevage de l'exploitation, d'une station de traitement (désinfection au chlore), d'un réservoir semi-enterré, d'ouvrages de distribution d'eau potable (vers l'EPL 500 equivalents-habitants, le centre équestre, l'AFB - ex ONEMA - et le village de Fouencamps 200 équivalents habitants), d'un réseau de collecte et d?une station de traitement des eaux par un système de lagunage de 2 500 m2 (opérationnel depuis 1996).
Aujourd'hui, une réflexion partagée de cet atelier mérite d'être réalisée de façon à s'inscrire durablement sur un territoire périurbain en extension où les enjeux liés à l'eau à proximité d'Amiens sont des atouts supplémentaires.
De 2016 à 2019, grâce au dispositif Tiers temps de la DGER, l'EPL souhaite intégrer et développer l'atelier eau, en lien avec les autres grands projets structurants de l'exploitation...
Aujourd'hui, une réflexion partagée de cet atelier mérite d'être réalisée de façon à s'inscrire durablement sur un territoire périurbain en extension où les enjeux liés à l'eau à proximité d'Amiens sont des atouts supplémentaires.
De 2016 à 2019, grâce au dispositif Tiers temps de la DGER, l'EPL souhaite intégrer et développer l'atelier eau, en lien avec les autres grands projets structurants de l'exploitation...
Objectif
- renforcer l'outil pédagogique
- établir un diagnostic des installations et du fonctionnement de l'atelier
- mettre en oeuvre un plan d'actions hiérarchisées par ordre de priorité s'appuyant sur le diagnostic réalisé
- communiquer sur l'atelier et les actions entreprises
- déployer des actions communes sur le territoire
- établir un diagnostic des installations et du fonctionnement de l'atelier
- mettre en oeuvre un plan d'actions hiérarchisées par ordre de priorité s'appuyant sur le diagnostic réalisé
- communiquer sur l'atelier et les actions entreprises
- déployer des actions communes sur le territoire
Description de l'action
1/ utilisation pédagogique :
- avec les BTSA GEMEAU : utilisation de la lagune1 comme support d'opérations topographiques lors de TP de M56, remise en place du suivi du fonctionnement du lagunage (achat d'équipement d'analyse), remise en place du suivi du service d'eau potable, relevé des compteurs de sectorisation et interprétation des relevés, faucardage de la lagune 3, poursuite du diagnostic du système d'assainissement, de production et de distribution d'eau potable et de dimensionnement d'ouvrages dans le cadre des projets techniques M54, séance de travaux dirigés sur le dimensionnement du poste de relèvement de la lagune
- avec les BTSA Anabiotec et GEMEAU : analyses de la qualité des eaux usées en entrée et en sortie des lagunes
- avec les bac S : visites des différents ouvrages de l'atelier, comme support de cours sur le cycle de l'eau, de la ressource au rejet dans le milieu naturel
2/ diagnostics :
- définition et clarification des responsabilités des différents acteurs de la production, de la distribution et de l'épuration des eaux entre l'EPL, la commune de Cottenchy et le conseil régional Hauts de France
- réponse aux obligations règlementaires des services d'eau et d'assainissement : sécurité sanitaire de l'alimentation en eau potable, amélioration de la connaissance patrimoniale du réseau et des ouvrages (en s'appuyant notamment sur le système d'information géographique de l'établissement), mise en conformité des matériaux (plomb, PVC,...), conformité des rejets dans l'environnement, établissement de l'état zéro du fonctionnement du lagunage, planification de l'entretien des réseaux, ouvrages et lagunages, rédaction du rapport sur le prix et la qualité du service d'eau potable
- optimisation de la conservation et de l'exploitation des données
3/ plan d'actions
mise en place d'un comité de pilotage (partenaires internes et externes) pour travailler sur la sécurisation des installations de stockage de l'eau potable, sur la réhabilitation de certains équipements voire l'investissement dans le remplacement des équipements les plus vétustes, sur l'investissement dans des outils de suivi, sur le calcul du prix de revient de la production et de la distribution de l'eau potable et de la collecte et du traitement des eaux usées, sur la mise en place d'indicateurs de suivi techniques et financiers et de procédures de suivi, sur la rédaction d'un rapport sur la qualité des services d'eau et d'assainissement ?
4/ communication et diffusion sur le territoire
en lien avec le projet "enseigner à produire autrement", approche système des nouvelles techniques agronomiques (agroforesterie, réduction des intrants, gestion des effluents d'élevage, etc), souple et adaptable pour une préservation de la ressource eau au sein des exploitations agricole des systèmes de polyculture élevage. Cette action participe d'une dynamique partenariale d'accompagnement du changement des cadres de pensée au travers la faisabilité d'un Groupement d'intérêt économique, environnemental et forestier sur le territoire...
- avec les BTSA GEMEAU : utilisation de la lagune1 comme support d'opérations topographiques lors de TP de M56, remise en place du suivi du fonctionnement du lagunage (achat d'équipement d'analyse), remise en place du suivi du service d'eau potable, relevé des compteurs de sectorisation et interprétation des relevés, faucardage de la lagune 3, poursuite du diagnostic du système d'assainissement, de production et de distribution d'eau potable et de dimensionnement d'ouvrages dans le cadre des projets techniques M54, séance de travaux dirigés sur le dimensionnement du poste de relèvement de la lagune
- avec les BTSA Anabiotec et GEMEAU : analyses de la qualité des eaux usées en entrée et en sortie des lagunes
- avec les bac S : visites des différents ouvrages de l'atelier, comme support de cours sur le cycle de l'eau, de la ressource au rejet dans le milieu naturel
2/ diagnostics :
- définition et clarification des responsabilités des différents acteurs de la production, de la distribution et de l'épuration des eaux entre l'EPL, la commune de Cottenchy et le conseil régional Hauts de France
- réponse aux obligations règlementaires des services d'eau et d'assainissement : sécurité sanitaire de l'alimentation en eau potable, amélioration de la connaissance patrimoniale du réseau et des ouvrages (en s'appuyant notamment sur le système d'information géographique de l'établissement), mise en conformité des matériaux (plomb, PVC,...), conformité des rejets dans l'environnement, établissement de l'état zéro du fonctionnement du lagunage, planification de l'entretien des réseaux, ouvrages et lagunages, rédaction du rapport sur le prix et la qualité du service d'eau potable
- optimisation de la conservation et de l'exploitation des données
3/ plan d'actions
mise en place d'un comité de pilotage (partenaires internes et externes) pour travailler sur la sécurisation des installations de stockage de l'eau potable, sur la réhabilitation de certains équipements voire l'investissement dans le remplacement des équipements les plus vétustes, sur l'investissement dans des outils de suivi, sur le calcul du prix de revient de la production et de la distribution de l'eau potable et de la collecte et du traitement des eaux usées, sur la mise en place d'indicateurs de suivi techniques et financiers et de procédures de suivi, sur la rédaction d'un rapport sur la qualité des services d'eau et d'assainissement ?
4/ communication et diffusion sur le territoire
en lien avec le projet "enseigner à produire autrement", approche système des nouvelles techniques agronomiques (agroforesterie, réduction des intrants, gestion des effluents d'élevage, etc), souple et adaptable pour une préservation de la ressource eau au sein des exploitations agricole des systèmes de polyculture élevage. Cette action participe d'une dynamique partenariale d'accompagnement du changement des cadres de pensée au travers la faisabilité d'un Groupement d'intérêt économique, environnemental et forestier sur le territoire...
Utilisation pédagogique
cf. ci dessus
Calendrier
2016-2019
Perspective
1/ utilisation pédagogique :
- avec les BTSA GEMEAU : TP sur le caractère entartrant d'une eau à partir de l'eau du captage, écoulement de la nappe à partir des mesures de sa piézométrie sur le terrain
- avec les BTSA Anabiotec : participation au suivi des ouvrages de l'atelier pour l'analyse des effluents de la lagune et de l'eau potable en support du suivi des ouvrages.
- avec les bac STAV : projet d'aménagement sur les berges de la Noye ou sur les étangs du Paraclet en 2017
2/ transfert de la compétence eau et assainissement à une autre structure intercommunale (syndicat des eaux) sans pour autant perdre la vocation pédagogique de l?atelier
3/ réalisation de capsules vidéos pédagogiques, expliquant le fonctionnement des ouvrages de l'atelier, à intégrer sur le site internet de l'établissement
- avec les BTSA GEMEAU : TP sur le caractère entartrant d'une eau à partir de l'eau du captage, écoulement de la nappe à partir des mesures de sa piézométrie sur le terrain
- avec les BTSA Anabiotec : participation au suivi des ouvrages de l'atelier pour l'analyse des effluents de la lagune et de l'eau potable en support du suivi des ouvrages.
- avec les bac STAV : projet d'aménagement sur les berges de la Noye ou sur les étangs du Paraclet en 2017
2/ transfert de la compétence eau et assainissement à une autre structure intercommunale (syndicat des eaux) sans pour autant perdre la vocation pédagogique de l?atelier
3/ réalisation de capsules vidéos pédagogiques, expliquant le fonctionnement des ouvrages de l'atelier, à intégrer sur le site internet de l'établissement
Partenariats techniques/financiers
Commune de Cottenchy, inter-communlaité, conseil régional, ARS, société SPEE (Service de Proximité de l'Eau et de l'Environnement), SATESE, Agence de l'eau Artois-Picardie
Désherbage mixte sur culture de maïs (St Pouange - Aube / Rethel - Ardennes)
Nom de la structure
EPLEFPA de RETHEL - EPLEFPA de Saint-Pouange
Téléphone
03 24 39 60 00
Contact (courriel)
Etienne.ROUSSEL@educagri.fr
Contact2 (courriel)
Mickael.FLOQUET@educagri.fr
Site Web
http://www.lyceeagricole-rethel.fr
Code postal
08300
Ville
Rethel
Département
Ardennes
Type d'initiative
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
Le désherbinage est une technique de désherbage associant un apport d'herbicide sur le rang de la culture à un binage mécanique entre les rangs.
Le désherbinage est une technique de désherbage associant un apport d'herbicide sur le rang de la culture à un binage mécanique entre les rangs.
Description de l'action
Deux exploitations d'EPLEFPA ont mis en place un essai afin d'évaluer la réduction d'herbicide utilisé par hectare et mesurer l'impact technico-économique de ce système de gestion des adventices sur une exploitation (incidences sur le calendrier de travail et sur la récolte en quantité et en qualité).
Deux exploitations d'EPLEFPA ont mis en place un essai afin d'évaluer la réduction d'herbicide utilisé par hectare et mesurer l'impact technico-économique de ce système de gestion des adventices sur une exploitation (incidences sur le calendrier de travail et sur la récolte en quantité et en qualité).
Résultats
La pression adventice a été maîtrisée par le désherbinage sur les deux sites expérimentaux. Il semblerait que le maïs en zone binée soit plus vigoureux qu'en zone désherbée chimiquement, mais ce constat reste à confirmer par un suivi spécifique. L'amortissement d'une désherbineuse implique de traiter une surface de 88.5 ha de maïs par an, ce qui implique un investissement en commun.
La pression adventice a été maîtrisée par le désherbinage sur les deux sites expérimentaux. Il semblerait que le maïs en zone binée soit plus vigoureux qu'en zone désherbée chimiquement, mais ce constat reste à confirmer par un suivi spécifique. L'amortissement d'une désherbineuse implique de traiter une surface de 88.5 ha de maïs par an, ce qui implique un investissement en commun.
Utilisation pédagogique
Les apprenants ont participé a la mise en place de l'action de démonstration et à son suivi.
Les apprenants ont participé a la mise en place de l'action de démonstration et à son suivi.
Autre valorisation
L'action a été présentée dans le cadre des journées portes ouvertes.
L'action a été présentée dans le cadre des journées portes ouvertes.
Calendrier
action terminée (2005-2007)
action terminée (2005-2007)
Partenariats techniques/financiers
Action intégrée dans le cadre du réseau des exploitations des EPLEFPA de Champagne-Ardenne
Action intégrée dans le cadre du réseau des exploitations des EPLEFPA de Champagne-Ardenne
- Agence de l'Eau Seine-Normandie
- Conseil Régional de Champagne-Ardenne
Fichier : fichierinitiative1_poster_Rethel-StPouange_desherbinage.pdf
Télécharger
Dispositif agronomique innovant en élevage bovin (Dax - Landes)
Nom de la structure
EPL des Landes - LEGTA de Dax - Oeyreluy
Téléphone
05.58.98.70.33
Contact (courriel)
laurent.lescoulie@educagri.fr
Site Web
http://www.formagri40.fr
Code postal
40180
Ville
HEUGAS
Département
Landes
Type d'initiative
- économie d'eau
- milieu naturel
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
L'agriculture du Sud-ouest est fortement basée sur la monoculture du maïs pour une valorisation dans les élevages de palmipèdes, poulets ou bovins. Dans un contexte de restriction de quotas d'irrigation sur le département, l'exploitation agricole de l'EPL (70 ha), en production bovine allaitante, s'engage dans la limitation de la consommation d'eau et de produits phytosanitaires contaminants, en proposant un système agronomique global innovant.
L'agriculture du Sud-ouest est fortement basée sur la monoculture du maïs pour une valorisation dans les élevages de palmipèdes, poulets ou bovins. Dans un contexte de restriction de quotas d'irrigation sur le département, l'exploitation agricole de l'EPL (70 ha), en production bovine allaitante, s'engage dans la limitation de la consommation d'eau et de produits phytosanitaires contaminants, en proposant un système agronomique global innovant.
Description de l'action
- arrêt de l'irrigation (depuis 2007) et quasi-abandon de la culture du maïs, au profit de la rotation de cultures (méteil, pois, féverole) et du développement de prairies (pour l'alimentation des bovins)
- diminution drastique de l'utilisation de produits phytosanitaires
- implantation d'une aire de lavage du matériel agricole
- exploitation des parcelles Natura 2000 en pâturage (MAE)
- remplacement des clôtures barbelées par des clôtures permettant un débroussaillage mécanique (épareuse) et abandon du désherbage chimique
Résultats
Cette nouvelle approche a permis également une diminution des dépenses (alimentation importée, intrants,...), participant au bon état financier de l'exploitation aujourd'hui...
Cette nouvelle approche a permis également une diminution des dépenses (alimentation importée, intrants,...), participant au bon état financier de l'exploitation aujourd'hui...
Utilisation pédagogique
Tous les apprenants sont impliqués et sensibilisés, dans le cadre de leur formation ou de mini-stages su l'exploitation (5 500 heure-élève/an)
Tous les apprenants sont impliqués et sensibilisés, dans le cadre de leur formation ou de mini-stages su l'exploitation (5 500 heure-élève/an)
Autre valorisation
- stages d'élèves ingénieurs (ENITA,...)
- vulgarisation et diffusion auprès des professionnels (journées techniques herbe, réseau de fermes de référence…)
- article site adt.educagri.fr
Perspective
- mise en place d'un phytobac
- installation de passages canadiens sur les prairies en zone Natura 2000
Partenariats techniques/financiers
- Chambre d'Agriculture des Landes
- DRAAF Nouvelle Aquitaine
- Conseil régional Nouvelle Aquitaine (mesures AREA)
Fichier : fichierinitiative1_Pres_exploit_Dax_2016.pdf
Télécharger
Lien vers vidéo de présentation (1)
http://dai.ly/x52eqac
Eau et coopération internationale (Nîmes - Gard)
Nom de la structure
EPLEFPA de Nîmes-Rodilhan
Téléphone
04 66 20 67 67
Contact (courriel)
Riadh.Ourabah@educagri.fr
Site Web
http://www.epl.nimes.educagri.fr
Code postal
30230
Ville
Rodilhan
Département
Gard
Type d'initiative
- international
Contexte
Dans le cadre de la mission "coopération internationale", le lycée développe des actions sur le thème de l'eau, en particulier au Maroc, au Yémen, en Egypte,...
Dans le cadre de la mission "coopération internationale", le lycée développe des actions sur le thème de l'eau, en particulier au Maroc, au Yémen, en Egypte,...
Description de l'action
- Yemen (2004-2010) : aide à la prise en compte des nouvelles techniques d'irrigation dans les référentiels, formation de formateurs, création d'un réseau d'échange pédagogique entre les établissements agricoles du pays, création d'un hall hydraulique, jumelage lycée de Nîmes/institut de Sardoud...
- Maroc (depuis 2008) : chantiers de réparation de digues et de réseaux, sensibilisation des populations à la qualité bactériologique de l'eau et à la chloration, en partenariat avec une association de protection de l'environnement de la vallée du Sous (ARPE)...
Utilisation pédagogique
- Voyages d'étude/chantier des étudiants de BTSA GEMEAU
- quelques étudiants réalisent leur stage professionnel à l'étranger
- PIC livraison de matériel agricole, don d'ambulance...
Autre valorisation
- journées des portes ouvertes de l'EPLEFPA
- parents d'élèves
Perspective
Développement d'actions de coopération en Egypte, Brésil, Paraguay, Tunisie,...
Développement d'actions de coopération en Egypte, Brésil, Paraguay, Tunisie,...
Partenariats techniques/financiers
- Ambassades
- Association Hydraulique sans frontière
Fichier : fichierinitiative1_Maroc_Nimes.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative2_Yemen_Nimes.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative3_Yemen_articleML_13nov07.pdf
Télécharger
Echange européen COMENIUS "Eau de vie" (La Tour Blanche - Gironde)
Nom de la structure
EPLEFPA de Gironde-LPA de La Tour Blanche
Téléphone
05 57 98 02 70
Contact (courriel)
fabienne.use@educagri.fr
Contact2 (courriel)
elisabeth.perret@educagri.fr
Code postal
33210
Ville
Langon
Département
Gironde
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- international
Contexte
Une action de coopération internationale multilatéral COMENIUS sur le thème de l'eau intitulé UISCHE BATHA (Eau de vie) a débuté à La Tour Blanche en septembre 2009.
Les partenaires de ce projet sont l'Irlande, l'Espagne et L'Autriche, La Tour Blanche étant porteur de ce projet.
Une action de coopération internationale multilatéral COMENIUS sur le thème de l'eau intitulé UISCHE BATHA (Eau de vie) a débuté à La Tour Blanche en septembre 2009.
Les partenaires de ce projet sont l'Irlande, l'Espagne et L'Autriche, La Tour Blanche étant porteur de ce projet.
Objectif
- sensibiliser l'ensemble des acteurs du Lycée sur l'importance de préserver une ressource essentielle à la vie : l'eau.
- mettre en ouvre des actions concrètes permettant de limiter notre consommation.
- étudier, pour chaque pays partenaire, l'impact de l'homme sur sa petite région et plus particulièrement sur une problématique qui lui est propre.
Description de l'action
- Le Lycée La Tour Blanche met en valeur l'impact potentiel de l'homme sur le Ciron, petit cours d'eau à préserver sachant qu'il est à l'origine du développement de la pourriture noble essentielle pour l'élaboration des vins blancs liquoreux. La réalisation d'une maquette du Ciron permet de visualiser les différentes cultures et l'élevage piscicole susceptible de modifier l'écosystème.
- le lycée viticole de Sant Sadurni d'Ancia, près de Barcelone en Espagne, travaille plus particulièrement sur le manque d'eau et sur les différents traitements possibles pour rendre l'eau potable (traitement de dessalement...)
- le collège Saint Patrick de Belfast en Irlande met en avant l'impact d'une distillerie (Bulmish) et de ses effluents sur la mer.
- Le lycée viticole d'Eisenstach en Autriche étudie l'impact de l'homme sur le lac qui comme dans le Sauternais permet le développement de la pourriture noble.
Résultats
A La Tour Blanche, 13 écodélégués se sont portés volontaires pour être acteurs dans ce projet.
Lors du premier trimestre, ces écodélégués ont été sensibilisés à l'importance de la préservation de cette ressource essentielle qui est l'eau.
Pour ce faire, ils ont visité la station d'épuration du clos de Hilde à Bordeaux après avoir informé par la maison de l'eau sur les différentes modalités de l'extraction de l'eau, de son utilisation et des différents traitements des effluents.
Un géologue avec une approche plus scientifique leur a présenté les eaux souterraines au sein de notre petite région.
Ils ont également répertorié la consommation d'eau au sein du Lycée et élaboré la maquette de la goutte d'eau.
Un parcours du Ciron avec M.Irola responsible du SAGE leur a permis de visualiser ce cours d'eau en vue d'élaborer une maquette.
A La Tour Blanche, 13 écodélégués se sont portés volontaires pour être acteurs dans ce projet.
Lors du premier trimestre, ces écodélégués ont été sensibilisés à l'importance de la préservation de cette ressource essentielle qui est l'eau.
Pour ce faire, ils ont visité la station d'épuration du clos de Hilde à Bordeaux après avoir informé par la maison de l'eau sur les différentes modalités de l'extraction de l'eau, de son utilisation et des différents traitements des effluents.
Un géologue avec une approche plus scientifique leur a présenté les eaux souterraines au sein de notre petite région.
Ils ont également répertorié la consommation d'eau au sein du Lycée et élaboré la maquette de la goutte d'eau.
Un parcours du Ciron avec M.Irola responsible du SAGE leur a permis de visualiser ce cours d'eau en vue d'élaborer une maquette.
Utilisation pédagogique
De 2009 à 2011, des séjours d'une semaine ont été organisés dans les quatre pays pour déboucher sur une ultime semaine organisée à La Tour Blanche.
ces rencontres ont permis de mutualiser, de faire part de l'état d'avancement du projet dans chacun des pays partenaires et de découvrir des cultures différentes pour une plus grande ouverture au monde.
De 2009 à 2011, des séjours d'une semaine ont été organisés dans les quatre pays pour déboucher sur une ultime semaine organisée à La Tour Blanche.
ces rencontres ont permis de mutualiser, de faire part de l'état d'avancement du projet dans chacun des pays partenaires et de découvrir des cultures différentes pour une plus grande ouverture au monde.
Autre valorisation
- ces échanges favorisent des apprentissages linguistiques
- la mutualisation des recherches effectuées dans les différents pays partenaires a permis l'élaboration de plaquettes de sensibilisation communes
- réalisation d'un journal des écodélégués spécial (téléchargeable ci-après)
Calendrier
2009-2011
2009-2011
Partenariats techniques/financiers
- Conseil général de la Gironde
- Agence de l'eau Adour Garonne
- lycées de Belfast, Barcelone, Eisenstach
- financement européen (programme COMENIUS)
Fichier : fichierinitiative1_EcoReporters.pdf
Télécharger
Economies d'eau sur le lycée et l'exploitation, charte Lycée 21 ( Nîmes - Gard)
Nom de la structure
EPLEFPA de Nîmes-Rodilhan
Téléphone
04 66 20 67 67
Contact (courriel)
riadh.ourabah@educagri.fr
Site Web
http://www.epl.nimes.educagri.fr
Code postal
30230
Ville
Rodilhan
Département
Gard
Type d'initiative
- économie d'eau
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
Dans le cadre de la charte régionale "lycées 21", le lycée et l'exploitation se sont engagés dans de nombreuses actions visant à économiser et à gérer durablement l'eau...
Dans le cadre de la charte régionale "lycées 21", le lycée et l'exploitation se sont engagés dans de nombreuses actions visant à économiser et à gérer durablement l'eau...
Description de l'action
- recherche de fuites dans le réseau d'eau potable par capteur permalog 3 (détection et réparation d'une fuite de 10m3 journalière) (cf.pdf à télécharger)
- "préférer l'eau du robinet" : analyse de l'eau du robinet, atelier de dégustation de différentes eaux (dont l'eau du robinet), atelier de lectures d'étiquettes d'eaux en bouteille, création d'une étiquette pour l'eau du robinet, concours d'affiches, questionnaires individuels distribués dans l'établissement sur la consommation d'eau, réalisation d'une exposition de sensibilisation (cf.pdf à télécharger)
- irrigation des cultures méditerranéennes de l'exploitation (vigne, oliveraie, verger) : réduction des consommation d'eau par suivi du stress hydrique (chambre à pression, tensiomètre) et apport de doses d'irrigation de confort (micro-aspersion ou goutte-à-goutte) (cf.pdf à télécharger)
Utilisation pédagogique
Implication des étudiants de BTSA GEMEAU dans tous les axes du projet
Implication des étudiants de BTSA GEMEAU dans tous les axes du projet
Autre valorisation
- journées des portes ouvertes de l'EPLEFPA
- journée de la biodiversité, journée de l'environnement, semaine du développement durable
- parents d 'élèves
Calendrier
2008-2010
2008-2010
Partenariats techniques/financiers
- Laboratoire départemental agréé d'analyses d'eau
- Communauté d'agglomération Nîmes-Métropole
- Véolia eau
- Conseil régional LR (dispositif Lycée 21)
- Chambre d'agriculture du Gard
- Compagnie du Bas-Rhône Languedoc (BRL)
Fichier : fichierinitiative1_Recherche_fuites_Nimes.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative2_Preferer_eau_robinet_Nimes.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative3_Irrigation_cultures_med_Nimes.pdf
Télécharger
Lien vers vidéo de présentation (1)
http://www.dailymotion.com/video/xolqtn_lycees21lr-nimes_school
Elevage et protection des cours d'eau (Neuvic - Corrèze)
Nom de la structure
EPLEFPA de Haute Corrèze - Neuvic
Téléphone
05 55 95 80 02
Contact (courriel)
carine.rougier@educagri.fr
Contact2 (courriel)
mathieu.chaumeil@educagri.fr
Contact3 (courriel)
bruno.botuha@educagri.fr
Site Web
http://www.lycees-neuvic-meymac.fr
Code postal
19160
Ville
Neuvic
Département
Corrèze
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- milieu naturel
- qualité de l'eau
Contexte
La ferme du Manus est une ferme d’élevage et d’accueil, avec un élevage bovin limousin, qui pâture et entretient une quarantaine d’ha de prairies "naturelles". Le troupeau de 70 vaches limousines participe de façon principale au produit de la ferme, produit obtenu par des ventes de broutards, mais aussi par des ventes d’animaux en direct pour la cantine du lycée.
Son paysage montre une forte présence d’IAE : 20 000 mètres linéaires de haies et lisières, nombreux arbres isolés, deux mares, un important linéaire de cours d’eau bordés de ripisylve.
C'est une ferme classique de Haute Corrèze, avec une activité dominante « bovin viande », qui valorise des surfaces majoritairement composées de prairies temporaires ou naturelles. Les prairies « naturelles » sont très souvent des pacages humides traversés par des rus et ruisseaux, le territoire étant marqué par un fort chevelu hydrographique, souvent de tête de bassin.
Les éleveurs ont des pratiques similaires concernant ces pacages humides : « rigolage » annuel afin de gagner en portance, libre accès des troupeaux aux ruisseaux pour l'abreuvement et la traversée.
La communauté de communes des Gorges de la Haute Dordogne, en charge de la qualité de l'eau sur son territoire, a dans le cadre de son programme d'actions de préservation et entretien des cours d'eau du territoire préconisé de protéger les cours d’eau de l'accès des bovins en plaçant des clôtures. En effet le rigolage entraîne des arrivées conséquentes de limons dans les cours d’eau provoquant le rehaussement, l’accès des bovins aux ruisseaux conduisant à une dégradation forte des berges et de la ripisylve.
Le lycée dispense des formations orientées sur l’environnement (bac STAV, bac pro GMNF, BTSA GPN) et l'animation des territoires ruraux (BTSA DATR). Dans le cadre des enseignements, les élèves et étudiants sont conduits à analyser la qualité des cours d’eau et des milieux humides.
Son paysage montre une forte présence d’IAE : 20 000 mètres linéaires de haies et lisières, nombreux arbres isolés, deux mares, un important linéaire de cours d’eau bordés de ripisylve.
C'est une ferme classique de Haute Corrèze, avec une activité dominante « bovin viande », qui valorise des surfaces majoritairement composées de prairies temporaires ou naturelles. Les prairies « naturelles » sont très souvent des pacages humides traversés par des rus et ruisseaux, le territoire étant marqué par un fort chevelu hydrographique, souvent de tête de bassin.
Les éleveurs ont des pratiques similaires concernant ces pacages humides : « rigolage » annuel afin de gagner en portance, libre accès des troupeaux aux ruisseaux pour l'abreuvement et la traversée.
La communauté de communes des Gorges de la Haute Dordogne, en charge de la qualité de l'eau sur son territoire, a dans le cadre de son programme d'actions de préservation et entretien des cours d'eau du territoire préconisé de protéger les cours d’eau de l'accès des bovins en plaçant des clôtures. En effet le rigolage entraîne des arrivées conséquentes de limons dans les cours d’eau provoquant le rehaussement, l’accès des bovins aux ruisseaux conduisant à une dégradation forte des berges et de la ripisylve.
Le lycée dispense des formations orientées sur l’environnement (bac STAV, bac pro GMNF, BTSA GPN) et l'animation des territoires ruraux (BTSA DATR). Dans le cadre des enseignements, les élèves et étudiants sont conduits à analyser la qualité des cours d’eau et des milieux humides.
Objectif
- préserver la qualité de l'eau à l'échelle de la ferme,
- mettre en œuvre des outils permettant la diffusion de ces pratiques à l'échelle du territoire.
Description de l'action
La mise en œuvre de systèmes différents visent à offrir une « vitrine » au service de la communauté de communes et des éleveurs du territoire : ils viennent, observent, échangent, réfléchissent avec le technicien rivière, choisissent et réalisent, sur leur ferme, grâce aux financements de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et du Conseil départemental, les aménagements adaptés.
Actions complémentaires :
- préservation des berges de l'accès des bovins (mise en défens)
- mise en place de systèmes d'abreuvement diversifiés (abreuvoirs gravitaires, descentes aménagées)
- mise en place de passages par ponts, ou à gué.
La mise en œuvre de systèmes différents visent à offrir une « vitrine » au service de la communauté de communes et des éleveurs du territoire : ils viennent, observent, échangent, réfléchissent avec le technicien rivière, choisissent et réalisent, sur leur ferme, grâce aux financements de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et du Conseil départemental, les aménagements adaptés.
Actions complémentaires :
- suivi de dynamique de végétation des espaces préservés du pâturage (réalisé par les BTS GPN), mis en parallèle avec les temps de travaux induits pour l'entretien
- arrêt de l'utilisation systématique de l'ivermectine au pâturage
- essai de rigolage en tenant compte des connaissances de reproduction des batraciens.
Résultats
Les suivis de dynamique de végétation, qui ne sont pas encore analysés de façon précise, montrent toutefois une arrivée très rapide de plantes caractéristiques de la mégaphorbiaie. D'autre part, on constate très vite la pousse d'arbustes.
L'utilisation de la ferme, comme support de démonstration auprès des éleveurs, la diffusion fréquente des informations en conseil d'exploitation, dans la presse, a conduit plusieurs éleveurs à s'engager dans ce type de programme, financé à 80 % par l'Agence de l'eau Adour-Garonne, le Département et la Région. Fin 2014, 6 éleveurs du territoire étaient déjà engagés...
La ferme est actuellement engagée dans des actions de valorisation auprès d'élèves d'autres établissements agricoles.
L'utilisation de la ferme, comme support de démonstration auprès des éleveurs, la diffusion fréquente des informations en conseil d'exploitation, dans la presse, a conduit plusieurs éleveurs à s'engager dans ce type de programme, financé à 80 % par l'Agence de l'eau Adour-Garonne, le Département et la Région. Fin 2014, 6 éleveurs du territoire étaient déjà engagés...
La ferme est actuellement engagée dans des actions de valorisation auprès d'élèves d'autres établissements agricoles.
Utilisation pédagogique
Lors de la mise en œuvre des aménagements, trois modules de la classe de bacs pros GMNF ont été concernés par le chantier école. Celui-ci a été le support de deux contrôles en cours de formation.
L'action a en particulier été l'occasion pour les élèves de concevoir une action d'animation auprès des membres du Conseil d'administration du lycée. C'était très émouvant de voir ces élèves présenter leur travail et en être fiers !
Par ailleurs, la ferme est fortement utilisée dans le cadre pédagogique et ces actions sont systématiquement valorisées auprès des apprenants.
Enfin, les suivis se poursuivent permettant de mettre en valeur la démarche de projet d'aménagement.
L'action a en particulier été l'occasion pour les élèves de concevoir une action d'animation auprès des membres du Conseil d'administration du lycée. C'était très émouvant de voir ces élèves présenter leur travail et en être fiers !
Par ailleurs, la ferme est fortement utilisée dans le cadre pédagogique et ces actions sont systématiquement valorisées auprès des apprenants.
Enfin, les suivis se poursuivent permettant de mettre en valeur la démarche de projet d'aménagement.
Autre valorisation
Les aménagements sont également valorisés auprès des éleveurs et d'autres établissements scolaires du territoire.
Un film a été réalisé par la DRAAF (cf. ci-dessous)
Obtention de fonds CASDAR TAE 2014-2017 (cf. article en ligne)
Enfin, dans le cadre du MIL « Valoriser l'agroécologie dans le cadre de la ferme pédagogique du Manus » cette action devrait également faire l'objet de séquences d'animation.
Un film a été réalisé par la DRAAF (cf. ci-dessous)
Obtention de fonds CASDAR TAE 2014-2017 (cf. article en ligne)
Enfin, dans le cadre du MIL « Valoriser l'agroécologie dans le cadre de la ferme pédagogique du Manus » cette action devrait également faire l'objet de séquences d'animation.
Calendrier
Les premières réflexion portant sur la mise en défens datent de 2009, les premières clôtures étant posées en 2009, puis 2011 et 2013.
Ces premières réflexions ont été le point de départ de la rédaction du projet Bio Div EA, validé en 2010.
Le partenariat avec la communauté de communes s'est initié dès le premier comité de pilotage en 2011 : et les suivis de végétation ont commencé dès cette année là.
Ensuite, le chantier école a demandé une étude précise, et le montage financier du dossier, mené par la communauté de communes qui a la délégation de maîtrise d'ouvrage
Le premier chantier école s'est déroulé en septembre 2013
Dès 2014 des éleveurs adhéraient aux projets
Ces premières réflexions ont été le point de départ de la rédaction du projet Bio Div EA, validé en 2010.
Le partenariat avec la communauté de communes s'est initié dès le premier comité de pilotage en 2011 : et les suivis de végétation ont commencé dès cette année là.
Ensuite, le chantier école a demandé une étude précise, et le montage financier du dossier, mené par la communauté de communes qui a la délégation de maîtrise d'ouvrage
Le premier chantier école s'est déroulé en septembre 2013
Dès 2014 des éleveurs adhéraient aux projets
Perspective
Poursuite de ces actions d'une part, sur d'autres parcelles (autres chantiers écoles, cf. 2e vidéo), analyse des suivis d'autre part.
Valoriser ces actions, mais surtout l'ensemble de la démarche « agro-écologie » de la ferme, puisque ces actions sont le résultat d'une réflexion globale et non pas sectorielle.
Valoriser ces actions, mais surtout l'ensemble de la démarche « agro-écologie » de la ferme, puisque ces actions sont le résultat d'une réflexion globale et non pas sectorielle.
Partenariats techniques/financiers
La communauté de communes est un partenariat technique (aide à la définition des actions en collaboration avec les équipes enseignantes) et financier (montage financier, participation financière)
L' Agence de l'eau Adour-Garonne, le Département, la Région sont des partenaires financiers essentiels. Fonds CASDAR TAE pour 2014-2017
La chambre d'agriculture est un partenaire technique concernant plutôt le planning de pâturage à réfléchir sur les prairies humides, pour valoriser au mieux l'herbe sur pied. Par ailleurs, elle est au courant des projets, et ses avis sont également des leviers de diffusion.
Le comptoir des plantes est un partenaire technique dans la recherche d'alternatives aux médicaments allopathiques : la ferme s'est engagée dans des expérimentations visant à renforcer les défenses immunitaires.
L' Agence de l'eau Adour-Garonne, le Département, la Région sont des partenaires financiers essentiels. Fonds CASDAR TAE pour 2014-2017
La chambre d'agriculture est un partenaire technique concernant plutôt le planning de pâturage à réfléchir sur les prairies humides, pour valoriser au mieux l'herbe sur pied. Par ailleurs, elle est au courant des projets, et ses avis sont également des leviers de diffusion.
Le comptoir des plantes est un partenaire technique dans la recherche d'alternatives aux médicaments allopathiques : la ferme s'est engagée dans des expérimentations visant à renforcer les défenses immunitaires.
Fichier : fichierinitiative1_diaporama_Neuvic.pdf
Télécharger
Lien vers vidéo de présentation (1)
http://dai.ly/x3cdpb5
Lien vers vidéo de présentation(2)
http://dai.ly/x4bgkrw
Vidéo de présentation (1)
Neuvic-elevage_et-protection-cours-d-eau par eau-ea
Neuvic-elevage_et-protection-cours-d-eau par eau-ea
Vidéo de présentation (2)
neuvic_2016 par eau-ea
neuvic_2016 par eau-ea
Enherbement de l'inter-rang en pépinière (Fayl-Billot - Haute Marne)
Nom de la structure
EPLEFPA de Fayl-Billot
Téléphone
03 25 88 28 27
Contact (courriel)
Bruno.LOUISY@educagri.fr
Code postal
52500
Ville
Fayl-Billot
Département
Haute-Marne
Type d'initiative
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
Cette expérimentation portait sur la comparaison de différentes variétés issues de 4 genres de graminées (ray-grass, fétuque, paturin et agrostide) afin de déterminer les variété les plus intéressantes pour implanter un enherbement permanent en pépinière.
Cette expérimentation portait sur la comparaison de différentes variétés issues de 4 genres de graminées (ray-grass, fétuque, paturin et agrostide) afin de déterminer les variété les plus intéressantes pour implanter un enherbement permanent en pépinière.
Résultats
L'intérêt environnemental de cette technique est confirmé :
- la structure du sol est protégée contre les aléas climatiques
- l'emploi de désherbants chimiques est limité a 30 % des surfaces en pépinières
- le travail du sol entre les rangs est supprimé. L'entretien des bandes peut se faire avec une tondeuse légère autoportée.
L'intérêt environnemental de cette technique est confirmé :
- la structure du sol est protégée contre les aléas climatiques
- l'emploi de désherbants chimiques est limité a 30 % des surfaces en pépinières
- le travail du sol entre les rangs est supprimé. L'entretien des bandes peut se faire avec une tondeuse légère autoportée.
Utilisation pédagogique
Les apprenants ont participé a la mise en place de l'action de démonstration et a son suivi.
Les apprenants ont participé a la mise en place de l'action de démonstration et a son suivi.
Autre valorisation
L'action a été présentée dans le cadre des journées portes ouvertes.
L'action a été présentée dans le cadre des journées portes ouvertes.
Calendrier
2005-2006 (action terminée)
2005-2006 (action terminée)
Partenariats techniques/financiers
Action intégrée dans le cadre du réseau des exploitations des EPLEFPA de Champagne-Ardenne
Action intégrée dans le cadre du réseau des exploitations des EPLEFPA de Champagne-Ardenne
- Agence de l'Eau Seine-Normandie
- Conseil Régional de Champagne-Ardenne
- Partenaire technique : GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences)
Fichier : fichierinitiative1_poster-FaylBillot_enherbt-pepiniere.pdf
Télécharger
Espace démonstrateur d’une zone humide en milieu agricole (Courcelles-Chaussy - Moselle)
Nom de la structure
EPLEFPA Metz-Courcelles-Chaussy
Téléphone
03 87 64 00 17
Contact (courriel)
christelle.suler@educagri.fr
Contact2 (courriel)
caroline.cibert@educagri.fr
Site Web
https://campus-courcelles.fr/exploitation-agricole/formation-experimentation/trame-verte-et-bleue
Code postal
57530
Ville
Courcelles-Chaussy
Département
Moselle
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- milieu naturel
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
L'établissement est partenaire d'un projet porté par la Communauté de Communes du Haut Chemin du Pays de Pange (CCHCPP), en lien également avec les agriculteurs du groupe Proj’ haies, pour des actions en faveur de la biodiversité. Après une première phase (2017-2019) sur la partie "trame verte" (préservation et re-création d'infrastructures agroécologiques), l'EPLEFPA s'engage sur une phase "trame bleue" (lauréat d'un appel à projets de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse), avec pour socle une prairie humide (19 ha) située sur l'exploitation, entourée par le Bois d'Urville au nord (espace naturel préservé, site classé) et par la rivière Nied au sud. Elle appartient au réseau de prairies humides de la Nied française (ZNIEFF de type 1). Plusieurs fossés en eau la contournent et la traversent...
Objectif
- Préserver et valoriser la trame bleue
- Poursuivre la dynamique vers une cohérence territoriale
- Impliquer la communauté éducative et les apprenants au coeur du dispositif
- Créer un espace de démonstration d’une zone humide pour sensibiliser différents publics (apprenants, acteurs professionnels du monde agricole et du paysage,...) à la conciliation entre pratiques agricoles et atteinte du bon état de la masse d’eau
- Poursuivre la dynamique vers une cohérence territoriale
- Impliquer la communauté éducative et les apprenants au coeur du dispositif
- Créer un espace de démonstration d’une zone humide pour sensibiliser différents publics (apprenants, acteurs professionnels du monde agricole et du paysage,...) à la conciliation entre pratiques agricoles et atteinte du bon état de la masse d’eau
Description de l'action
- finalisation de la cartographie des zones humides
- réalisation d'inventaires faunistiques (observations, pièges photographiques, pêches électriques,...) : insectes (lépidoptères, orthoptères, odonates, pollinisateurs), amphibiens, oiseaux, poissons, crustacés (écrevisses), mammifères (castor,...)
- bancarisation des données, analyse des résultats et propositions d'amélioration de la biodiversité : nichoirs, plateaux flottants, taille d'arbres en tétard, entretien de la ripisylve et diversification des écoulements et des habitats, plantations et bouturages, création d'annexes hydrauliques (mare, frayère à brochets)
- au niveau de l'exploitation : pratiques agricoles extensives sur la prairie permanente de l’espace de démonstration (11ha) et sur d’autres prairies permanentes (pas d'amendement, fauches retardées ou différenciées, respect d'une distance de 7m pour un entretien mécanique autour de la mare, fauche pour l'entretien de la frayère à brochets, valorisation de la biodiversité inventoriée, préservation du castor, d’oiseaux nicheurs,... , diversification des techniques et aménagements au niveau de la ripisylve, techniques de fauches centrifuges ou par bandes)
- rédaction de documents techniques et plan de gestion des habitats (mare, ripisylve, prairie…), outils de diagnostics et d’inventaires
- en parallèle : étude de la qualité et fertilité du sol de la prairie et mesure du niveau d’eau de la nappe phréatique, à l’aide d’un piézomètre (afin d’étudier en amont les caractéristiques du bassin versant)
- réalisation d'inventaires faunistiques (observations, pièges photographiques, pêches électriques,...) : insectes (lépidoptères, orthoptères, odonates, pollinisateurs), amphibiens, oiseaux, poissons, crustacés (écrevisses), mammifères (castor,...)
- bancarisation des données, analyse des résultats et propositions d'amélioration de la biodiversité : nichoirs, plateaux flottants, taille d'arbres en tétard, entretien de la ripisylve et diversification des écoulements et des habitats, plantations et bouturages, création d'annexes hydrauliques (mare, frayère à brochets)
- au niveau de l'exploitation : pratiques agricoles extensives sur la prairie permanente de l’espace de démonstration (11ha) et sur d’autres prairies permanentes (pas d'amendement, fauches retardées ou différenciées, respect d'une distance de 7m pour un entretien mécanique autour de la mare, fauche pour l'entretien de la frayère à brochets, valorisation de la biodiversité inventoriée, préservation du castor, d’oiseaux nicheurs,... , diversification des techniques et aménagements au niveau de la ripisylve, techniques de fauches centrifuges ou par bandes)
- rédaction de documents techniques et plan de gestion des habitats (mare, ripisylve, prairie…), outils de diagnostics et d’inventaires
- en parallèle : étude de la qualité et fertilité du sol de la prairie et mesure du niveau d’eau de la nappe phréatique, à l’aide d’un piézomètre (afin d’étudier en amont les caractéristiques du bassin versant)
Utilisation pédagogique
les apprenants sont impliqués à tous les niveaux : sciences participatives (observations/inventaires), travaux de terrain (plantations, tailles, pêches électriques,...), conférences et interventions des partenaires en salles, études et diagnostics pour les annexes hydrauliques (BTS GEMEAU)...
Autre valorisation
- lien aux évènements organisés par l'établissement (printemps d’Urville, festival du non labour, journées professionnelles, ...)
- aménagement d'un sentier pédagogique avec panneaux
- autres supports de communication et de valorisation (réseaux sociaux,conférences,...)
- vidéo reportage (2e comité de pilotage, déambulatoire sur le site - 18 mai 2022)
- vidéo participation des GEMEAU à une pêche électrique de recensement piscicole dans la Nied (septembre 2022)
- vidéo participation des NJPF à l'entretien des mares pour favoriser la biodiversité (novembre 2022)
- vidéo participation des bac pro Aménagements paysagers à la plantation d'une haie de 300 mètre linéaires (février 2023)
- édition et diffusion d'un 4pages spécial projet d'exploitation (2023, cf. document à télécharger)
- captures vidéos de passages de la faune sauvage (2024)
- vidéo "Aménagement d’un espace démonstrateur d’une zone humide en milieu agricole" (2024)
- vidéo de l'Agence de l'eau sur le projet TVB (2025)
- aménagement d'un sentier pédagogique avec panneaux
- autres supports de communication et de valorisation (réseaux sociaux,conférences,...)
- vidéo reportage (2e comité de pilotage, déambulatoire sur le site - 18 mai 2022)
- vidéo participation des GEMEAU à une pêche électrique de recensement piscicole dans la Nied (septembre 2022)
- vidéo participation des NJPF à l'entretien des mares pour favoriser la biodiversité (novembre 2022)
- vidéo participation des bac pro Aménagements paysagers à la plantation d'une haie de 300 mètre linéaires (février 2023)
- édition et diffusion d'un 4pages spécial projet d'exploitation (2023, cf. document à télécharger)
- captures vidéos de passages de la faune sauvage (2024)
- vidéo "Aménagement d’un espace démonstrateur d’une zone humide en milieu agricole" (2024)
- vidéo de l'Agence de l'eau sur le projet TVB (2025)
Calendrier
janvier 2022 > décembre 2024
Partenariats techniques/financiers
Porteur :
Communauté de Communes du Haut Chemin du Pays de Pange (CCHCPP)
Partenaires Financiers :
- Agence de l’eau Rhin Meuse
- DREAL
- Conseil régional Grand Est
Appui technique :
Syndicat des eaux vives des 3 Nied
Appuis scientifique :
Université de Lorraine
Partenaires actions :
- Office français de la biodiversité (OFB)
- Groupe d’Etude des Mammifères de Lorraine (GEML)
- Ligue de protection des oiseaux (LPO)
- Apicool
- Entomologic
- Fédération de pêche de Moselle
- Fédération Départementale des Chasseurs de Moselle
- Conservatoire des espaces naturels de Lorraine (CENL)
- Partenaires associés de l'exploitation agricole : Lorca, chambre agriculture Grand Est, Chambre d’agriculture Moselle
- agriculteurs du groupe Proj’ haies
Communauté de Communes du Haut Chemin du Pays de Pange (CCHCPP)
Partenaires Financiers :
- Agence de l’eau Rhin Meuse
- DREAL
- Conseil régional Grand Est
Appui technique :
Syndicat des eaux vives des 3 Nied
Appuis scientifique :
Université de Lorraine
Partenaires actions :
- Office français de la biodiversité (OFB)
- Groupe d’Etude des Mammifères de Lorraine (GEML)
- Ligue de protection des oiseaux (LPO)
- Apicool
- Entomologic
- Fédération de pêche de Moselle
- Fédération Départementale des Chasseurs de Moselle
- Conservatoire des espaces naturels de Lorraine (CENL)
- Partenaires associés de l'exploitation agricole : Lorca, chambre agriculture Grand Est, Chambre d’agriculture Moselle
- agriculteurs du groupe Proj’ haies
Fichier : 4pages_projet_exploitation_metz.pdf
Télécharger

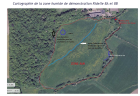
Lien vers vidéo de présentation (1)
https://www.dailymotion.com/video/x8bpase
Vidéo de présentation (1)
Essai Dige'O : Fertilisation par digestats de méthanisation et ressources en eau (Obernai - Bas-Rhin)
Nom de la structure
EPLEFPA d'Obernai
Téléphone
03 88 49 99 49
Contact (courriel)
veronique.stangret@educagri.fr
Contact2 (courriel)
epl.obernai@educagri.fr
Adresse postale
44 boulevard d'Europe
Code postal
67212
Ville
Obernai
Département
Bas-Rhin
Type d'initiative
- traitement des effluents
- milieu naturel
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
En utilisant le dispositif du méthaniseur de l'exploitation et les compétences du Pôle d'excellence éducative sur l'eau (P3E) de l'établissement, le projet expérimental (recherche-action) consiste à connaître et comparer les effets sur la production et l'impact réel sur l'environnement de différents modes de fertilisation, et en particulier de digestats de méthanisation, en utilisant les moyens usuels et le savoir-faire des agriculteurs d'aujourd'hui.
Issu d'une demande initiale de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse concernant l'impact des digestats sur les ressources en eau, il a évolué vers une expérimentation systémique multicritères, visant à mesurer les impacts de fertilisants agricoles (digestat, fumier, lisier, engrais minéraux) sur le milieu (sol, air, eau, biologie) en même temps que les effets économiques et collatéraux (mouvements territoriaux de carbone, intérêt énergétique global).
Dans le domaine de l'eau, il va contribuer au développement d'une expertise de la dynamique de l'eau dans les sols, de nouvelles compétences techniques (métrologie pratique en érosion, mouvements de terrain, drainage, percolation, stockage, transferts de solutés, lixiviation etc)... et sans doute de nouveaux métiers.
Issu d'une demande initiale de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse concernant l'impact des digestats sur les ressources en eau, il a évolué vers une expérimentation systémique multicritères, visant à mesurer les impacts de fertilisants agricoles (digestat, fumier, lisier, engrais minéraux) sur le milieu (sol, air, eau, biologie) en même temps que les effets économiques et collatéraux (mouvements territoriaux de carbone, intérêt énergétique global).
Dans le domaine de l'eau, il va contribuer au développement d'une expertise de la dynamique de l'eau dans les sols, de nouvelles compétences techniques (métrologie pratique en érosion, mouvements de terrain, drainage, percolation, stockage, transferts de solutés, lixiviation etc)... et sans doute de nouveaux métiers.
Objectif
Expertiser l'impact d'une pratique déjà très répandue (épandage du digestat), préparer et former les futurs agriculteurs et conseillers à cette expertise, diffuser des préconisations acceptables auprès des exploitants pour faire évoluer les modes de production en grandes cultures vers des pratiques plus-agro-écologiques et maîtrisées
Description de l'action
18 à 24 parcelles expérimentales 70m x 32m (+ 4 parcelles de référence) instrumentées chacune de :
5 tensiomètres
5 sondes TDR
7 bougies poreuses
1 tube TDR pour mesure jusqu'à 3m
Mesures régulières sur : la fertilité (Azote, Carbone), les transferts hydriques, l'air, la structure du sol et la vie microbienne
Le terrain comporte 1 station climatique et 9 stations intermédiaires de collecte des données et solutés de sol.
Le terrain comporte 2 nappes : 1 nappe superficielle située entre 3 et 1m, et une nappe profonde à partir de 17m (nappe du Rhin)
Plusieurs dispositifs piézométriques seront posés, à l'amont et à l'aval de la zone expérimentale pour la connaissance de ces dynamiques sous-jacentes.
Possibilités d'extension à d'autres problématiques émergentes
Formation simultanée sur les techniques de l'agriculture de demain
5 tensiomètres
5 sondes TDR
7 bougies poreuses
1 tube TDR pour mesure jusqu'à 3m
Mesures régulières sur : la fertilité (Azote, Carbone), les transferts hydriques, l'air, la structure du sol et la vie microbienne
Le terrain comporte 1 station climatique et 9 stations intermédiaires de collecte des données et solutés de sol.
Le terrain comporte 2 nappes : 1 nappe superficielle située entre 3 et 1m, et une nappe profonde à partir de 17m (nappe du Rhin)
Plusieurs dispositifs piézométriques seront posés, à l'amont et à l'aval de la zone expérimentale pour la connaissance de ces dynamiques sous-jacentes.
Possibilités d'extension à d'autres problématiques émergentes
Formation simultanée sur les techniques de l'agriculture de demain
Utilisation pédagogique
Le projet associe à l'expérimentation dès le début, d'une part les futurs professionnels par intégration dans l'enseignement agricole (Bacpro, BTSA ACSE, APV, Gemeau, licence pro), et d'autre part les exploitants eux-mêmes et chambres consulaires.
Autre valorisation
Outre les interventions des classes et dans les classes, des formations modulaires spécifiques ont été prévues dès l'automne 2018, et seront accessibles à tous. Elles concernent tous les aspects pratiques enseignables aux futurs techniciens et ingénieurs de chantier : mise en place et entretien de capteurs, de collecteurs, de stations de mesure ; programmation des modules d'acquisition, transfert des données ; mise en place géographique des installations en 3D, géo-référencement, transfert sur SIG, suivi par drone, pilotage agricole (agriculture connectée).
Calendrier
2018-2022
Partenariats techniques/financiers
techniques : INRA, l'ENSAIA Nancy, Université de Lorraine, chambres régionales d'agriculture Grand-Est et Alsace, associations des agriculteurs méthaniseurs de France, association ATMO Grand-Est
financiers : Agence de l'eau Rhin-Meuse, Fondation Kronenbourg, CASDAR, France Agrimer
financiers : Agence de l'eau Rhin-Meuse, Fondation Kronenbourg, CASDAR, France Agrimer
Fichier : FertilisationParDigestatsDeMethanisationEt_fichierinitiative1_panneau_presentation_essai.pdf
Télécharger
Fichier : FertilisationParDigestatsDeMethanisationEt_fichierinitiative2_fonctionnement-methaniseur-obernai.pdf
Télécharger


Evaluation multicritères d’un système de culture innovant : agriculture de conservation irriguée, comportement des sols et efficience de l’eau (Aix-en-Provence - Bouches-du-Rhône)
Nom de la structure
EPLEFPA Aix-Valabre (Campus nature Provence)
Téléphone
04 42 65 43 28
Contact (courriel)
viviane.cataldo@educagri.fr
Contact2 (courriel)
michel.neviere@educagri.fr
Contact3 (courriel)
claire.wittling@inrae.fr
Code postal
13548
Ville
Gardanne
Département
Bouches-du-Rhône
Type d'initiative
- économie d'eau
- systèmes de culture
Contexte
Le changement climatique en conditions méditerranéennes se traduit par des printemps et des étés plus secs, des coups de chaleurs extrêmes plus fréquents et une pression accrue sur la ressource en eau. En conditions tempérées, les pratiques d’agriculture de conservation des sols (ACS : techniques culturales simplifiées ou semis direct, couverture permanente des sols, rotations longues et diversifiées) sont ciblées comme des leviers d’action possibles pour la limitation de l’utilisation des ressources en eau.
Cela est-il le cas dans un contexte méditerranéen irrigué ? Quels sont, dans le contexte climatique évolutif, les avantages de l’ACS en terme de volumes d’eau mobilisés ? Quels sont les impacts et bénéfices de l’ACS sur la ressource en eau à l’échelle d’une rotation ? Dans quelles mesures une gestion de l’eau adaptée pourra contribuer à renforcer les propriétés et les services écosystémiques des sols, tout en conservant un revenu agricole correct ?
Plusieurs projets en cours ou passés étudient les divers bénéfices de l’ACS en France. Les spécificités de l'expérimentation réalisée par l’équipe OPTIMISTE de l’UMR G-EAU (INRAE Montpellier) sur le site de l'exploitation agricole de l'EPLEFPA Aix-Valabre portent sur le ciblage de la perspective du changement climatique, avec d’une part le contexte méditerranéen qui préfigure une grande partie du territoire national, et d’autre part la quantification de l’économie de la ressource en eau réalisable.
Cela est-il le cas dans un contexte méditerranéen irrigué ? Quels sont, dans le contexte climatique évolutif, les avantages de l’ACS en terme de volumes d’eau mobilisés ? Quels sont les impacts et bénéfices de l’ACS sur la ressource en eau à l’échelle d’une rotation ? Dans quelles mesures une gestion de l’eau adaptée pourra contribuer à renforcer les propriétés et les services écosystémiques des sols, tout en conservant un revenu agricole correct ?
Plusieurs projets en cours ou passés étudient les divers bénéfices de l’ACS en France. Les spécificités de l'expérimentation réalisée par l’équipe OPTIMISTE de l’UMR G-EAU (INRAE Montpellier) sur le site de l'exploitation agricole de l'EPLEFPA Aix-Valabre portent sur le ciblage de la perspective du changement climatique, avec d’une part le contexte méditerranéen qui préfigure une grande partie du territoire national, et d’autre part la quantification de l’économie de la ressource en eau réalisable.
Objectif
Objectif général : évaluer le système de cultures innovant associant deux leviers d’économie d’eau : agriculture de conservation des sols (ACS) et goutte-à-goutte enterré (GGE), en contexte méditerranéen (performances agronomiques, performances environnementales - adaptation/atténuation du changement climatique - en lien avec l'économie d'eau d'irrigation, performances économiques et financières)
Objectif spécifique 1 : caractériser l’impact du changement de pratiques (transition des itinéraires techniques conventionnels vers l’ACS) sur le comportement hydrique du sol, les flux d’eau et nutriments, la valorisation respective de l’eau de pluie et de l’eau d’irrigation
Objectif spécifique 2 : développer un module spécifique « Agriculture de conservation » du modèle OPTIRRIG (modèle INRAE de génération, d’analyse et d’optimisation de scénarios d'irrigation pour les cultures) dans une optique de réduction des pertes, d’amélioration de l’efficience globale de l’eau de pluie et d’irrigation et de réduction des prélèvements
Objectif spécifique 1 : caractériser l’impact du changement de pratiques (transition des itinéraires techniques conventionnels vers l’ACS) sur le comportement hydrique du sol, les flux d’eau et nutriments, la valorisation respective de l’eau de pluie et de l’eau d’irrigation
Objectif spécifique 2 : développer un module spécifique « Agriculture de conservation » du modèle OPTIRRIG (modèle INRAE de génération, d’analyse et d’optimisation de scénarios d'irrigation pour les cultures) dans une optique de réduction des pertes, d’amélioration de l’efficience globale de l’eau de pluie et d’irrigation et de réduction des prélèvements
Description de l'action
Expérimentation en grandes cultures : rotations culturales maïs, blé dur, sorgho, soja ainsi que des couverts d’hiver variés (féverole, mélanges légumineuses et graminées).
ACS ou travail du sol conventionnel (labour) seront combinés avec trois techniques d’irrigation différentes : goutte-à-goutte enterré (GGE) 15 mm 2 fois/semaine, aspersion 30 mm 1 fois/semaine ou aucune irrigation (pluvial). Une attention particulière sera portée à l’uniformité de distribution de l’eau ainsi qu’au suivi fin des doses appliquées.
Evaluation des performances des systèmes de culture :
. performances agronomiques (consommation d’intrants, développement végétatif, rendement, productivité de l'eau)
. performances environnementales (propriétés physico-chimiques et hydrodynamiques du sol, flux d'eau dans les différents horizons, propriétés biologiques du sol)
. performances économiques (point de vue de la collectivité - horizon 40-50 ans) et financières (point de vue de l’agriculteur - horizon 15-20 ans)
ACS ou travail du sol conventionnel (labour) seront combinés avec trois techniques d’irrigation différentes : goutte-à-goutte enterré (GGE) 15 mm 2 fois/semaine, aspersion 30 mm 1 fois/semaine ou aucune irrigation (pluvial). Une attention particulière sera portée à l’uniformité de distribution de l’eau ainsi qu’au suivi fin des doses appliquées.
Evaluation des performances des systèmes de culture :
. performances agronomiques (consommation d’intrants, développement végétatif, rendement, productivité de l'eau)
. performances environnementales (propriétés physico-chimiques et hydrodynamiques du sol, flux d'eau dans les différents horizons, propriétés biologiques du sol)
. performances économiques (point de vue de la collectivité - horizon 40-50 ans) et financières (point de vue de l’agriculteur - horizon 15-20 ans)
Résultats
Le système de GGE a été mis en place en 2021.
Des premiers résultats de bilans hydriques à l'échelle de la saison culturale ont été enregistrés en 2022, ils seront conduits jusqu'à fin 2024.
Les bilans hydriques et agronomiques pluriannuels, ainsi que le développement du module spécifique ACS du modèle OPTIRRIG sont attendus pour fin 2025
Des premiers résultats de bilans hydriques à l'échelle de la saison culturale ont été enregistrés en 2022, ils seront conduits jusqu'à fin 2024.
Les bilans hydriques et agronomiques pluriannuels, ainsi que le développement du module spécifique ACS du modèle OPTIRRIG sont attendus pour fin 2025
Utilisation pédagogique
. Implication par le chargé des expérimentations de l'EPLEFPA dans la mise en place de la culture et de l'interculture, dans le suivi des irrigations et surtout dans les observations et mesures réalisées sur l'essai
. Participation de 2 étudiants BTSA Agronomie-Productions végétales, qui réalisent leur stage principal au service expérimentation de l'exploitation de l'EPLEFPA
. observations par les étudiants de BTSA APV. Les résultats de l'esssai sont valorisésau niveau pédagogique dans le cadre du module M57 (statistiques et démarches expérimentales) des BTSA
. Participation de 2 étudiants BTSA Agronomie-Productions végétales, qui réalisent leur stage principal au service expérimentation de l'exploitation de l'EPLEFPA
. observations par les étudiants de BTSA APV. Les résultats de l'esssai sont valorisésau niveau pédagogique dans le cadre du module M57 (statistiques et démarches expérimentales) des BTSA
Autre valorisation
films vidéos
. présentation par l'UMR G-Eau de l'expérimentation sur le site INRAE de Montpellier : l'ACS et des techniques d'irrigation
. Présentation par l'UMR G-Eau de l'INRAE Montpellier de la plateforme expérimentale avec tests des performances de techniques de micro-irrigation (goute-à-goutte, aspersion)
. présentation par l'UMR G-Eau de l'expérimentation sur le site INRAE de Montpellier : l'ACS et des techniques d'irrigation
. Présentation par l'UMR G-Eau de l'INRAE Montpellier de la plateforme expérimentale avec tests des performances de techniques de micro-irrigation (goute-à-goutte, aspersion)
Calendrier
2022-2025
Perspective
Ce projet pilote permettra de suivre la dynamique d’évolution des propriétés hydrodynamiques du sol au cours des premières années de la phase de transition vers l’ACS. Il initiera une étude à long terme (10-15 ans) des performances d’un système ACS-GGE pendant la phase de transition puis de stabilisation.
Il constituera une base de référence agro-technique pour identifier les potentialités d’économie d’eau en ACS à l’échelle de la parcelle dans un contexte de changement climatique. Il permettra, dans le cadre de projets ultérieurs, d’évaluer les effets de la transition agroécologique sur la gestion quantitative de la ressource en eau à l’échelle du territoire, en couplant les approches technico-économiques aux échelles parcellaires en lien avec les logiques des exploitations agricoles, et en agrégeant celles-ci à l’échelle territoriale avec des approches participatives.
Il s’agira d’actions menées en lien avec les agriculteurs irrigants de la Région PACA, avec un suivi de leurs pratiques culturales et d’irrigation dans leurs parcelles, et l’organisation d’ateliers de communication et d’échanges. Des formations à destination d'étudiants pourront également avoir lieu, en particulier pour les étudiants du lycée agricole.
Il constituera une base de référence agro-technique pour identifier les potentialités d’économie d’eau en ACS à l’échelle de la parcelle dans un contexte de changement climatique. Il permettra, dans le cadre de projets ultérieurs, d’évaluer les effets de la transition agroécologique sur la gestion quantitative de la ressource en eau à l’échelle du territoire, en couplant les approches technico-économiques aux échelles parcellaires en lien avec les logiques des exploitations agricoles, et en agrégeant celles-ci à l’échelle territoriale avec des approches participatives.
Il s’agira d’actions menées en lien avec les agriculteurs irrigants de la Région PACA, avec un suivi de leurs pratiques culturales et d’irrigation dans leurs parcelles, et l’organisation d’ateliers de communication et d’échanges. Des formations à destination d'étudiants pourront également avoir lieu, en particulier pour les étudiants du lycée agricole.
Partenariats techniques/financiers
Porteur : UMR G-Eau, INRAE Montpellier
Autres partenaires techniques :
UMR AGIR, Toulouse
Arvalis Méditerranée
Société du Canal de Provence
Financements :
INRAE (métaprogramme CLIMAE)
OFB
AERMC (développement de l'évaluation financière et économique de l'ACS irriguée)
Autres partenaires techniques :
UMR AGIR, Toulouse
Arvalis Méditerranée
Société du Canal de Provence
Financements :
INRAE (métaprogramme CLIMAE)
OFB
AERMC (développement de l'évaluation financière et économique de l'ACS irriguée)

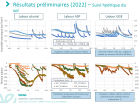
Evènement inter-filières BTS "Journées Eau" (La Canourgue+St chély d'Apcher - Lozère)
Nom de la structure
EPLEFPA Lozère
Téléphone
0466426150
Contact (courriel)
vincent.lombard@educagri.fr
Contact2 (courriel)
marine.desaphy@educagri.fr
Contact3 (courriel)
pierre.herrgott@educagri.fr
Site Web
http://www.eplealozere.fr
Code postal
48200
Ville
St Chély d'Apcher
Département
Lozère
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- économie d'eau
- traitement des effluents
- milieu naturel
- qualité de l'eau
- risques
- systèmes de culture
Contexte
S'il est une problématique qui concerne la Lozère, c'est bien celle de l'eau. Riche en cours d'eau, pays de causse et de moyenne montagne, le département est très directement concerné par la gestion rigoureuse d'une ressource indispensable à la vie de tous, particuliers, industriels, agriculteurs ou collectivités. Comment protéger les zones humides sans entraver le développement agricole, comment gérer des entreprises de production piscicole en ayant l'assurance d'une garantie de la ressource, comment alimenter une population très consommatrice, comment recycler l'eau utilisée dans toutes ces pratiques quotidiennes ?
Depuis 2015, l'EPLEFPA mobilise sur ce thème fédérateur les étudiants et les enseignants des quatre BTS 1re année des lycées Pasteur (La Canourgue) et Rabelais (St Chély d'Apcher), sur 2 jours d'étude à la rencontre d'acteur du territoire.
S'il est une problématique qui concerne la Lozère, c'est bien celle de l'eau. Riche en cours d'eau, pays de causse et de moyenne montagne, le département est très directement concerné par la gestion rigoureuse d'une ressource indispensable à la vie de tous, particuliers, industriels, agriculteurs ou collectivités. Comment protéger les zones humides sans entraver le développement agricole, comment gérer des entreprises de production piscicole en ayant l'assurance d'une garantie de la ressource, comment alimenter une population très consommatrice, comment recycler l'eau utilisée dans toutes ces pratiques quotidiennes ?
Depuis 2015, l'EPLEFPA mobilise sur ce thème fédérateur les étudiants et les enseignants des quatre BTS 1re année des lycées Pasteur (La Canourgue) et Rabelais (St Chély d'Apcher), sur 2 jours d'étude à la rencontre d'acteur du territoire.
Objectif
- mixer les étudiants pour travailler en croisant leurs regards sur un projet commun, inscrit dans un territoire qui est très directement concerné.
- mieux faire connaître les parcours de formations proposés par les 2 sites de l'EPLEFPA
- mixer les étudiants pour travailler en croisant leurs regards sur un projet commun, inscrit dans un territoire qui est très directement concerné.
- mieux faire connaître les parcours de formations proposés par les 2 sites de l'EPLEFPA
Description de l'action
Sur 2 jours banalisés, pour l'ensemble des 80 à 90 étudiants de BTSA 1ere année des 4 filières (GEMEAU initial et adultes, Aquaculture, GPN, ACSE) : approche globale d'un territoire
. répartition en sous-groupes mixtes
. co-construction de grilles d'analyse (questions) générale et thématique
. rencontre, pour chacun des sous-groupes d'étudiants, d'un acteur du territoire rencontré sur site (élu, agriculteur, pisciculteur, responsable associatif, gestionnaire de golf,...) puis analyse croisée des informations remontées et synthèse sur les acteurs et les problématiques abordées
. constitution de nouveaux groupes de travail pour finaliser les présentations de thématiques particulières, de la synthèse générale et de saynète(s)
. synthèse finale en plénière, devant les acteurs rencontrés sur sites : présentation factuelle et saynètes illustrant les problématiques, les logiques d'acteurs, la synthèse globale sur le territoire. Retours des acteurs présents
Sur 2 jours banalisés, pour l'ensemble des 80 à 90 étudiants de BTSA 1ere année des 4 filières (GEMEAU initial et adultes, Aquaculture, GPN, ACSE) : approche globale d'un territoire
. répartition en sous-groupes mixtes
. co-construction de grilles d'analyse (questions) générale et thématique
. rencontre, pour chacun des sous-groupes d'étudiants, d'un acteur du territoire rencontré sur site (élu, agriculteur, pisciculteur, responsable associatif, gestionnaire de golf,...) puis analyse croisée des informations remontées et synthèse sur les acteurs et les problématiques abordées
. constitution de nouveaux groupes de travail pour finaliser les présentations de thématiques particulières, de la synthèse générale et de saynète(s)
. synthèse finale en plénière, devant les acteurs rencontrés sur sites : présentation factuelle et saynètes illustrant les problématiques, les logiques d'acteurs, la synthèse globale sur le territoire. Retours des acteurs présents
Autre valorisation
en 2015 :
- étendu sur 2 semaines pour les BTSA GEMEAU (pluridisciplinarité "étude de bassin-versant")
- étendu également pour environ 6 autres étudiants des 3 autres filières BTSA, engagés dans un stage d'été au Brésil, en binômes mixtes et accueillis dans des structures de recherche-développement (eau-environnment, aquaculture, agriculture) : transférabilité, dans un contexte différent, des savoir-faire acquis et des outils développés pour une approche globale de situations complexes...
- réalisation par les BTSA GPN de banderoles de sensibilisation aux écosystèmes aquatiques et à la gestion de la ressource en eau (MIL communication visuelle)
- voir aussi article midi libre : http://lc.cx/Z3VR
en 2016 :
- intégration en amont et en aval des 2 journées généralisée dans tous les cursus de formation des différentes filières....
- sortie d'un DVD par Educagri editions dans la série "Pour une gestion durable ici...et ailleurs", en lien avec l'action de coopération avec le Brésil (cf. ci-dessus) : "Productions animales et gestion de l'eau"
- article de valorisation paru sur pollen.chlorofil.fr
en 2015 :
- étendu sur 2 semaines pour les BTSA GEMEAU (pluridisciplinarité "étude de bassin-versant")
- étendu également pour environ 6 autres étudiants des 3 autres filières BTSA, engagés dans un stage d'été au Brésil, en binômes mixtes et accueillis dans des structures de recherche-développement (eau-environnment, aquaculture, agriculture) : transférabilité, dans un contexte différent, des savoir-faire acquis et des outils développés pour une approche globale de situations complexes...
- réalisation par les BTSA GPN de banderoles de sensibilisation aux écosystèmes aquatiques et à la gestion de la ressource en eau (MIL communication visuelle)
- voir aussi article midi libre : http://lc.cx/Z3VR
en 2016 :
- intégration en amont et en aval des 2 journées généralisée dans tous les cursus de formation des différentes filières....
- sortie d'un DVD par Educagri editions dans la série "Pour une gestion durable ici...et ailleurs", en lien avec l'action de coopération avec le Brésil (cf. ci-dessus) : "Productions animales et gestion de l'eau"
- article de valorisation paru sur pollen.chlorofil.fr
Calendrier
action réalisée depuis 2015
action réalisée depuis 2015
Perspective
pérennisation (une édition par an)
pérennisation (une édition par an)
Partenariats techniques/financiers
- tous les partenaires habituels de l'EPLEFPA sur les territoires de l'étude
- Conseil régional Occitanie
- Agence de l'eau Adour-Garonne
- Educagri Editions
- tous les partenaires habituels de l'EPLEFPA sur les territoires de l'étude
- Conseil régional Occitanie
- Agence de l'eau Adour-Garonne
- Educagri Editions
Fichier : fichierinitiative1_Journees_eau_EPL_Lozere_2015.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative2_Journees_eau_EPL_Lozere_2016.pdf
Télécharger
Lien vers vidéo de présentation (1)
http://dai.ly/x544kn2
Lien vers vidéo de présentation(2)
http://dai.ly/x54fhfk
Vidéo de présentation (1)
lozere_journees_eau_2015_vcourte par eau-ea
lozere_journees_eau_2015_vcourte par eau-ea
Vidéo de présentation (2)
lozere_journees_eau_2016 par eau-ea
lozere_journees_eau_2016 par eau-ea
Franchissement de cours d'eau en forêt (Meymac - Corrèze)
Nom de la structure
EPLEFPA de Haute Correze-CFPPA-Meymac
Téléphone
0675466923
Contact (courriel)
aurelie.cogneras@educagri.fr
Adresse postale
rue de l'ecole forestière
Code postal
19250
Ville
Meymac
Département
Corrèze
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- milieu naturel
Contexte
Le franchissement de cours d'eau en milieu forestier se présente quotidiennement pour les forestiers. Sans précautions, cela peut entraîner de graves conséquences sur le milieu naturel. Aujourd'hui, le Code de l'Environnement règlemente cela.
Le franchissement de cours d'eau en milieu forestier se présente quotidiennement pour les forestiers. Sans précautions, cela peut entraîner de graves conséquences sur le milieu naturel. Aujourd'hui, le Code de l'Environnement règlemente cela.
Objectif
Aider les professionnels à maîtriser les procédures et démarches pour répondre à ces obligations et protéger l'environnement.
Aider les professionnels à maîtriser les procédures et démarches pour répondre à ces obligations et protéger l'environnement.
Description de l'action
- ateliers en salle animés par l'ONEMA, la DDT, etc. pour présenter les dispositifs et obligations.
- visites sur le terrain pour visualiser et examiner des cas réels.
Résultats
Une participation des professionnels forestiers importante, de nombreuses questions de leur part ont trouvé des réponses précises et concrètes. Les contraintes de terrain ont pu être appréhendées.
Une participation des professionnels forestiers importante, de nombreuses questions de leur part ont trouvé des réponses précises et concrètes. Les contraintes de terrain ont pu être appréhendées.
Utilisation pédagogique
Le public était composé de stagiaires du CFPPA et des professionnels du milieu.
Le public était composé de stagiaires du CFPPA et des professionnels du milieu.
Autre valorisation
Auprès des professionnels (coopératives, exploitants, scieurs, experts...)
Auprès des professionnels (coopératives, exploitants, scieurs, experts...)
Calendrier
16/05/2012
16/05/2012
Partenariats techniques/financiers
ONEMA, DDT, Communauté des communes de la Haute Dordogne, PNR de Millevaches.
ONEMA, DDT, Communauté des communes de la Haute Dordogne, PNR de Millevaches.
Fichier : fichierinitiative1_artcl_eau_meymac.jpg
Télécharger
Gestion des effluents de pisciculture par aquaponie (La Canourgue - Lozère)
Nom de la structure
EPL de la Lozère
Téléphone
04 66 32 83 54
Contact (courriel)
catherine.lejolivet@educagri.fr
Contact2 (courriel)
lionel.valley@educagri.fr
Site Web
http://www.eplealozere.fr
Code postal
48500
Ville
La Canourgue
Département
Lozère
Type d'initiative
- traitement des effluents
- qualité de l'eau
Contexte
Une des problématiques majeures des exploitations aquacoles est de traiter voire de valoriser les effluents d'élevage ; démarche incontournable à l'échelle française, compte tenu de la mise en application de la Directive Cadre Européenne sur l'eau. Cette recherche de durabilité en particulier environnementale est aussi un enjeu majeur de l'aquaculture mondiale (Pays européens, Inde, Brésil, Thaïlande, Philippines...). Ces différents partenaires sont demandeurs d'appui technique et de transfert technologique afin de développer leurs productions pour couvrir la demande alimentaire croissante mais dans une démarche d'intensification écologique (réduction des intrants et prélèvements d'eau, limitation des impacts et maintien de la biodiversité).
Objectif
Le programme d'expérimentation, support de formation, vise à démontrer la faisabilité technico-économique d'un système en aquaponie, associant une production rationalisée de poissons et des cultures végétales en hydroponie, mais également à économiser les prélèvements d'eau par un recyclage permanent...
Description de l'action
Une partie ou la totalité des rejets solides constitue une source alimentaire pour des espèces filtreuses et/ou détritivores (susceptibles d'être valorisés dans l'alimentation animale). Les composés excrétés directement par les poissons ou générés par la décomposition bactérienne de la matière organique résiduelle (via des filtres biologiques) sont absorbés comme nutriments par des plantes cultivées en hydroponie. Cette aquaculture intégrée nécessite d'adopter des stratégies adaptées pour la conduite d'élevage piscicole : rationnement adéquat pour éviter toute surproduction d'effluents, plan de prophylaxie visant à restreindre l'emploi de produits vétérinaires, potentiellement préjudiciables aux cultures ou élevages annexés. Les techniques de mise en culture et de récolte des plantes doivent être également être effectuées dans des conditions sanitaires optimales afin de ne pas contaminer les produits destinés à l'alimentation humaine.
Utilisation pédagogique
Ce programme, réalisé dans le cadre d'un Module d'Initiative Locale des étudiants de BTS (Aquaculture et GEMEAU), permet d'associer plusieurs enseignants de ces deux filières et l'exploitation. Au-delà d'une mise en application de leurs savoirs et savoir faire dans leur domaine professionnel respectif, cette conduite de projet pilote leur permet d'acquérir une démarche scientifique susceptible de leur ouvrir de nouvelles voies dans leur parcours professionnel futur.
Autre valorisation
- visites de délégations professionnelles françaises et étrangères
- par les nombreux partenariats en cours ou futurs (cf. ci après)
- à travers le pôle de compétence VEGEPOLYS
- article (2016) sur adt.educagri.fr
- film (2020) co-réalisé et interprété par des étudiants en BTSA Aquaculture
- poster de vulgarisation sur le principe de l'aquaponie (cf pj) (2020)
Calendrier
Acquisition de connaissances en hydroponie
Visites d'entreprises (hydroponie/aquaponie en France et Europe)
Mise au point des circuits hydrauliques
Expérimentations sur cultures associées pour détermination des espèces optimales
Enregistrement de données sur l'ensemble des productions
Comparaison avec cultures en plein champ, serres et systèmes hydroponiques
Traitement des données et valorisation des résultats
Etude des circuits de commercialisation
Etude de la qualité (bactérienne, organoleptique) des produits
Traitement de données et valorisation des résultats
Analyse du cycle de vie, affichage environnemental
Mise en place d'un cahier des charges
Identification de nouveaux métiers et création de référentiels de formation
Organisation de sessions de formation pour de nouveaux métiers
- 2011-2013 : Faisabilité technique
Acquisition de connaissances en hydroponie
Visites d'entreprises (hydroponie/aquaponie en France et Europe)
Mise au point des circuits hydrauliques
Expérimentations sur cultures associées pour détermination des espèces optimales
Enregistrement de données sur l'ensemble des productions
Comparaison avec cultures en plein champ, serres et systèmes hydroponiques
Traitement des données et valorisation des résultats
- 2012-2013 : Faisabilité économique
Etude des circuits de commercialisation
Etude de la qualité (bactérienne, organoleptique) des produits
Traitement de données et valorisation des résultats
Analyse du cycle de vie, affichage environnemental
Mise en place d'un cahier des charges
- 2013-2014 : Transfert technologique
Identification de nouveaux métiers et création de référentiels de formation
Organisation de sessions de formation pour de nouveaux métiers
Partenariats techniques/financiers
Raisonnée et Ecologique pour une PIsciculture Durable »
Sup Agro Montpellier
University of Stirling (W. Leschen)
Réseau Mixte Technologique "Elevage et environnement" (adhésion janvier 2011)
Lycée Aquacole de Guérande (44)
Lycée Horticole de Castelnau le Lez (34)
Institut technique CTIFL de Ballandran (30)
Bureau d'études JOLYMER Conseil
Bureau d'études aquacoles AQUARHEAK (34)
Aquaponics UK
Des contacts sont prévus avec le PEIFL et le Pôle Qualiméditerranée...
Comité Interprofessionnel des Produits de l'Aquaculture
Association d'entreprises aquacoles ORVIVA (34)
Esox Pisciculture (34)
- Partenaires RECHERCHE :
Raisonnée et Ecologique pour une PIsciculture Durable »
Sup Agro Montpellier
University of Stirling (W. Leschen)
Réseau Mixte Technologique "Elevage et environnement" (adhésion janvier 2011)
- Partenaires FORMATION :
Lycée Aquacole de Guérande (44)
Lycée Horticole de Castelnau le Lez (34)
- Partenaires DEVELOPPEMENT :
Institut technique CTIFL de Ballandran (30)
Bureau d'études JOLYMER Conseil
Bureau d'études aquacoles AQUARHEAK (34)
Aquaponics UK
Des contacts sont prévus avec le PEIFL et le Pôle Qualiméditerranée...
- Partenaires AQUACOLES :
Comité Interprofessionnel des Produits de l'Aquaculture
Association d'entreprises aquacoles ORVIVA (34)
Esox Pisciculture (34)
- Partenaire FINANCIER :
Fichier : fichierinitiative1_Projet_aquaponie.pdf
Télécharger
Fichier : GestionDesEffluentsDePiscicultureParAquap_fichierinitiative2_poster_aquaponie_2020.pdf
Télécharger
Lien vers vidéo de présentation (1)
http://www.dailymotion.com/video/xjfikf_lacanourgue-aquaponie-2011_school
Lien vers vidéo de présentation(2)
https://drive.google.com/file/d/1pD-dDl9RMPHXfywxRQQnh9CAzRwr9JiG/view?usp=sharing
Gestion des effuents de fromageries fermières (Aubenas - Ardèche)
Nom de la structure
EPLEFPA Aubenas
Téléphone
04 75 36 74 37
Contact (courriel)
Jean-Marc.GIACOPELLI@educagri.fr
Contact2 (courriel)
Yves.LEFRILEUX@educagri.fr
Site Web
http://epl.aubenas.educagri.fr
Code postal
07170
Ville
MIRABEL
Département
Ardèche
Type d'initiative
- traitement des effluents
- qualité de l'eau
Contexte
La région Rhône-Alpes est la première région française en terme de production fromagère caprine fermière. Les observations faites a la Station expérimentale caprine du Pradel et dans le réseau régional Rhône-Alpes ont mis en évidence la charge organique extrêmement élevée des effluents de fromagerie. Parallèlement aux solutions testées en ferme - stockage-épandage d'effluents, valorisation du lactosérum - l'exploitation du Pradel, à partir de son élevage caprin fromager, expérimente le traitement par culture fixée sur pouzzolane. Au-delà de l'aspect réglementaire interdisant les rejets directs des effluents, cette action vise à contribuer a une gestion des élevages respectueuse de la protection de l'environnement et du développement durable. Cette action permet à l'EPL Olivier de Serres de contribuer pleinement à la mission de recherche et démonstration en associant pleinement les professionnels a une thématique de gestion du territoire.
La région Rhône-Alpes est la première région française en terme de production fromagère caprine fermière. Les observations faites a la Station expérimentale caprine du Pradel et dans le réseau régional Rhône-Alpes ont mis en évidence la charge organique extrêmement élevée des effluents de fromagerie. Parallèlement aux solutions testées en ferme - stockage-épandage d'effluents, valorisation du lactosérum - l'exploitation du Pradel, à partir de son élevage caprin fromager, expérimente le traitement par culture fixée sur pouzzolane. Au-delà de l'aspect réglementaire interdisant les rejets directs des effluents, cette action vise à contribuer a une gestion des élevages respectueuse de la protection de l'environnement et du développement durable. Cette action permet à l'EPL Olivier de Serres de contribuer pleinement à la mission de recherche et démonstration en associant pleinement les professionnels a une thématique de gestion du territoire.
Description de l'action
L'exploitation du Pradel (Ardèche), siège de la Station expérimentale caprine, teste depuis 1995 des dispositifs de traitements des effluents de fromagerie.
Les dispositifs présents sur le site traitent les eaux blanches de fromagerie et le lactosérum issus de l'élevage caprin (120 chèvres).
Le pilote est de type cultures fixées avec infiltration et percolation sur lit de pouzzolane.
Un dispositif permet de suivre la qualité des eaux traitées.
Les dispositifs présents sur le site traitent les eaux blanches de fromagerie et le lactosérum issus de l'élevage caprin (120 chèvres).
Le pilote est de type cultures fixées avec infiltration et percolation sur lit de pouzzolane.
Un dispositif permet de suivre la qualité des eaux traitées.
Résultats
Les solutions apportées par l'expérimentation permettent entre autres :
- Abattement de 95 %de la charge polluante
- Investissement réalisable sur une exploitation
Les solutions apportées par l'expérimentation permettent entre autres :
- de respecter la réglementation sur la nature des rejets en milieu naturel,
- de supprimer les impacts négatifs des rejets bruts d'effluents dans des milieux sensibles,
- d'apporter des solutions techniques aux éleveurs soucieux d'une gestion éco-citoyenne de leur environnement,
- de répondre aux attentes des éleveurs grâce à des investissements limités.
Utilisation pédagogique
- Sensibilisation des élèves du lycée agricole et des apprenants du CFPPA (relation agriculture/environnement).
- Etude de cas dans les formations spécifiques caprines et transformations fromagères.
Autre valorisation
- Démonstration en direction des professionnels
- Communication grand public en projet (Pédagogie développement durable, Fête de la Science)
Calendrier
- Réflexion initiée en 1991 (enquêtes sur les effluents de fromagerie).
- Mise en place des pilotes : 1995 et 1999
- Phase de pré-développement en fermes : 2001
- Actuellement : suivi des dispositifs et prévision de test de pilotes supplémentaires.
Perspective
- mise en place d'une plate-forme comparative et démonstrative de différents dispositifs de traitement,
- développement de test sur d'autres systèmes : lombrifiltre, "oxyfix".
Partenariats techniques/financiers
- Maître d'ouvrage : EPL Olivier de Serres / Pôle d'excellence et de progrès caprin
- Institut de l'Elevage
- CEMAGREF
Fichier : fichierinitiative1_poster_Aubenas_effluentsfromagerie.pdf
Télécharger
Lien vers vidéo de présentation (1)
http://www.dailymotion.com/video/xgpdad_traitement-des-effluents-d-elevage-caprin_school
Gestion durable de l'eau sur l'exploitation viticole (Blanquefort - Gironde)
Nom de la structure
Château Dillon, EPL Bordeaux-Gironde
Téléphone
05 56 95 39 94
Contact (courriel)
Elisabeth.galineau@educagri.fr
Contact2 (courriel)
Valerie.laplace@educagri.fr
Site Web
http://www.chateau-dillon.com
Code postal
33294
Ville
Blanquefort
Département
Gironde
Type d'initiative
- économie d'eau
- traitement des effluents
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
Engagée depuis 2001 sur une démarche globale qualité et de préservation de l'environnement, l'exploitation de Château Dillon (180 ha dont 44 ha en vignes) a mis en place de nombreuses actions innovantes et exemplaires...
Engagée depuis 2001 sur une démarche globale qualité et de préservation de l'environnement, l'exploitation de Château Dillon (180 ha dont 44 ha en vignes) a mis en place de nombreuses actions innovantes et exemplaires...
Objectif
- consommer moins de 2 l d'eau pour produire 1 l de vin
- réduire les intrants phytosanitaires
- traiter les effluents
Description de l'action
- pas d'irrigation
- choix raisonné des traitements phytos et matériels performants (cf. fiches actions à télécharger)
- bandes enherbées généralisées
- abandon de la fertilisation
- épamprage et désherbage mécanique, uniquement sous le rang
- aire de lavage/remplissage, local de produits phytosanitaires aux normes
- réduction des consommations d'eau dans le chai (rinçage, nettoyage, refroidissement) : cf. fiche action à télécharger
- séparation des effluents (eaux pluviales, effluents viticoles, effluents vinicoles)
- station de traitement des effluents vinicoles et phytosanitaires (traitement biologique boues activées + floculation-coagulation, cf. schéma)
Utilisation pédagogique
Sensibilisation et implication de tous les apprenants et stagiaires dans la démarche qualité
Sensibilisation et implication de tous les apprenants et stagiaires dans la démarche qualité
Autre valorisation
- communication interne au niveau de l'EPL
- communication externe à l'EPL
- audits internes et externes
- partenaires professionnels et institutionnels
Calendrier
- certification ISO 14001 en 2004
- Pôle de compétence "Phytosanitaires, pollutions diffuse et ponctuelle" en 2005
- qualification "Agriculture raisonnée" en 2006
- management intégré depuis 2007 (sécurité alimentaire et traçabilité-HACCP ; santé et sécurité au travail-OHSAS 18001)
- Plan Ecophyto 2018 en 2010
Partenariats techniques/financiers
- DRAAF/SRAAL
- Conseil régional Aquitaine
- Chambre d'Agriculture de la Gironde
- Institut français de la vigne et du vin
- Groupe régional d'action phytosanitaire
- CUMA
- Agence de l'eau Adour-Garonne
Fichier : fichierinitiative1_ficheactiontraittphyto.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative2_ficheactionexpviti2010.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative3_ficheactionconsoeau.pdf
Télécharger
Gestion économe de l'eau en maraichage : puits, goutte-à-goutte, jarres poreuses connectées (Albi - Tarn)
Nom de la structure
EPLEFPA du Tarn à Albi- "Les Jardiniers du Prestil"
Téléphone
05 63 49 43 70
Contact (courriel)
claire.ponthus@educagri.fr
Contact2 (courriel)
eric.cazes@educagri.fr
Contact3 (courriel)
jonathan.dassonville@educagri.fr
Site Web
http://www.tarn.educagri.fr
Code postal
81000
Ville
Albi
Département
Tarn
Type d'initiative
- économie d'eau
- systèmes de culture
Contexte
"Les jardiniers du Prestil" sont un chantier d’insertion, géré par le CFPPA, pour ouvriers maraichers, en AB (6 ETP par an, soit 5 à 12 personnes sur l’année et 1,5 ETP d’encadrement). Plus de 50 légumes différents sont cultivés/an, 48 arbres fruitiers (d'une douzaine d'essences différentes) en verger agroforestier, des légumineuses (pois chiches) ... et 14 ruches.
Sur 2,2 ha de surface totale, il y avait en 2019 : 9 ilots de légumes plein champ irrigables de 800 m2 chacun (8 par aspersion et 1 goutte à goutte) et 800 m2 de serres froides en double tunnel (400 m2 par aspersion et 400 m2 en goutte à goutte), pour un volume d'eau nécessaire d'environ 1 800 m3/an
En 2020, l'extension de la sole à irriguée rajoute 3 ilots de légumes plein champ irrigables de 800 m2 chacun (2 par aspersion et 1 goutte à goutte) et un verger de 2 000 m2 en goutte à goutte, pour un volume d'eau nécessaire d'environ 2 600 m3/an.
Les besoins en eau sont normalement assurés de novembre à mai par un puits avec pompe immergée, et de juin à octobre par de l'eau du réseau communal. Or, en 2019, la commune annule l'autorisation de l'utilisation d'eau du réseau d'eau potable...
Sur 2,2 ha de surface totale, il y avait en 2019 : 9 ilots de légumes plein champ irrigables de 800 m2 chacun (8 par aspersion et 1 goutte à goutte) et 800 m2 de serres froides en double tunnel (400 m2 par aspersion et 400 m2 en goutte à goutte), pour un volume d'eau nécessaire d'environ 1 800 m3/an
En 2020, l'extension de la sole à irriguée rajoute 3 ilots de légumes plein champ irrigables de 800 m2 chacun (2 par aspersion et 1 goutte à goutte) et un verger de 2 000 m2 en goutte à goutte, pour un volume d'eau nécessaire d'environ 2 600 m3/an.
Les besoins en eau sont normalement assurés de novembre à mai par un puits avec pompe immergée, et de juin à octobre par de l'eau du réseau communal. Or, en 2019, la commune annule l'autorisation de l'utilisation d'eau du réseau d'eau potable...
Objectif
- Augmenter la productivité maraichère et fruitière tout en faisant des économies d'eau
- Trouver une solution alternative à l'utilisation d'eau de réseau pour l'approvisionnement
- Expérimenter des solutions pour une meilleure efficience de l'irrigation afin de diminuer les consommations
Description de l'action
1/ préservation de la ressource "sol" : non labour, engrais vert, traction animale (cheval)
2/ diagnostic de la gestion de l’eau (bilan quantitatif et qualitatif, inventaire de la ressource, analyses physicochimiques et bactériologiques des eaux de puits) + coûts associés, réalisé en 2019 par BTS GEMEAU (projet M54)
3/ mai 2020 : réalisation d'un forage pour un nouveau puits de substitution (nappe à 9 m) à côté des serres + filtre à sable + pompe + raccordement à la cuve de régulation (de 10 m3) - cf. pj 1
4/ optimisation des quantités d'eau à utiliser en sol type boulbène (irrigations déclenchées lorsque le déficit hydrique atteint 30 mm) par pilotage fin des tours notamment sur la période d'utilisation maximale de l'installation d'arrosage (juillet)
5/ changement progressif de l'irrigation par aspersion en irrigation goutte à goutte (économie de 28 m3/an par exemple sur une campagne d'irrigation pour un ilot de pommes de terre) : à terme, 8 ilots en goutte à goutte et 4 ilots par aspersion (pour les cultures produites par semis). soit près de 300 m3/an économisés sur 8 ilots passés en goutte à goutte (représentant 22% des apports)
6/ expérimentation jarres poreuses connectées - cf. pj 2
mise en place en 2016 : construction des casiers en bois, mise en oeuvre des substrats, nstallation des jarres et des tensiomètres
1ère culture hiver 2016-2017 : mesure manuelle de la tensiométrie et du niveau d’eau dans les jarres
2ème culture été 2017 : partenariat avec l’entreprise Dralam pour la mise en place d’objets connectés, relevé à distance des valeurs de tensiométrie et du niveau TOR dans les jarres, envoi alerte téléphonique lorsque niveau d’eau atteint le seuil bas dans les jarres
7/ réfection de la zone de lavage des légumes
2/ diagnostic de la gestion de l’eau (bilan quantitatif et qualitatif, inventaire de la ressource, analyses physicochimiques et bactériologiques des eaux de puits) + coûts associés, réalisé en 2019 par BTS GEMEAU (projet M54)
3/ mai 2020 : réalisation d'un forage pour un nouveau puits de substitution (nappe à 9 m) à côté des serres + filtre à sable + pompe + raccordement à la cuve de régulation (de 10 m3) - cf. pj 1
4/ optimisation des quantités d'eau à utiliser en sol type boulbène (irrigations déclenchées lorsque le déficit hydrique atteint 30 mm) par pilotage fin des tours notamment sur la période d'utilisation maximale de l'installation d'arrosage (juillet)
5/ changement progressif de l'irrigation par aspersion en irrigation goutte à goutte (économie de 28 m3/an par exemple sur une campagne d'irrigation pour un ilot de pommes de terre) : à terme, 8 ilots en goutte à goutte et 4 ilots par aspersion (pour les cultures produites par semis). soit près de 300 m3/an économisés sur 8 ilots passés en goutte à goutte (représentant 22% des apports)
6/ expérimentation jarres poreuses connectées - cf. pj 2
mise en place en 2016 : construction des casiers en bois, mise en oeuvre des substrats, nstallation des jarres et des tensiomètres
1ère culture hiver 2016-2017 : mesure manuelle de la tensiométrie et du niveau d’eau dans les jarres
2ème culture été 2017 : partenariat avec l’entreprise Dralam pour la mise en place d’objets connectés, relevé à distance des valeurs de tensiométrie et du niveau TOR dans les jarres, envoi alerte téléphonique lorsque niveau d’eau atteint le seuil bas dans les jarres
7/ réfection de la zone de lavage des légumes
Utilisation pédagogique
Participation de classes: Bac Pro Production Horticole du CFPPA, CAPA Métier de l’Agriculture, CAPA Jardiniers Paysagistes du CFA, Terminale Bac Pro PH Lycée, BTS GEMEAU, 1ère STAV...
Autre valorisation
Présentation lors de la Journée technique de la 11e Semaine de l'eau (Lavaur, 15 mars 2018)
Support de la Journée technique "eau et agriculture : gestion de l'eau en maraichage biologique (16 octobre 2020)
Support de la Journée technique "eau et agriculture : gestion de l'eau en maraichage biologique (16 octobre 2020)
Perspective
Installation de sondes tensiométriques sur les parcelles en maraichage
Améliorations à créer autour du système connecté et du remplissage automatique des jarres sur l'expérimentation PIJPOC
Améliorations à créer autour du système connecté et du remplissage automatique des jarres sur l'expérimentation PIJPOC
Partenariats techniques/financiers
Chambre d'agriculture, Agence de l'eau Adour-Garonne, Fonds de développement de l'inclusion, Fonds social européen, équipementiers (Agricontrol, Oyas-Environnement, Dralam technologies,...)
Fichier : PermacultureEtIrrigationAvecJarresPoreuses_fichierinitiative1_puits_jardins-prestil_albi.pdf
Télécharger
Fichier : PermacultureEtIrrigationAvecJarresPoreuses_fichierinitiative2_jarres-poreuse-connectees_albi.pdf
Télécharger


Gestion économe de l'eau en verger de pommiers : comparaison de systèmes de pilotage (Carpentras - Vaucluse)
Nom de la structure
EPLEA Louis Giraud
Téléphone
04 90 62 77 17
Contact (courriel)
Myriam.BERUD@educagri.fr
Contact2 (courriel)
Pierre-Yves.PERROUD@educagri.fr
Contact3 (courriel)
exploit.stvictor@orange.fr
Site Web
http://campus.louisgiraud.online.fr
Code postal
84200
Ville
Carpentras
Département
Vaucluse
Type d'initiative
- économie d'eau
- systèmes de culture
Contexte
Le pilotage des irrigations en verger est couramment réalisé par relevé de sondes tensiométriques qui donnent une indication sur la disponibilité de l'eau dans le sol.
Des outils nouveaux basés sur des mesures capacitives permettent d'évaluer des teneurs en eau du sol à différentes profondeurs. Des seuils de pilotage sont à définir. Ces nouvelles mesures sont actuellement mises en comparaison avec les outils déjà à disposition pour piloter l'arrosage d'un verger.
Le pilotage des irrigations en verger est couramment réalisé par relevé de sondes tensiométriques qui donnent une indication sur la disponibilité de l'eau dans le sol.
Des outils nouveaux basés sur des mesures capacitives permettent d'évaluer des teneurs en eau du sol à différentes profondeurs. Des seuils de pilotage sont à définir. Ces nouvelles mesures sont actuellement mises en comparaison avec les outils déjà à disposition pour piloter l'arrosage d'un verger.
Objectif
- Parvenir à une gestion du déclenchement et des doses d'arrosage qui permettent à la fois une récolte rentable et qualitative dans un souci d'économie d'eau et en adéquation aux besoins du verger.
- Evaluer dans quelle mesure un nouveau type de matériel, basé sur une autre technologie que celle couramment utilisée, peut contribuer à améliorer la gestion raisonnée de l'irrigation en verger en conditions méditerranéennes.
Description de l'action
Un verger de pommier d'1.40 ha de l'exploitation de l'EPL Louis Giraud à Carpentras est support de deux zones de pilotage différencié pour les arrosages en micro-aspersion : une zone pilotée a partir des données enregistrées par des sondes tensiométriques (type Watermark Monitor), une zone pilotée à partir des données enregistrées par des sondes capacitives (Enviroscan Diviner). Les deux types de matériel sont également présents dans chacune des zones, ainsi que des enregistreurs mesurant des variations micro-morphométriques sur branche (système Pépista). Des compteurs d'eau permettent de quantifier les doses réellement apportées à chaque arrosage. Des mesures sur le rendement, les calibres et la coloration des fruits permettent d'évaluer la qualité de la récolte. Un groupe de travail créé autour de cette action permet l'analyse chaque semaine des données enregistrées et décide collectivement du déclenchement de l'irrigation et de la dose a apporter. En 2007, 1ère année d'étude, des seuils ont été définis pour les sondes capacitives. En 2008, les doses apportées dans les 2 secteurs sont très comparables. Suite à l'analyse des données 2008, il apparaît que, dans la zone à pilotage par sondes capacitives, les seuils pourraient être abaissés sans stress sur la plante et permettre des économies d'eau plus prononcées. L'action se poursuit en 2009.
Un verger de pommier d'1.40 ha de l'exploitation de l'EPL Louis Giraud à Carpentras est support de deux zones de pilotage différencié pour les arrosages en micro-aspersion : une zone pilotée a partir des données enregistrées par des sondes tensiométriques (type Watermark Monitor), une zone pilotée à partir des données enregistrées par des sondes capacitives (Enviroscan Diviner). Les deux types de matériel sont également présents dans chacune des zones, ainsi que des enregistreurs mesurant des variations micro-morphométriques sur branche (système Pépista). Des compteurs d'eau permettent de quantifier les doses réellement apportées à chaque arrosage. Des mesures sur le rendement, les calibres et la coloration des fruits permettent d'évaluer la qualité de la récolte. Un groupe de travail créé autour de cette action permet l'analyse chaque semaine des données enregistrées et décide collectivement du déclenchement de l'irrigation et de la dose a apporter. En 2007, 1ère année d'étude, des seuils ont été définis pour les sondes capacitives. En 2008, les doses apportées dans les 2 secteurs sont très comparables. Suite à l'analyse des données 2008, il apparaît que, dans la zone à pilotage par sondes capacitives, les seuils pourraient être abaissés sans stress sur la plante et permettre des économies d'eau plus prononcées. L'action se poursuit en 2009.
Utilisation pédagogique
- Stage EATC (Ecologie, Agronomie, Territoire et Citoyenneté) des classes de Seconde
- Classes de BEPA Productions Horticoles (Productions fruitières et Pépinières)
- Premières et Terminales STAV (Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant)
- CFPPA : formation BP Responsable d'Exploitation Agricole
Autre valorisation
- Publications régionales et nationales envisagées par voie de presse (revues techniques spécialisées, presse locale)
- Participation à des réunions techniques, colloques de nos partenaires a destination du milieu professionnel agricole (ex. : « Après-midi technique La Pugère » en septembre 2007).
Calendrier
- 2007 : mise en place du matériel de mesure au verger, acquisition de données sur sondes capacitives, analyse et définition des seuils de pilotage
- 2008 : mise en place de deux zones différenciées de pilotage de l'arrosage avec installation de nouveaux matériels, suivi et analyse des données
- 2009 : poursuite du pilotage différencié ; synthèse des 3 années d'étude
Partenariats techniques/financiers
techniques :
- Station d'expérimentation La Pugère 13370 MALEMORT
- EPLEA Louis Giraud Exploitation agricole BP 274 84200 CARPENTRAS
- ARDEPI Association Régionale pour la Maîtrise des Irrigations - Maison des Agriculteurs 22 avenue Henri Pontier 13626 AIX EN POVENCE
- CIRAME Centre Inter-régional Agrométéo Chemin de l'Hermitage 84200 CARPENTRAS
- GRCETA Basse Durance Route de Mollèges 13210 ST-REMY DE PROVENCE
- VINIFLHOR dans le cadre du programme d'expérimentation de la Station régionale LA PUGERE
- CRIPT PACA
- Autofinancement
Fichier : fichierinitiative1_poster_Carpentras_verger.pdf
Télécharger
Gestion et protection durable de l’eau : Réflexion et mises en œuvre de systèmes agricoles innovants (Le Mans - Sarthe)
Nom de la structure
EPLEFPA Le Mans - La Germinère
Téléphone
02 43 47 82 00
Contact (courriel)
elisabeth.rousseau99@educagri.fr
Site Web
https://agrocampus-lagerminiere.fr/
Code postal
72 700
Ville
Rouillon
Département
Sarthe
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- économie d'eau
- milieu naturel
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
L'Agrocampus de la Germinière (dont les terres comptent 2 sources de cours d'eau : le Chaumard et le Beaufeu) est maître d'ouvrage du Contrat territorial Eau Sarthe médiane 2022-2024 (CTEau) afin d’atteindre l'objectif de bon état des eaux (dont la qualité s'est dégradée ces 2 dernières décennies du fait de l'utilisation d'engrais et de pesticides par l'agriculture sur le bassin). Le projet de développement de l'établissement 2023-2026 (dispositif d'aide de la DGER) vise à repenser et à accompagner l’adaptation des systèmes de production animale et végétale vers des systèmes plus autonomes et plus économes (en eau, en intrants). L’enjeu est de structurer un groupe de travail, de réunir des enseignants, des agriculteurs, des experts issus de différents services et de proposer des mises en situation aux apprenants.
Objectif
- Sensibiliser et responsabiliser l’ensemble de la communauté éducative (citoyens) à la préservation de la ressource eau
- Mobiliser les enseignants sur l’agroécologie et la thématique de l’eau à travers des projets, des études de cas et des visites
- Utiliser l’exploitation et le hall agroéquipement de l’Agrocampus pour les apprentissages, les démonstrations et l’expérimentation afin de réduire les impacts sur l’eau
- Développer l’animation sur le territoire et diffuser l’information auprès de divers publics
- Mobiliser les enseignants sur l’agroécologie et la thématique de l’eau à travers des projets, des études de cas et des visites
- Utiliser l’exploitation et le hall agroéquipement de l’Agrocampus pour les apprentissages, les démonstrations et l’expérimentation afin de réduire les impacts sur l’eau
- Développer l’animation sur le territoire et diffuser l’information auprès de divers publics
Description de l'action
- interventions en classes : exposés, jeux de rôles, escape game, ... (CPIE, CIVAM, chambre d'agriculture, syndicat de bassin, animatrice de captage, ...)
- journées thématiques sur l'établissement (écophyto, agroécologie, captages d'eau,...)
- visites et rencontres de terrain (exploitations innovantes du territoire, restaurations de cours d'eau, ripisylves et zones humides, stations d'épuration, captages, ...)
- actions sur l'exploitation et le hall agroéquipements (limitation de la consommation en eau - irrigation - , des traitements sur le troupeau laitier, des rejets d'effluents, développement des expérimentations)
- chantier-école restauration du Beaufeu et du Chaumard, création de mares, analyses d'eau
- développement des partenariats sur le territoire
- journées thématiques sur l'établissement (écophyto, agroécologie, captages d'eau,...)
- visites et rencontres de terrain (exploitations innovantes du territoire, restaurations de cours d'eau, ripisylves et zones humides, stations d'épuration, captages, ...)
- actions sur l'exploitation et le hall agroéquipements (limitation de la consommation en eau - irrigation - , des traitements sur le troupeau laitier, des rejets d'effluents, développement des expérimentations)
- chantier-école restauration du Beaufeu et du Chaumard, création de mares, analyses d'eau
- développement des partenariats sur le territoire
Utilisation pédagogique
- les actions de sensibilisation sur la ressource eau sont menées au niveau de toutes les classes de l'établissement
- focus sur la qualité de la ressource avec la classe de Terminale STAV, à partir d’une action sur le Chaumard, cours d’eau de l’exploitation du lycée (impact des infrastructures agroécologiques)
- focus sur la gestion quantitative de la ressource avec la classe de Terminale CGEA (ACS, machinisme, rétention d’eau par le sol)
- complémentaire à la maquette-simulateur de pluie, mise en place d'une parcelle d'expérimentation sur les outils permettant de diminuer les consommations en eau
- appropriation de la grille d'analyse Efficience - Substitution - Reconception et utilisation de diagnostics de durabilité
- pour les 2nd agro-équipement en EIE Innovation, réfléchir sur la problématique : réduction d’eau sur l’exploitation, avec un jury d’experts
- focus sur la qualité de la ressource avec la classe de Terminale STAV, à partir d’une action sur le Chaumard, cours d’eau de l’exploitation du lycée (impact des infrastructures agroécologiques)
- focus sur la gestion quantitative de la ressource avec la classe de Terminale CGEA (ACS, machinisme, rétention d’eau par le sol)
- complémentaire à la maquette-simulateur de pluie, mise en place d'une parcelle d'expérimentation sur les outils permettant de diminuer les consommations en eau
- appropriation de la grille d'analyse Efficience - Substitution - Reconception et utilisation de diagnostics de durabilité
- pour les 2nd agro-équipement en EIE Innovation, réfléchir sur la problématique : réduction d’eau sur l’exploitation, avec un jury d’experts
Autre valorisation
- Réseaux sociaux de l'établissement, presse locale, presse agricole
- Compte-rendus réguliers lors de chaque conseil intérieur
- Journées techniques et thématiques ouvertes aux partenaires et autres acteurs du territoire
- Actions à destination d’autres apprenants (collèges, lycées et/ou lycées agricoles) et des agriculteurs (expérimentation, démonstration)
- Outils réalisés mis à disposition des équipes pédagogiques sur l’établissement, mais aussi auprès d’agriculteurs et d’entreprises partenaires
- Affichage de panneaux sur les chantiers réalisés
- Journée agroécologie 28 mars 2024 (labellisée "Printemps des transitions" de l'enseignement agricole) : voir le reportage vidéo, affiche-programme et article presse professionnelle locale en pj
- article site adt.educagri.fr
- Compte-rendus réguliers lors de chaque conseil intérieur
- Journées techniques et thématiques ouvertes aux partenaires et autres acteurs du territoire
- Actions à destination d’autres apprenants (collèges, lycées et/ou lycées agricoles) et des agriculteurs (expérimentation, démonstration)
- Outils réalisés mis à disposition des équipes pédagogiques sur l’établissement, mais aussi auprès d’agriculteurs et d’entreprises partenaires
- Affichage de panneaux sur les chantiers réalisés
- Journée agroécologie 28 mars 2024 (labellisée "Printemps des transitions" de l'enseignement agricole) : voir le reportage vidéo, affiche-programme et article presse professionnelle locale en pj
- article site adt.educagri.fr
Calendrier
Projet "Porteur de projet de développement" 2023-2026
Perspective
Les partenariats développés se poursuivent pour continuer à former les jeunes sur ce bien commun et à préserver la ressource.
Partenariats techniques/financiers
Agence de l’Eau, région Pays de la Loire, Syndicat du Bassin de la Sarthe, CIVAM, CPIE, APAD, FDCUMA, Chambre d’agriculture de la Sarthe, CEN, Le Mans Métropole, DRAAF.
Les enseignants peuvent bénéficier d’un financement CTEau pour les activités pédagogiques conduisant à la préservation de la ressource
Les enseignants peuvent bénéficier d’un financement CTEau pour les activités pédagogiques conduisant à la préservation de la ressource
Fichier : AFFICHE_JAE_Eau.pdf
Télécharger
Fichier : Article_Agri_72_5avr2024.pdf
Télécharger
Impact des pratiques culturales champenoises sur la ressource en eau (Avize - Marne)
Nom de la structure
Avize viticampus (CFPPA)
Téléphone
03 26 57 97 49
Contact (courriel)
frederique.jacob@avizeviticampus.fr
Site Web
http://www.avizeviticampus.fr/
Adresse postale
61 Avenue de Mazagran
Code postal
51190
Ville
Avize
Département
Marne
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- qualité de l'eau
Contexte
De nombreuses actions sont menées depuis quelques années par le CIVC et la chambre d'agriculture de la Marne pour inciter les viticulteurs champenois à réduire leur impact sur la ressource en eau.
C'est pourquoi en partenariat avec ces structures, le CFPPA d'Avize a organisé trois journées de formation pour réduire l'impact de la viticulture sur la ressource en eau potable.
De nombreuses actions sont menées depuis quelques années par le CIVC et la chambre d'agriculture de la Marne pour inciter les viticulteurs champenois à réduire leur impact sur la ressource en eau.
C'est pourquoi en partenariat avec ces structures, le CFPPA d'Avize a organisé trois journées de formation pour réduire l'impact de la viticulture sur la ressource en eau potable.
Objectif
- accompagner les professionnels du secteur viticole dans l'évolution de leur pratique en matière de gestion de la ressource en eau.
- élaborer un plan de progrès adapté à chaque structure.
Description de l'action
1ère journée : intervention de l'agence de l'eau sur la Directive Eau et l'impact de la viticulture sur la ressource en eau. Analyse de l'auto diagnostic de chaque participant et présentation du calculateur IFT par le CIVC ;
2ème journée : intervention de la chambre d'agriculture sur les méthodes de réduction de doses et l'expérience des réseaux DEPHY. Présentation du matériel viticole et des nouveautés par le CIVC et la chambre d'agriculture ;
3ème journée : élaboration d'un plan de progrès adapté à chaque structure. Visites sur le terrain.
1ère journée : intervention de l'agence de l'eau sur la Directive Eau et l'impact de la viticulture sur la ressource en eau. Analyse de l'auto diagnostic de chaque participant et présentation du calculateur IFT par le CIVC ;
2ème journée : intervention de la chambre d'agriculture sur les méthodes de réduction de doses et l'expérience des réseaux DEPHY. Présentation du matériel viticole et des nouveautés par le CIVC et la chambre d'agriculture ;
3ème journée : élaboration d'un plan de progrès adapté à chaque structure. Visites sur le terrain.
Calendrier
la formation a eu lieu sur 3 jours en mars 2014
Partenariats techniques/financiers
Cette formation professionnelle est la première organisée avec les interventions techniques de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, de la chambre d'agriculture de la Marne et du CIVC.
Le coût financier de ces journées d'échanges est pris en charge par l'Agence de l'eau Seine-Normandie.
Cette formation professionnelle est la première organisée avec les interventions techniques de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, de la chambre d'agriculture de la Marne et du CIVC.
Le coût financier de ces journées d'échanges est pris en charge par l'Agence de l'eau Seine-Normandie.
Fichier : fichierinitiative1_Programme_eau.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative2_Formation_eau.pdf
Télécharger
Lien vers vidéo de présentation (1)
http://www.dailymotion.com/video/x1ob1pu_reims-classe-eau-viticulteurs-2014_school
Vidéo de présentation (1)
Impact des pratiques de maraîchage sur la qualité de l’eau (Wintzenheim - Haut-Rhin)
Nom de la structure
EPLEFPA Les Sillons de Haute Alsace
Téléphone
03.89.27.21.27
Contact (courriel)
guillaume.delaunay@educagri.fr
Contact2 (courriel)
gilles.cloitre@educagri.fr
Contact3 (courriel)
karen.saccardy@educagri.fr
Code postal
68920
Ville
Wintzenheim
Département
Haut-Rhin
Type d'initiative
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
En Alsace, outre les pesticides utilisés en agriculture, les nitrates constituent la deuxième cause importante de dégradation de la qualité de l’eau, avec un impact sur la santé humaine et l’environnement. Dans une situation de sol drainant (sol sablo-limoneux peu profond), le recours à du travail du sol intensif en maraîchage couplé à d’importants apports de matières organiques (composts, engrais) peut présenter des risques de pertes d’azote, que la réduction du travail du sol, l’ajustement des apports organiques, la couverture du sol et la présence accrue d’engrais verts et couverts végétaux par exemple dans les systèmes de culture innovants peut permettre de limiter.
Depuis 2013, le projet SEFerSol (Stratégies innovantes d’Entretien de la Fertilité du Sol) prévoit de mesurer les impacts de ces systèmes de cultures alternatifs...
Depuis 2013, le projet SEFerSol (Stratégies innovantes d’Entretien de la Fertilité du Sol) prévoit de mesurer les impacts de ces systèmes de cultures alternatifs...
Objectif
Observer l’impact sur la qualité de l’eau et évaluer les performances globales de deux stratégies innovantes de gestion combinée de l’enherbement et de la fertilité du sol, à très bas niveaux d’intrants, en les comparant à une stratégie plus classique de maraîchage biologique (REFERENCE) : Sdc maximisant l’usage des engrais verts en planches permanentes sans engrais (ENGRAIS VERT MAX), Sdc adaptant l’agriculture de conservation des sols : couverture et planches permanentes, réduction du travail et emploi d'engrais (CONSERVATION DES SOLS)
Description de l'action
Après trois années de mise en œuvre entre 2015 et 2017, le projet se poursuit sur la période 2018-2023 grâce à son intégration dans le réseau Ecophyto DEPHY Expé.
depuis 2015 : mesures régulières de reliquats azotés (ions nitrates et ions ammoniums) réalisées dans les 20 premiers centimètres de sol
2017 : installation sous une des parcelles d'un réseau de 24 bougies poreuses (8 bougies poreuses pour chacun des trois systèmes de culture) capables de récupérer les eaux de drainage en profondeur (90cm) afin d’en mesurer la concentration en nitrates
2018 : Après une année complète durant laquelle le sol a pu se réorganiser, l’installation de récupération des eaux de drainage a été finalisée à l’automne 2018. 7 prélèvements ont été réalisés, à un intervalle moyen de 15 jours entre chaque prélèvement. L’objectif est de récupérer de l’eau de drainage pendant toute la période de drainage (octobre à juin approximativement). L’eau entrée dans la bougie est récupérée, mesurée (volume) et envoyée au laboratoire pour analyse de concentration en nitrates.
depuis 2015 : mesures régulières de reliquats azotés (ions nitrates et ions ammoniums) réalisées dans les 20 premiers centimètres de sol
2017 : installation sous une des parcelles d'un réseau de 24 bougies poreuses (8 bougies poreuses pour chacun des trois systèmes de culture) capables de récupérer les eaux de drainage en profondeur (90cm) afin d’en mesurer la concentration en nitrates
2018 : Après une année complète durant laquelle le sol a pu se réorganiser, l’installation de récupération des eaux de drainage a été finalisée à l’automne 2018. 7 prélèvements ont été réalisés, à un intervalle moyen de 15 jours entre chaque prélèvement. L’objectif est de récupérer de l’eau de drainage pendant toute la période de drainage (octobre à juin approximativement). L’eau entrée dans la bougie est récupérée, mesurée (volume) et envoyée au laboratoire pour analyse de concentration en nitrates.
Résultats
Même s'il est trop tôt pour analyser d’éventuelles différences entre les Sdc, la quantité d’azote potentiellement lixiviée sur les systèmes innovants semble plus faible, notamment sur le système «Engrais Vert Max» (53% de réduction par rapport au Sdc REFERENCE), probablement en raison de la forte présence d’engrais verts dans les successions de culture et de l’absence de fertilisation organique.
La concentration maximale mesurée a atteint 38 mg/litre mais la majorité des mesures (plus de 90%) a donné des résultats inférieurs à 20 mg/litre.
Il est intéressant de noter que jusqu’à la fin de récolte des poireaux mi-mars 2019, on a observé pour les 3 Sdc une différence de concentration en nitrates des eaux de drainage entre les planches où les poireaux étaient complètement récoltés (teneurs en nitrates plus élevées, approchant ou dépassant le seuil de potabilité) et celles où les poireaux n’étaient pas encore récoltés (concentration inférieures à 10 mg/litre) confirmant que les plantes vivantes en hiver jouent un rôle important dans la fixation des nitrates issus de la minéralisation, a fortiori quand leur système racinaire est bien développé, ce qui est le cas de la culture de poireaux plantée en juin 2018.
La concentration maximale mesurée a atteint 38 mg/litre mais la majorité des mesures (plus de 90%) a donné des résultats inférieurs à 20 mg/litre.
Il est intéressant de noter que jusqu’à la fin de récolte des poireaux mi-mars 2019, on a observé pour les 3 Sdc une différence de concentration en nitrates des eaux de drainage entre les planches où les poireaux étaient complètement récoltés (teneurs en nitrates plus élevées, approchant ou dépassant le seuil de potabilité) et celles où les poireaux n’étaient pas encore récoltés (concentration inférieures à 10 mg/litre) confirmant que les plantes vivantes en hiver jouent un rôle important dans la fixation des nitrates issus de la minéralisation, a fortiori quand leur système racinaire est bien développé, ce qui est le cas de la culture de poireaux plantée en juin 2018.
Utilisation pédagogique
Lien au module "expérimentation" avec les BTSA Productions horticoles
Autre valorisation
blog : https://polemaraichage.com/evaluer-limpact-des-pratiques-de-maraichage-sur-la-qualite-de-leau/
documentation du projet : https://polemaraichage.com/experimentations/sefersol/documentation-sefersol/
film vidéo : cf. lien ci-dessous
article : https://www.adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/grand-est/wintzenheim-maraichage-ab-experimentation.html
documentation du projet : https://polemaraichage.com/experimentations/sefersol/documentation-sefersol/
film vidéo : cf. lien ci-dessous
article : https://www.adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/grand-est/wintzenheim-maraichage-ab-experimentation.html
Partenariats techniques/financiers
cf. https://polemaraichage.com/nos-partenaires/


Lien vers vidéo de présentation (1)
https://www.youtube.com/watch?v=cyY1zYBiQGs
Incorporation localisée de l'azote sur le rang de semis (Somme-Vesles - Marne / Rethel - Ardennes)
Nom de la structure
EPLEFPA de RETHEL - EPLEFPA de Somme-Vesle
Téléphone
03 24 39 60 00
Contact (courriel)
Etienne.ROUSSEL@educagri.fr
Contact2 (courriel)
Gerard.POIRSON@educagri.fr
Site Web
http://www.lyceeagricole-rethel.fr
Code postal
08300
Ville
Rethel
Département
Ardennes
Type d'initiative
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
L'exploitation se situe dans le sud du département des Ardennes, dans une petite région céréalière. L'action est mise en place pour limiter l'utilisation d'intrants en agriculture, et dans un objectif de démonstration à destination des apprenants.
L'exploitation se situe dans le sud du département des Ardennes, dans une petite région céréalière. L'action est mise en place pour limiter l'utilisation d'intrants en agriculture, et dans un objectif de démonstration à destination des apprenants.
Description de l'action
L'incorporation localisée de l'azote sur le rang de semis vise une réduction des apports en les limitant au niveau du rang de semis de la culture.
Les cultures de mais et de betterave ont servi de support à cette expérimentation qui a porté sur plusieurs facteurs :
L'incorporation localisée de l'azote sur le rang de semis vise une réduction des apports en les limitant au niveau du rang de semis de la culture.
Les cultures de mais et de betterave ont servi de support à cette expérimentation qui a porté sur plusieurs facteurs :
- l'économie d'intrants réalisée,
- les effets sur le rendement de la culture,
- l'impact en terme de calendrier de travail,
- les conditions de rentabilité de l'investissement matériel nécessaire à ce type d'apport.
Résultats
Aucun impact sur le rendement de mais n'a été constaté. Il y a eu un impact sur le rendement de la betterave la 1ère année, mais cela est aussi fonction de la quantité d'azote apportée à cette culture. Cette technique n'implique pas de temps de travail supplémentaire.
Aucun impact sur le rendement de mais n'a été constaté. Il y a eu un impact sur le rendement de la betterave la 1ère année, mais cela est aussi fonction de la quantité d'azote apportée à cette culture. Cette technique n'implique pas de temps de travail supplémentaire.
Utilisation pédagogique
Les apprenants ont participé à la mise en place de l'action de démonstration et à son suivi.
Les apprenants ont participé à la mise en place de l'action de démonstration et à son suivi.
Autre valorisation
L'action a été présentée dans le cadre des journées portes ouvertes.
L'action a été présentée dans le cadre des journées portes ouvertes.
Calendrier
action terminée (2005-2006)
action terminée (2005-2006)
Partenariats techniques/financiers
Action intégrée dans le cadre du réseau des exploitations des EPLEFPA de Champagne-Ardenne
Action intégrée dans le cadre du réseau des exploitations des EPLEFPA de Champagne-Ardenne
- Agence de l'Eau Seine-Normandie
- Conseil Régional de Champagne-Ardenne
Fichier : fichierinitiative1_poster_Rethel-Somme_Nlocalisesurmais.pdf
Télécharger
Influence du travail du sol sur la qualité de l'eau d'infiltration sous les racines (Obernai - Bas Rhin)
Nom de la structure
EPLEFPA d'Obernai
Téléphone
03.88.49.99.49
Contact (courriel)
Guillaume.BAPST@educagri.fr
Contact2 (courriel)
Freddy.MERKLING@educagri.fr
Site Web
http://www.epl67.fr
Code postal
67212
Ville
Obernai
Département
Bas-Rhin
Type d'initiative
- qualité de l'eau
Contexte
Sous la plaine du Rhin s'étend une des plus grandes réserves d'eau potable d'Europe (nappe phréatique du Rhin). La qualité de l'eau de cette nappe se dégrade. L'agriculture, de par ses pratiques (travail du sol, fertilisation), est directement concernée dans l'effort à fournir pour éviter que cette qualité ne se dégrade encore davantage.
Objectif
Voir si le travail du sol a une influence sur la qualité de l'eau qui s'infiltre.
Description de l'action
Un essai mené conjointement par la Chambre d'Agriculture du Bas-Rhin, l'Association pour la Relance Agronomique en Alsace et l'EPL d'Obernai a pour objectif de voir si le travail du sol peut avoir un influence sur la qualité de l'eau (nitrates) qui s'infiltre sous les racines des cultures. Cet essai porte sur 3 modalités : labour, techniques simplifiées et semis direct. La rotation pratiquée est blé-betteraves-mais. Le suivi de la qualité de l'eau est assuré par un dispositif de bougies poreuses dans chacune des modalités...
Utilisation pédagogique
Suivi de l'essai par différentes classes du Lycée Agricole (BAC PRO-BTSA ACSE, GEMEAU)
Autre valorisation
Une communication en direction des exploitants est prévue.
Calendrier
Essai pluriannuel 2004 - 2013
Partenariats techniques/financiers
- Chambre d'Agriculture du Bas-Rhin
- Association pour la Relance Agronomique en Alsace
Jardibio, sensibilisation de jardiniers amateurs à la protection de la ressource en eau (Carcassonne-Aude)
Nom de la structure
CFPPA de l'Aude
Téléphone
04 68 11 91 26
Contact (courriel)
monique.royer@educagri.fr
Contact2 (courriel)
walid.choucair@educagri.fr
Code postal
11000
Ville
Carcassonne
Département
Aude
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- économie d'eau
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
Retenus suite à l'appel à projet 2009 de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse pour développer l'agriculture biologique et réduire la pollution des eaux par les pesticides, le réseau des CFPPA de l'Aude et de l'Hérault se sont engagés en proposant l'action de sensibilisation-formation «JARDIBIO». Dans l'Aude, Deux territoires particulièrement concernés par les enjeux de l'eau ont été choisis pour mener l'expérimentation : le bassin versant du Fresquel (Carcassonne et Pennautier) et Narbonne.
Retenus suite à l'appel à projet 2009 de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse pour développer l'agriculture biologique et réduire la pollution des eaux par les pesticides, le réseau des CFPPA de l'Aude et de l'Hérault se sont engagés en proposant l'action de sensibilisation-formation «JARDIBIO». Dans l'Aude, Deux territoires particulièrement concernés par les enjeux de l'eau ont été choisis pour mener l'expérimentation : le bassin versant du Fresquel (Carcassonne et Pennautier) et Narbonne.
Objectif
Promouvoir les principes de l'agriculture biologique auprès des jardiniers amateurs, par la mise en place de formations techniques sur les pratiques alternatives de gestion des herbes indésirables et des ravageurs ainsi que sur la fertilisation et l'irrigation.
Promouvoir les principes de l'agriculture biologique auprès des jardiniers amateurs, par la mise en place de formations techniques sur les pratiques alternatives de gestion des herbes indésirables et des ravageurs ainsi que sur la fertilisation et l'irrigation.
Description de l'action
Aude :
Aude :
- Un inventaire des jardins et des pratiques sur les deux territoires réalisés par des étudiants de Supagro en 2010. Le résultat a été présenté en réunion publique favorisant ainsi le débat autour de la question de l'utilisation des pesticides et des incidences sur l'eau
- Formation d'une centaine de jardiniers amateurs volontaires en 2011 et en 2012 : les formations étaient gratuites et se déroulaient dans les jardins. Les thèmes étaient définis par un comité de pilotage composé de représentants des jardiniers, des partenaires du projet et des acteurs locaux impliqués dans la gestion de la qualité et de la quantité d'eau.
- Elaboration d'une mallette pédagogique : des livrets de formation ont été remis aux jardiniers sur chaque thème traité en formation. Ces livrets sont rassemblés sur un CD ROM et sont mis en ligne pour un accès libre et gratuit (cf. lien vers site ci-dessus)
- Evaluation du projet par des étudiants de Supagro et pistes pour étendre l'expérience à de nouveaux publics et de nouveaux territoires.
Résultats
cf. fichiers joints
cf. fichiers joints
Utilisation pédagogique
Les supports réalisés sont diffusés et mis en ligne pour une utilisation dans des formations ou libres. Les jardins collectifs impliqués dans l'action constituent progressivement une bibliothèque à destination de leurs jardiniers.
Les supports réalisés sont diffusés et mis en ligne pour une utilisation dans des formations ou libres. Les jardins collectifs impliqués dans l'action constituent progressivement une bibliothèque à destination de leurs jardiniers.
Autre valorisation
L'action permet aux CFPPA de tisser des liens avec des acteurs locaux nouveaux et de s'impliquer dans l'axe développement local / politique de l'eau et de protection de l'environnement
L'action permet aux CFPPA de tisser des liens avec des acteurs locaux nouveaux et de s'impliquer dans l'axe développement local / politique de l'eau et de protection de l'environnement
Calendrier
2010-2012
2010-2012
Perspective
- développement de formations dans l'Aude pour les jardiniers amateurs en appui des politiques locales de création de nouveaux jardins collectifs et de sensibilisation à la préservation de la ressource en eau
- évaluation-bilan début 2013 avec l'Agence de l'eau
Partenariats techniques/financiers
Aude :
Comité de pilotage :
. Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse
. SMMAR (syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières)
. communauté d'Agglomération du Grand Narbonne.
Partenaires :
. BIOCIVAM
. PNR de la Narbonnaise
. CAUE
. SRAL
. Mairie de Carcassonne
. Mairie de Pennautier
. Association Jardinot
. Association des Jardins de la Reille
. jardiniers du Fresquel
Aude :
Comité de pilotage :
. Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse
. SMMAR (syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières)
. communauté d'Agglomération du Grand Narbonne.
Partenaires :
. BIOCIVAM
. PNR de la Narbonnaise
. CAUE
. SRAL
. Mairie de Carcassonne
. Mairie de Pennautier
. Association Jardinot
. Association des Jardins de la Reille
. jardiniers du Fresquel
Fichier : fichierinitiative1_presentationjardinerbio.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative2_diapobilan2013.pdf
Télécharger
Jardibio, sensibilisation de jardiniers amateurs à la protection de la ressource en eau (Montpellier-Hérault)
Nom de la structure
CFPPA de l'Hérault
Téléphone
04 99 23 25 50
Contact (courriel)
veronique.arnaud@educagri.fr
Site Web
http://www.epl.agropolis.fr/jardibio
Code postal
34000
Ville
Montpellier
Département
Hérault
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- économie d'eau
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
Retenus suite à l'appel à projet 2009 de l'Agence de l'Eau Rhône - Méditerranée et Corse pour développer l'agriculture biologique et réduire la pollution des eaux par les pesticides, le réseau des CFPPA de l'Aude et de l'Hérault se sont engagés en proposant l'action de sensibilisation-formation «JARDIBIO»
Retenus suite à l'appel à projet 2009 de l'Agence de l'Eau Rhône - Méditerranée et Corse pour développer l'agriculture biologique et réduire la pollution des eaux par les pesticides, le réseau des CFPPA de l'Aude et de l'Hérault se sont engagés en proposant l'action de sensibilisation-formation «JARDIBIO»
Objectif
promouvoir les principes de l'agriculture biologique auprès des jardiniers amateurs, par la mise en place de formations techniques sur les pratiques alternatives de gestion des herbes indésirables et des ravageurs ainsi que sur la fertilisation et l'irrigation.
promouvoir les principes de l'agriculture biologique auprès des jardiniers amateurs, par la mise en place de formations techniques sur les pratiques alternatives de gestion des herbes indésirables et des ravageurs ainsi que sur la fertilisation et l'irrigation.
Description de l'action
. Sol et outils
. Organisation du jardin
. Protection des plantes
. Eau et irrigation
. Biodiversité
. Fertilisation
. Bouturage et repiquage
. Principes de taille des fruitiers
. Entretien du jardin et hivernage
- réalisation d'une mallette pédagogique
- programme de 10 séances de 3 h chacune, sur l'année, sur les thèmes suivants :
. Sol et outils
. Organisation du jardin
. Protection des plantes
. Eau et irrigation
. Biodiversité
. Fertilisation
. Bouturage et repiquage
. Principes de taille des fruitiers
. Entretien du jardin et hivernage
Résultats
- réalisation et édition de la mallette pédagogique, utilisée notamment pendant les séances de formation
- 2 groupes d'une douzaine de jardiniers (individuels) formés sur le territoire montpelliérain en 2011
- 5 groupes constitués pour 2012 dans l'Hérault (territoires de Montpellier, du littoral et de Clermont-l'Hérault)
Autre valorisation
- tenue de stands sur des évènementiels locaux (fête de la tomate,...)
- action de formation pour personnels du ministère de l'agriculture en 2011 (sur 2 jours)
Calendrier
Perspective
évaluation-bilan début 2013 avec l'Agence de l'eau
évaluation-bilan début 2013 avec l'Agence de l'eau
Partenariats techniques/financiers
Hérault :
Comité de pilotage :
· Agence de l'eau Rhône méditerranée et Corse
· CFPPA de l'Hérault site de Montpellier - Agropolis
· Syndicat mixte des Etangs Littoraux, porteur du programme « Vert Demain »
· Syndicat mixte du bassin du Lez Mosson Etangs Palavasiens
Partenaires :
. DREAL
. Maison départementale de l'environnement et CG34
. Communauté de communes du Grand Pic St Loup
. Mairie de Clapiers, Association LEZ Vivant et collectif du LEZ
. CIVAM Bio 34
. Magasin BOTANIC
. Jardiniers de France
. Association « Etat des lieux »
. Association « Layanan »
Comité de pilotage :
· Agence de l'eau Rhône méditerranée et Corse
· CFPPA de l'Hérault site de Montpellier - Agropolis
· Syndicat mixte des Etangs Littoraux, porteur du programme « Vert Demain »
· Syndicat mixte du bassin du Lez Mosson Etangs Palavasiens
Partenaires :
. DREAL
. Maison départementale de l'environnement et CG34
. Communauté de communes du Grand Pic St Loup
. Mairie de Clapiers, Association LEZ Vivant et collectif du LEZ
. CIVAM Bio 34
. Magasin BOTANIC
. Jardiniers de France
. Association « Etat des lieux »
. Association « Layanan »
Jeu pédagogique pour aborder la gestion concertée de l'eau en milieu méditerranéen (Perpignan - Pyrénées Orientales)
Nom de la structure
EPLLEFPA de Perpignan-Roussillon
Téléphone
04 68 37 99 37
Contact (courriel)
patrice.robin@educagri.fr
Code postal
66200
Ville
Théza
Département
Pyrénées-Orientales
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
Contexte
Le projet associe une démarche pédagogique concernant des étudiants en BTSA productions horticoles, dans le cadre d'un module consacré à la gestion durable de l'eau dans le pourtour méditerranéen, et une démarche d'ouverture vers les acteurs de la gestion de l'eau dans la vallée de la Têt (Pyrénées Orientales), qui se caractérise par la forte présence de l'arboriculture fruitière irriguée. Le support de ce projet est un kit de conception de jeux pour la concertation et la gestion de l'eau dans les bassins-versants développé par l'INRAE et le CIRAD de Montpellier, intitulé WAT-A-GAME (voir présentation dans la partie "Ressources" de ce site : http://www.reseau-eau.educagri.fr/wakka.php?wiki=KitPourJeuDeRoleQwatAGameq )
Objectif
- améliorer, grâce à la formation, la prise en compte du développement durable chez les acteurs impliqués dans la gestion locale de l'eau dans un contexte d'agriculture irriguée
- démultiplier l'expérience pédagogique avec des établissements en France dans des pays concernés par cette problématique (Espagne, Italie, Maroc,...)
- renforcer localement les partenariats avec les acteurs gestionnaires et les organismes de recherche dans le domaine de la gestion durable de l'eau
Description de l'action
Mobilisation de Wat-a-Game adapté au contexte du bassin versant de la Têt, dans le cadre du Module d'Initiative Locale des BTS "productions horticoles"
- de septembre à novembre : sur la base de collecte d'informations, de visites et de rencontres avec les acteurs impliqués dans la gestion de l'eau dans la vallée de la Têt, modélisation grâce au kit Wat-a-game de la gestion de l'eau dans la vallée de la Têt (identification des usages, des acteurs et de leurs stratégies, des règles de gestion et des risques auquel le bassin versant est confronté)
- décembre : simulation de la gestion multi-acteurs dans le territoire retenu dans le cadre de la semaine consacrée au MIL (1 jour de jeu avec bilan, 1 journée de visites pour rencontrer des acteurs de terrain)
Utilisation pédagogique
Les étudiants sont pleinement impliqués et acteurs dans le projet (cf. ci dessus)
Autre valorisation
- conception et édition d'un kit de jeu dédié à l'éducation et à la sensibilisation à la gestion durable de l'eau à partir de la situation du bassin versant de la Têt en lien avec la construction du projet d’exploitation de l’EPLEFPA Perpignan-Roussillon à but opérationnel et démonstratif sur l’amélioration de la gestion quantitative et qualitative de l’eau (action débutée en 2014, édition et diffusion en 2016 - financement AERMC) : L'eau en Têt (cf. fiche ressource)
- article de valorisation "café pédagogique" (2020)
- de valorisation de la revue SET (2021)
- chaîne youtube capitalisant les tutoriels vidéos
- article de valorisation "café pédagogique" (2020)
- de valorisation de la revue SET (2021)
- chaîne youtube capitalisant les tutoriels vidéos
Calendrier
Réalisé chaque année depuis 2011.
Perspective
- Développement des partenariats locaux avec d'autres acteurs sur les autres vallées des Pyrénées-Orientales.
- Extension de la démarche aux problématiques d'inondation (concerne les classes de seconde, de première et de terminale)
- Diffusion de l'outil et formation d'enseignants sur l'ensemble du territoire national
Partenariats techniques/financiers
- INRAE et CIRAD Montpellier
- acteurs locaux de la gestion de l'eau notamment le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Têt
- Agence de l'eau RMC, Conseil régional Occitanie
Fichier : GestionConcerteeDeLeauEnMilieuMediterran_fichierinitiative1_presentation_eau_en_tet.pdf
Télécharger
Fichier : GestionConcerteeDeLeauEnMilieuMediterran_fichierinitiative2_eau_en_tet_depliant.pdf
Télécharger
Lien vers vidéo de présentation (1)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuMN3rBiO6Ia_Lvf5xxoyXBjVKxtMvsVx
Lien vers vidéo de présentation(2)
https://sites.google.com/site/waghistory/to-dos/application-pedagogique-de-wag-a-la-vallee-de-la-tet-patrice-robin-lgta-theza-2011-12
Vidéo de présentation (1)
Tutoriels généraux L'Eau en Têt
Vidéo de présentation (2)
Page du site dédié à Wat-A-Game consacrée à l'utilisation de Wat-A-Game avec les BTS Productions horticoles, avec des documents à télécharger.
Journées techniques Eau - ENIL Mamirolle (Mamirolle-Doubs)
Nom de la structure
ENIL de Mamirolle
Téléphone
03 81 55 92 00
Contact (courriel)
jean-louis.berner@educadgri.fr
Contact2 (courriel)
stephan.riot@educagri.fr
Contact3 (courriel)
laurent.chevalier@educagri.fr
Code postal
25620
Ville
MAMIROLLE
Département
Doubs
Type d'initiative
- traitement des effluents
- qualité de l'eau
Contexte
L'ENIL de Besançon-Mamirolle dispense depuis 1999 des formations de niveau bac+2 dans le domaine de la gestion de l'eau et des effluents.
Depuis 2005, un pôle « Gestion de l'Eau et de l'Environnement » a été constitué à l'ENIL.
Ce Pôle organise chaque année avec les apprenants de BTS GEMEAU une journée technique à destination des professionnels du domaine de la gestion de l'eau.
L'ENIL de Besançon-Mamirolle dispense depuis 1999 des formations de niveau bac+2 dans le domaine de la gestion de l'eau et des effluents.
Depuis 2005, un pôle « Gestion de l'Eau et de l'Environnement » a été constitué à l'ENIL.
Ce Pôle organise chaque année avec les apprenants de BTS GEMEAU une journée technique à destination des professionnels du domaine de la gestion de l'eau.
Objectif
Cette journée, traditionnellement axée sur une problématique technique, le plus souvent liée à une évolution réglementaire, vise à rassembler des professionnels du domaine et à favoriser les échanges avec les futurs diplômés BTS de l'Ecole.
Cette journée, traditionnellement axée sur une problématique technique, le plus souvent liée à une évolution réglementaire, vise à rassembler des professionnels du domaine et à favoriser les échanges avec les futurs diplômés BTS de l'Ecole.
Description de l'action
Au cours de la journée, différents aspects sont abordés par des intervenants professionnels du secteur, qui permettent aux participants de faire le point sur l'évolution des réglementations et des techniques.
Cette journée est proposée à tous les professionnels concernés par la gestion de l'eau et l'assainissement. La diffusion de la manifestation est faite sur toute la région Grand-Est (Franche-comté, Alsace, Lorraine).
Au cours de la journée, différents aspects sont abordés par des intervenants professionnels du secteur, qui permettent aux participants de faire le point sur l'évolution des réglementations et des techniques.
Cette journée est proposée à tous les professionnels concernés par la gestion de l'eau et l'assainissement. La diffusion de la manifestation est faite sur toute la région Grand-Est (Franche-comté, Alsace, Lorraine).
Résultats
9ème édition en 2013 (depuis 2005)
Plus de 200 professionnels représentant environ 140 entreprises ou collectivités ont participé à l'une des 8 premières éditions.
9ème édition en 2013 (depuis 2005)
Plus de 200 professionnels représentant environ 140 entreprises ou collectivités ont participé à l'une des 8 premières éditions.
Utilisation pédagogique
Participation des apprenants de BTS Gemeau aux conférences
Participation des apprenants de BTS Gemeau aux conférences
Calendrier
Une journée par an au printemps (mars, avril ou mai selon disponibilité des intervenants)
Une journée par an au printemps (mars, avril ou mai selon disponibilité des intervenants)
Perspective
Réaliser 2 ou 3 journées par an en partenariat avec le CNFPT de Franche-Comté
Réaliser 2 ou 3 journées par an en partenariat avec le CNFPT de Franche-Comté
Partenariats techniques/financiers
- Centre National de la Fonction Publique Territoriale de Franche-Comté,
- Conseil Régional de Franche-Comté,
- Commune de Mamirolle
L'eau dans l'Agenda 21 de l'établissement (Antibes - Alpes Maritimes)
Nom de la structure
EPL d'Antibes (CFA/CFPPA Horticole)
Téléphone
04 92 91 30 00
Contact (courriel)
sylvie.soave@educagri.fr
Code postal
06600
Ville
Antibes
Département
Alpes-Maritimes
Type d'initiative
- économie d'eau
- milieu naturel
- qualité de l'eau
Contexte
Après avoir entrepris l'expérimentation depuis 2007 d'agendas 21 scolaires dans 19 lycées et 1 CFA pilotes, la région PACA a lancé un appel à projet en juin 2009 pour reconduire l'opération avec une dizaine de CFA pour la rentrée scolaire 2009-2010. Le CFA Agricole d'Antibes fait partie des structures retenues.
Après avoir entrepris l'expérimentation depuis 2007 d'agendas 21 scolaires dans 19 lycées et 1 CFA pilotes, la région PACA a lancé un appel à projet en juin 2009 pour reconduire l'opération avec une dizaine de CFA pour la rentrée scolaire 2009-2010. Le CFA Agricole d'Antibes fait partie des structures retenues.
Objectif
- Améliorer la gestion du site (bâti)
- Sensibiliser et mobiliser des parties prenantes
- Accompagner l'évolution des pratiques professionnelles par la pédagogie
Description de l'action
- Action "Si l'eau m'était comptée" : mise en place de compteurs volumétriques, évaluation et suivi des consommations d'eau par secteurs, détection des fuites et définir les stratégies d'amélioration (sept2010 - juin 2012)
- Action "Quand les pilotes agissent ensemble" : nettoyage du Cap d'Antibes (Zone à haute valeur environnementale) en canoë kayak, sensibilisation sur les macro-déchets et la qualité de l'eau, dans le cadre de la Journée citoyenne de la Ville d'Antibes (juin 2011)
- Action "Conférences et expositions sur le thème de l'eau et du paysage" : programmation d'une Journée thématique sur l'établissement (mars 2011)
Utilisation pédagogique
L'ensemble des actions menées implique les apprenants du CFA et du CFPPA, en fonction des référentiels formation et référentiels métiers (Travaux paysagers, Jardins espaces verts, GEMEAU) et s'inscrivant dans une pédagogie de projet
L'ensemble des actions menées implique les apprenants du CFA et du CFPPA, en fonction des référentiels formation et référentiels métiers (Travaux paysagers, Jardins espaces verts, GEMEAU) et s'inscrivant dans une pédagogie de projet
Autre valorisation
- mobilisation et implication de l'équipe de formateurs
- sensibilisation du grand public par les opérations de communication (voir http://www.vertdazur.educagri.fr/revue-de-presse/protection-de-lenvironnement.html)
Calendrier
2011-2012
2011-2012
Perspective
Réalisation d'une vidéo sur les actions menées par le CFA dans le cadre de l'agenda 21 (mise en place agenda 21, changements de pratiques)
Réalisation d'une vidéo sur les actions menées par le CFA dans le cadre de l'agenda 21 (mise en place agenda 21, changements de pratiques)
Partenariats techniques/financiers
- Conseil régional PACA
- Plein sud TV
- COV
- CDMM
- mairie d'Antibes
Fichier : fichierinitiative1_Agenda21_CFAAgricole_fiches_actions.pdf
Télécharger
L'eau pour un développement durable au Sénégal (Abbeville - Somme)
Nom de la structure
Lycée professionnel agricole de la Baie de Somme
Téléphone
03.22.20.77.66
Contact (courriel)
evelyne.plee@educagri.fr
Site Web
http://www.lycee-baie-de-somme.fr
Adresse postale
21 rue du Lieutenant Caron
Code postal
80100
Ville
ABBEVILLE
Département
Somme
Type d'initiative
- international
- milieu naturel
- qualité de l'eau
Contexte
Après dix ans d'échanges culturels, le lycée agricole de la Baie de Somme a souhaité participer à un projet d'adduction d'eau pour son partenaire sénégalais.
Après dix ans d'échanges culturels, le lycée agricole de la Baie de Somme a souhaité participer à un projet d'adduction d'eau pour son partenaire sénégalais.
Objectif
- Améliorer les conditions de vie des populations de 3 villages : Sorokhassap, Thiafoura et Popenguine en favorisant leur accès à l'eau potable.
- Favoriser l'éducation au développement des élèves français et sénégalais qui participent au projet.
Description de l'action
Plusieurs actions seront menées dans le cadre de ce projet. Il s'agira d'investir
Plusieurs actions seront menées dans le cadre de ce projet. Il s'agira d'investir
- dans la construction d'infrastructures d'adduction d'eau
- dans la construction d'infrastructures d'hygiène et sanitaire
- dans l'aménagement de la réserve naturelle (entité d'une forêt classée)
- dans l'achat de matériel pour le maraîchage
- dans la formation des hommes et des femmes pour une meilleure gestion d'un patrimoine communautaire (éoliennes, blocs sanitaires)
- dans la formation des hommes et des femmes pour une maîtrise de la pratique de l'agriculture
- dans la formation de la population et des élèves pour l'éducation à l'environnement et au développement durable
Résultats
Pour le moment, un seul village a pu bénéficier des travaux grâce à la coordination technique d'une ONG (LVIA) qui se chargeait de la construction des infrastructures en impliquant la population.
Pour le moment, un seul village a pu bénéficier des travaux grâce à la coordination technique d'une ONG (LVIA) qui se chargeait de la construction des infrastructures en impliquant la population.
Utilisation pédagogique
Ce projet est le support de l'éducation au développement dispensée à nos élèves, mission de notre établissement d'enseignement. Rendre le projet de développement concret et palpable pour nos élèves est indispensable pour les aider à comprendre d'autres projets de développement local au Nord comme au Sud et à appréhender les relations Nord/Sud.
Le séjour auprès des partenaires Sénégalais doit permettre d'appréhender concrètement par des rencontres, des enquêtes, les bénéfices que la population retire du projet d'adduction. Quelle amélioration des conditions d'accès à l'eau ? Pour quels bénéfices pour la santé ? etc. Les élèves seront également amenés à décrypter l'articulation qui existe entre les différentes parties prenantes du projet (réserve de Popenguine, Copronat, ONG LVIA). Ils devront également s'interroger sur l'appropriation et l'implication des villageois (quelles organisations villageoises pour garantir l'entretien des éoliennes ? par exemple).
Ce projet est le support de l'éducation au développement dispensée à nos élèves, mission de notre établissement d'enseignement. Rendre le projet de développement concret et palpable pour nos élèves est indispensable pour les aider à comprendre d'autres projets de développement local au Nord comme au Sud et à appréhender les relations Nord/Sud.
Le séjour auprès des partenaires Sénégalais doit permettre d'appréhender concrètement par des rencontres, des enquêtes, les bénéfices que la population retire du projet d'adduction. Quelle amélioration des conditions d'accès à l'eau ? Pour quels bénéfices pour la santé ? etc. Les élèves seront également amenés à décrypter l'articulation qui existe entre les différentes parties prenantes du projet (réserve de Popenguine, Copronat, ONG LVIA). Ils devront également s'interroger sur l'appropriation et l'implication des villageois (quelles organisations villageoises pour garantir l'entretien des éoliennes ? par exemple).
Autre valorisation
Carnet de voyage réalisé par les élèves à l'issue de leur voyage d'étude.
Carnet de voyage réalisé par les élèves à l'issue de leur voyage d'étude.
Calendrier
Les travaux devaient se dérouler entre 2009 et 2012. Il sont interrompus pour le moment.
Les travaux devaient se dérouler entre 2009 et 2012. Il sont interrompus pour le moment.
Partenariats techniques/financiers
Au Sénégal :
- à Thies : l'ONG LVIA (italienne) pour tous les travaux et la formation de personnes relais-maintenance des éoliennes, des puits,
- à Popenguine : le COPRONAT (Collectif des Groupements de Femmes pour la Protection de la Nature) comme relais local auprès des populations.
En France :
- l'Union des Africains, porteur du dossier auprès des financeurs potentiels,
- le Conseil Régional de Picardie, financeur principal
- l'Agence de l'Eau Artois-Picardie, financeur.
Au Sénégal :
- à Thies : l'ONG LVIA (italienne) pour tous les travaux et la formation de personnes relais-maintenance des éoliennes, des puits,
- à Popenguine : le COPRONAT (Collectif des Groupements de Femmes pour la Protection de la Nature) comme relais local auprès des populations.
En France :
- l'Union des Africains, porteur du dossier auprès des financeurs potentiels,
- le Conseil Régional de Picardie, financeur principal
- l'Agence de l'Eau Artois-Picardie, financeur.
Fichier : fichierinitiative1_PROJET1.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative2_PROJET2.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative3_CR_mission_fev2010.pdf
Télécharger
La Semaine de l'eau (Albi/Lavaur, La Canourgue, Nîmes-Rodilhan - Tarn)
Nom de la structure
EPLEFPAs Tarn, Lozère, Nîmes-Rodilhan - PFT GH2O
Téléphone
05.63.49.43.70
Contact (courriel)
nicolas.alvarez@educagri.fr
Contact2 (courriel)
nathalie.latger@educagri.fr
Code postal
81000
Ville
Albi
Département
Tarn
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- économie d'eau
- traitement des effluents
- milieu naturel
- qualité de l'eau
Contexte
L'établissement agro-environnemental du Tarn organise, depuis 2008, sur le campus d'Albi-Fonlabour et le domaine de Lavaur-Flamarens une "Semaine de l'eau". Évènementiel pendant lequel les étudiants proposent des visites guidées, expositions, conférences, animations et spectacles. Les classes impliquées ont l'occasion d'y présenter des productions collectives, aboutissement d'un travail qui marquera pour longtemps leur conscience citoyenne. Ces actions sont destinées à différents publics : scolaires (de la maternelle au lycée), étudiants, grand public, professionnels de l'eau, enseignants et agriculteurs.
Depuis 2020, la programmation est élargie aux EPLs consituant la Plateforme technologique GH2O en Occitanie (Tarn, Lozère et Nîmes)
Depuis 2020, la programmation est élargie aux EPLs consituant la Plateforme technologique GH2O en Occitanie (Tarn, Lozère et Nîmes)
Objectif
- favoriser la sensibilisation des plus jeunes à la préservation de la ressource naturelle,
- débattre avec les acteurs de l'eau, usagers, collectivités ou professionnels sur les moyens actuels et futurs mis en oeuvre pour atteindre le bon état écologique des masses d'eau,
- partager avec les partenaires du territoire l'ambitieux projet de protection de l'eau, ce "bien commun de l'Humanité".
Description de l'action
Programmation sur la semaine, du lundi au vendredi, par journées thématiques cf. lien blog : http://semaine.eau.albi-fonlabour.overblog.com
Événement annuel programmé en alternance sur chacun des deux sites de l'EPL du Tarn (Albi et Lavaur) et depuis 2020 également sur les EPLs de la Lozère (site La Cnaourgue) et de Nîmes
Événement annuel programmé en alternance sur chacun des deux sites de l'EPL du Tarn (Albi et Lavaur) et depuis 2020 également sur les EPLs de la Lozère (site La Cnaourgue) et de Nîmes
Utilisation pédagogique
Les apprenants sont impliqués dans l'organisation et l'animation des journées, et participent aux différents évènements.
Autre valorisation
. Grand public, scolaires, partenaires, professionnels, retombées médias sur le territoire.
. Labellisation de la 5ème Semaine de l'Eau par le Forum Mondial de l'Eau en 2012.
. Concours de Plaidoirie "l'agriculture peut-elle limiter le réchauffement climatique" (2022) auprès des élèves de Terminale bac pro CGEA (cf. film) . article (2022)
. Labellisation de la 5ème Semaine de l'Eau par le Forum Mondial de l'Eau en 2012.
. Concours de Plaidoirie "l'agriculture peut-elle limiter le réchauffement climatique" (2022) auprès des élèves de Terminale bac pro CGEA (cf. film) . article (2022)
Partenariats techniques/financiers
Nombreux (cf. programmes)
Soutien financier de l'AEAG
Soutien financier de l'AEAG
Lien vers vidéo de présentation (1)
http://www.dailymotion.com/video/x3zk7db
Lien vers vidéo de présentation(2)
http://www.dailymotion.com/video/xpx1pm
Vidéo de présentation (1)
Vidéo de présentation (2)
Les 2 Jours de l'eau/ les Eaulympiades (Miramas - Bouches-du-Rhône)
Nom de la structure
LEAP Fontlongue - Miramas
Téléphone
04 90 58 18 46
Contact (courriel)
y.tlili@fontlongue.org
Adresse postale
Boulevard Théodore Aubanel
Code postal
13140
Ville
Miramas
Département
Bouches-du-Rhône
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- économie d'eau
- qualité de l'eau
Contexte
Les Deux Jours de l’Eau sont un évènement organisé annuellement par le Campus Fontlongue. Il propose un certain nombre de rendez-vous pour une célébration de l’eau, d’un océan à l’autre, qui se tient annuellement lors de la troisième semaine de mars. Il coïncide avec la journée mondiale de l’eau (22 mars).
Cette action offre également l’opportunité aux étudiants BTS Gestion et Maîtrise de l’eau et du CS Arrosage intégré du LEAP Fontlongue de Miramas et des autres établissements invités (EPLEFPA de Nîmes, ISVT Le Puy et lycée Latécoère d'Istres), d’être acteurs, notamment à l'occasion des Eaulympiades, temps fort de ces 2 Jours de l'eau...
Cette action offre également l’opportunité aux étudiants BTS Gestion et Maîtrise de l’eau et du CS Arrosage intégré du LEAP Fontlongue de Miramas et des autres établissements invités (EPLEFPA de Nîmes, ISVT Le Puy et lycée Latécoère d'Istres), d’être acteurs, notamment à l'occasion des Eaulympiades, temps fort de ces 2 Jours de l'eau...
Objectif
- institutionnaliser la journée mondiale de l’eau à Miramas, dans le but de créer une dynamique afin d’atteindre les objectifs du millénaire pour le développement concernant l’eau et l’environnement.
- permettre aux chercheurs, professionnels et acteurs de l’eau en France de partager des exemples de bonnes pratiques de coopération et d’expériences dans une perspective globale.
- sensibiliser le grand public du territoire à travers projections-débats, conférences, visites guidées,...
- favoriser les échanges entre les trois établissements de formation "eau" du territoire (avec l'EPLEFPA de Nîmes, l'ISVT du Puy et le lycée Latécoère d'Istres)
Description de l'action
- 2 Jours de l'eau : cf. programmes (pj), en téléchargement sur le site
- Eaulympiades : les 5 groupes d'élèves (BTSA GEMEAU de Miramas, du Puy et de Nîmes, CS Arrosage de Miramas et BTS Métiers de l'eau d'Istres) sont mixés en 3 groupes, qui vont travailler une après-midi sur un atelier participatif les plongeant dans une situation réelle de bureau d'étude ou de société, animé par un expert-animateur...
Utilisation pédagogique
cf. article (2016), vidéo 2017 et vidéo 2019
Autre valorisation
médias locaux
Perspective
- renforcement des liens entre les établissements
- renforcement des liens avec les structures partenaires au national (ENGEES, IRSTEA) et international (IAM Bari, faculté de sciences de Casablanca,...)
Partenariats techniques/financiers
Ville de Miramas, Marseille Provence métropole, Conseil régional PACA, EPLEFPA Nîmes-Rodilhan, ISVT du Puy, Lycée Latécoère d'Istres, partenaires locaux de l'établissement...
Fichier : fichierinitiative1_3_Jours_de_l_eau_2017.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative2_les-3-jours-de-l-eau-2106.pdf
Télécharger
Fichier : Les3JoursDeLEauLesEaulympiadesMiramas_fichierinitiative3_2_jours_de_l_eau_2018.pdf
Télécharger
Fichier : Les3JoursDeLEauLesEaulympiadesMiramas_fichierinitiative4_2jeau_programme-2019.pdf
Télécharger
Lien vers vidéo de présentation (1)
http://www.dailymotion.com/video/x5g1e0k_miramas2017-eaulympiades_school
Lien vers vidéo de présentation(2)
https://www.youtube.com/watch?v=rdMo37jkzjU
Vidéo de présentation (1)
Miramas2017_Eaulympiades par eau-ea
Miramas2017_Eaulympiades par eau-ea
Vidéo de présentation (2)
Les étangs du lycée à la rescousse de la biodiversité (Vic-en-Bigorre - Hautes Pyrénées)
Nom de la structure
EPL de Vic-en-Bigorre
Téléphone
05 62 31 80 00
Contact (courriel)
philippe.bricault@educagri.fr
Site Web
http://www.eplefpa65.educagri.fr
Code postal
65500
Ville
Vic-en-Bigorre
Département
Hautes-Pyrénées
Type d'initiative
- milieu naturel
Contexte
Un enseignant du lycée a eu l'idée de créer des étangs de pêche dans une zone de prairies du lycée où la productivité agricole était très faible à cause de l'excès d'eau. Ainsi, en 1985, six étangs ont été réalisés. Pour réaliser les berges, de la terre a été prélevée au sud de l'unité piscicole, créant ainsi une dépression qui, au fur et à mesure du temps, se remplit d'eau de pluie pour former l'étang dit "naturel" actuel, d'une surface de 2 000 à 4 000 mètres carrés, selon le remplissage. C'est en 2007 que le très grand intérêt écologique de l'étang naturel a été découvert, avec l'arrivée d'un nouvel enseignant forestier, naturaliste passionné et responsable du club nature du lycée...
Un enseignant du lycée a eu l'idée de créer des étangs de pêche dans une zone de prairies du lycée où la productivité agricole était très faible à cause de l'excès d'eau. Ainsi, en 1985, six étangs ont été réalisés. Pour réaliser les berges, de la terre a été prélevée au sud de l'unité piscicole, créant ainsi une dépression qui, au fur et à mesure du temps, se remplit d'eau de pluie pour former l'étang dit "naturel" actuel, d'une surface de 2 000 à 4 000 mètres carrés, selon le remplissage. C'est en 2007 que le très grand intérêt écologique de l'étang naturel a été découvert, avec l'arrivée d'un nouvel enseignant forestier, naturaliste passionné et responsable du club nature du lycée...
Description de l'action
- 2007 : inventaires d'amphibiens (sept espèces reproductrices ont été identifiées sur l'étang naturel et trois sur les étangs piscicoles)
- 2008 : un des petits étangs de pêche a été vidé de tout poisson et dévolu à la biodiversité. De plus, une des berges verticales a été talutée en pente douce pour faciliter l'observation et un îlot a été créé
- de nombreux petits aménagements, pour favoriser l'accueil de la faune, ont été mis en place sur le site : bâches ou planches pour abriter les couleuvres, tas de bois, tuiles, tas de cailloux pour offrir des abris, création d'un observatoire à oiseaux
- construction d'un ponton d'observation permettant de surplomber l'étang naturel, idéal pour les visites avec les élèves ou le grand public.
Résultats
En 2010, 900 pontes de grenouilles agiles dénombrées et un inventaire de nuit a recensé en 2011 1000 crapauds communs sur l'ensemble du site.
En 2010, 900 pontes de grenouilles agiles dénombrées et un inventaire de nuit a recensé en 2011 1000 crapauds communs sur l'ensemble du site.
Utilisation pédagogique
- élèves de seconde générale qui ont l'occasion de fréquenter le site, dans le cadre de leur option EATDD. Réalisation d'un film
- support pédagogique pour les élèves du baccalauréat STAV et pour ceux des filières agricoles pour les sensibiliser à la protection des zones humides
- les élèves membres du club nature "le crapaud accoucheur" du lycée (club adhérent au réseau des clubs CPN « Connaître et protéger la nature ») participent aux inventaires et petits aménagements
Autre valorisation
- à l'occasion des Journées nature, organisées par le conseil régional Midi-Pyrénées, une sortie annuelle a lieu sur le site. Ponctuellement des sorties pour scolaires peuvent être mises en place
- une sortie d'observation de la faune et la flore du site est inscrite au programme du catalogue régional des sorties de l'association Nature Midi-Pyrénées.
- signalisation du site (panneaux « site naturel protégé des étangs du lycée agricole et forestier de Vic-en-Bigorre »)
- réalisation d'une plaquette sur la biodiversité du site
- mise en place d'un panneau d'information (1,2 x 0,8 mètre) à l'entrée du site
- conception d'un parcours didactique autour de l'étang naturel avec une dizaine de petits panneaux d'information sur les serpents, les amphibiens, la flore, le cycle de l'eau, les odonates, les aménagements en faveur de la faune, les oiseaux nicheurs, la Cistude d'Europe.
Partenariats techniques/financiers
- Conseil régional Midi Pyrénées
- Ministère de l'écologie
- Europe (financement)
- association Nature Midi-Pyrénées
- ONF (ponton)


Vidéo de présentation (1)
vic_etang_grenouilles_2015 par eau-ea
vic_etang_grenouilles_2015 par eau-ea
Les Journées de L'ANC (La Canourgue - Lozère)
Nom de la structure
LEGTPA Louis Pasteur
Téléphone
04 66 32 83 54
Contact (courriel)
marine.desaphy@educagri.fr
Adresse postale
chemin de Fraissinet
Code postal
48500
Ville
La Canourgue
Département
Lozère
Type d'initiative
- traitement des effluents
Contexte
La Lozère étant un département rural, un grand nombre d'habitations sont en assainissement non collectif.
De nombreux SPANC n'ont pas été mis en place ou sont en cours de mise en place.
La Lozère étant un département rural, un grand nombre d'habitations sont en assainissement non collectif.
De nombreux SPANC n'ont pas été mis en place ou sont en cours de mise en place.
Objectif
Permettre aux acteurs de l'assainissement non collectif de se rencontrer et d'échanger sur leurs pratiques, la réglementation, l'évolution des techniques en matière d'ANC.
Informer les particuliers sur leurs droits et les différents systèmes qui s'offrent à eux dans le choix d'un ANC.
Permettre aux étudiants de la filière GEMEAU de rencontrer différents acteurs de la gestion de l'eau et en particulier des effluents.
Permettre aux acteurs de l'assainissement non collectif de se rencontrer et d'échanger sur leurs pratiques, la réglementation, l'évolution des techniques en matière d'ANC.
Informer les particuliers sur leurs droits et les différents systèmes qui s'offrent à eux dans le choix d'un ANC.
Permettre aux étudiants de la filière GEMEAU de rencontrer différents acteurs de la gestion de l'eau et en particulier des effluents.
Description de l'action
Les journées de L'ANC se sont déroulées sur 2 jours en 2014 (vendredi 11 et samedi 12 avril).
Nous avons organisé :
- 5 tables rondes thématiques animés par des professionnels du secteur.
- 2 conférences.
- 1 salon professionnel comprenant une dizaine d'exposants.
- 7 ateliers d'étudiants exposants les bases permettant de comprendre ce qu'est l'ANC qui en sont les acteurs et quelles sont les systèmes de traitements possibles.
- 1 point info pour les questions diverses.
Les journées de L'ANC se sont déroulées sur 2 jours en 2014 (vendredi 11 et samedi 12 avril).
Nous avons organisé :
- 5 tables rondes thématiques animés par des professionnels du secteur.
- 2 conférences.
- 1 salon professionnel comprenant une dizaine d'exposants.
- 7 ateliers d'étudiants exposants les bases permettant de comprendre ce qu'est l'ANC qui en sont les acteurs et quelles sont les systèmes de traitements possibles.
- 1 point info pour les questions diverses.
Résultats
Lors de la journée du samedi, la plupart des tables rondes ont fait salle comble. De nombreux professionnels étaient présents (techniciens SPANC, bureaux d'études, professionnels du BTP, DDT Lozère, Conseil Général Lozère et Cantal, Président de la chambre des notaires de Lozère, agence ADIL Lozère, Parc régional des Grands Causses, grossistes en matériaux et système de traitement d'ANC), quelques élus et quelques particuliers.
Le vendredi, journée davantage axée grand public, très peu de particuliers et d'élus se sont déplacés et seuls quelques professionnels étaient présents.
Lors de la journée du samedi, la plupart des tables rondes ont fait salle comble. De nombreux professionnels étaient présents (techniciens SPANC, bureaux d'études, professionnels du BTP, DDT Lozère, Conseil Général Lozère et Cantal, Président de la chambre des notaires de Lozère, agence ADIL Lozère, Parc régional des Grands Causses, grossistes en matériaux et système de traitement d'ANC), quelques élus et quelques particuliers.
Le vendredi, journée davantage axée grand public, très peu de particuliers et d'élus se sont déplacés et seuls quelques professionnels étaient présents.
Utilisation pédagogique
L'organisation des journées de l'ANC a fait l'objet du PIC des BTSA GEMEAU2.
La construction et l'animation des ateliers sur les bases de l'ANC ont été réalisées par les BTSA GEMEAU 1 dans le cadre de la pluri technique (travail sur des thématiques par groupes de 4 de septembre à mars clôturée par l'animation des ateliers).
Lors de ce travail les GEMEAU1 ont été initiés au suivi de projet, de la préparation à la conception en passant par tous les aspects organisationnels. Ils ont également beaucoup appris sur l'ANC ainsi que les aspects réglementaires et administratifs de la gestion de l'eau. (préparation du module M54 : projet technique et du PIC de 2ème année).
Le listing de contact réalisé sera réutilisé par l'équipe enseignante pour l'organisation de visites techniques, d'intervention, ou comme structures support de projets M54, de futures pluri techniques, de stages individuels pour les étudiants.
L'organisation des journées de l'ANC a fait l'objet du PIC des BTSA GEMEAU2.
La construction et l'animation des ateliers sur les bases de l'ANC ont été réalisées par les BTSA GEMEAU 1 dans le cadre de la pluri technique (travail sur des thématiques par groupes de 4 de septembre à mars clôturée par l'animation des ateliers).
Lors de ce travail les GEMEAU1 ont été initiés au suivi de projet, de la préparation à la conception en passant par tous les aspects organisationnels. Ils ont également beaucoup appris sur l'ANC ainsi que les aspects réglementaires et administratifs de la gestion de l'eau. (préparation du module M54 : projet technique et du PIC de 2ème année).
Le listing de contact réalisé sera réutilisé par l'équipe enseignante pour l'organisation de visites techniques, d'intervention, ou comme structures support de projets M54, de futures pluri techniques, de stages individuels pour les étudiants.
Autre valorisation
Support de communication sur l'établissement dans le cadre des journées portes ouvertes ou autres actions de recrutement.
Meilleure visibilité de l'établissement et de la formation GEMEAU vis à vis des structures locales de gestion de l'eau et des élus.
Ancrage de l'établissement en tant qu'acteur dans les problématiques locales de gestion de l'eau.
Support de communication sur l'établissement dans le cadre des journées portes ouvertes ou autres actions de recrutement.
Meilleure visibilité de l'établissement et de la formation GEMEAU vis à vis des structures locales de gestion de l'eau et des élus.
Ancrage de l'établissement en tant qu'acteur dans les problématiques locales de gestion de l'eau.
Perspective
Une journée sur l'ANC est prévu en 2015 (mars-avril). L'objectif est de toucher davantage les particuliers et artisans du BTP.
Une journée sur l'ANC est prévu en 2015 (mars-avril). L'objectif est de toucher davantage les particuliers et artisans du BTP.
Partenariats techniques/financiers
Partenariats financiers : Conseil régional Languedoc Roussillon et Agence de l'eau Adour-Garonne.
Partenariats financiers : Conseil régional Languedoc Roussillon et Agence de l'eau Adour-Garonne.
Fichier : fichierinitiative1_CR-Table_ronde_nd1_-MD.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative2_CR-Table_ronde_nd2-PH.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative3_journees_ANC_recto.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative4_journees_ANC_verso.pdf
Télécharger
Lien vers vidéo de présentation (1)
http://www.dailymotion.com/video/x1yq5ap
Vidéo de présentation (1)
LaCanourgue2014_ANC par eau-ea
LaCanourgue2014_ANC par eau-ea
Les nouveaux Systèmes Aquacoles : la Gestion Econome des Ressources eau et énergie (Fouesnant - Finistère)
Nom de la structure
EPLEFPA de Quimper Bréhoulou
Téléphone
02 98 56 00 04
Contact (courriel)
florence.eugene@educagri.fr
Contact2 (courriel)
hugo.leroux@educagri.fr
Site Web
http://www.brehoulou.fr/
Code postal
29170
Ville
Fouesnant
Département
Finistère
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- économie d'eau
- traitement des effluents
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
L’aquaculture est au cœur des grands changements environnementaux, sociétaux et économiques nécessitant la mise en place de nouveaux systèmes d’élevage qui répondent au mieux à ces enjeux. L’eau est aujourd'hui une ressource rare et protégée qui est à la base même des élevages aquacoles. Elle est nécessaire en quantité importante et en très bonne qualité. Cependant, en Bretagne, les pisciculteurs remarquent depuis quelques années une diminution importante de la quantité disponible pour les élevages et un renforcement des réglementations sur la qualité de l’eau utilisée. Ces changements les ont conduit à se tourner vers de nouvelles technologies recirculant l’eau, qui permettent d’économiser jusqu’à 90% de sa consommation, mais qui impliquent des connaissances biologiques spécifiques, des équipements coûteux et consommateurs d’énergie et une gestion précise de ce système complexe.
De ce constat, le lycée professionnel aquacole de Brehoulou (Fouesnant) a initié et anime une dynamique structurante au sein de l’établissement et de ses partenaires : « les nouveaux Systèmes Aquacoles vers la Gestion Économe des Ressources » (le projet SAGER).
Le lycée professionnel aquacole de Brehoulou comprend de nombreuses structures aquacoles complémentaires alimentées en eau de forage (salmoniculture en circuit ouvert, étangs en deuxième eau, circuit fermé thermo-régulé recirculé à 90%/h) ainsi qu'un parc ostréicole. La construction d'une serre Modèle Expérimental sur la Durabilité des Systèmes Aquacoles (MEDUSA), complémentaire des équipements actuels, vise à mieux appréhender la réalité des conditions d’activités des aquaculteurs bretons et atteindre plus aisément les objectifs du Projet SAGER,
De ce constat, le lycée professionnel aquacole de Brehoulou (Fouesnant) a initié et anime une dynamique structurante au sein de l’établissement et de ses partenaires : « les nouveaux Systèmes Aquacoles vers la Gestion Économe des Ressources » (le projet SAGER).
Le lycée professionnel aquacole de Brehoulou comprend de nombreuses structures aquacoles complémentaires alimentées en eau de forage (salmoniculture en circuit ouvert, étangs en deuxième eau, circuit fermé thermo-régulé recirculé à 90%/h) ainsi qu'un parc ostréicole. La construction d'une serre Modèle Expérimental sur la Durabilité des Systèmes Aquacoles (MEDUSA), complémentaire des équipements actuels, vise à mieux appréhender la réalité des conditions d’activités des aquaculteurs bretons et atteindre plus aisément les objectifs du Projet SAGER,
Objectif
Le projet SAGER propose avec les apprenants, les enseignants, les professionnels et les partenaires de :
- co-créer des livrables sur les connaissances acquises sur des systèmes économes en eau et en énergie,
- expérimenter ces systèmes à l’échelle pédagogique et professionnelle par le développement d'une plateforme expérimentale
- promouvoir toutes les actions menées dans ce cadre au sein de l'établissement et auprès des partenaires du territoire, pour une offre de formation et de partenariat orientée vers l'aqua-écologie
- co-créer des livrables sur les connaissances acquises sur des systèmes économes en eau et en énergie,
- expérimenter ces systèmes à l’échelle pédagogique et professionnelle par le développement d'une plateforme expérimentale
- promouvoir toutes les actions menées dans ce cadre au sein de l'établissement et auprès des partenaires du territoire, pour une offre de formation et de partenariat orientée vers l'aqua-écologie
Description de l'action
- rencontre avec les professionnels du territoire et les acteurs de la recherche, réalisation d'un état des lieux des systèmes d’élevages aquacoles bretons. Mise en réseau avec les associations locales sur les transitions écologiques
- développement de contacts et partenaires en Europe (programme ERASMUS +)
- mobilisation d'une équipe de chaire autour de thématiques communes : aqua-écologie, outils de diagnostic de durabilité, systèmes aquacoles recirculés et épurés low tech, aquaponie, ...
- diagnostic (consommation eau et énergie) des installations
- conception d'un serious game Game of Water pour comprendre les enjeux d’une entreprise aquacole et analyser son impact sur le milieu aquatique dont elle dépend
- co-conception et co-construction d’une serre aquacole pédagogique et expérimentale Modèle Expérimental sur la Durabilité des Systèmes Aquacoles (MEDUSA) (réalisée en 2020) : action dans le cadre complémentaire d'un projet CASDAR TAE+ 2020-2023 (avec l'EPLEFPA de Guérande et l'Institut Agro)
- développement de contacts et partenaires en Europe (programme ERASMUS +)
- mobilisation d'une équipe de chaire autour de thématiques communes : aqua-écologie, outils de diagnostic de durabilité, systèmes aquacoles recirculés et épurés low tech, aquaponie, ...
- diagnostic (consommation eau et énergie) des installations
- conception d'un serious game Game of Water pour comprendre les enjeux d’une entreprise aquacole et analyser son impact sur le milieu aquatique dont elle dépend
- co-conception et co-construction d’une serre aquacole pédagogique et expérimentale Modèle Expérimental sur la Durabilité des Systèmes Aquacoles (MEDUSA) (réalisée en 2020) : action dans le cadre complémentaire d'un projet CASDAR TAE+ 2020-2023 (avec l'EPLEFPA de Guérande et l'Institut Agro)
- avec économie d'eau (circuit recirculé, filtration adéquate - mécanique, biologique aérobique ou anaérobique, minéralisation...), d'énergie (pompe faible puissance, pompe solaire, airlift, pompe bélier, …), de matières (co-culture multitrophique, aliments à base de protéines à bilan écologique intéressant,...)
- projets proposés : aquaponie, photobioréacteurs pour production algale low tech, circuit recirculé et épuré par floculation des boues, ...
Utilisation pédagogique
Les classes et les enseignants sont mobilisés à tous les niveaux
- Avec les bacs pro aquaculture :
- Les professionnels rencontrés en Erasmus sont devenus des contacts pour les stages des apprenants en Europe.
- Les élèves ingénieurs de l'Institut Agro (Agrocampus Ouest) ont reçu également des BTS Aquaculture une "commande" d'étude sur la problématique de la valorisation des boues d’élevage, qui s’appuie sur une préoccupation concrète des pisciculteurs.
- Avec les bacs pro aquaculture :
- . EIE : en créant des modules aquaponiques et des phyto- bioréacteurs en recyclant des fûts de bière (formes low tech de production)
- . séances d’agroéquipement : en participant au chantier de construction de la serre expérimentale et pédagogique
- . MIL Expérimentation : en construisant un système aquaponie à échelle 1, en mettant en place une expérimentation en circuit fermé, en faisant le suivi des expérimentations alimentaires de la pisciculture et en rencontrant le service R&D de notre partenaire expérimental, en construisant un projet d’aquaculture multitrophique sur des huîtres et bigorneaux sur notre parc ostréicole, en appuyant la création de la mini entreprise Green fish. Présentation de leur projet lors de la journée internationale Les 48h de l’agriculture urbaine,
- . Journée technique sur les low tech en aquaculture mise en place en 2020 en lien avec nos partenaires experts et associatifs locaux,
- . Temps fort sur le bassin versant avec l’intervention de nos partenaires professionnels aquacoles et institutionnels,
- . Pluri : utilisation du jeu de plateau Game of Water pour comprendre les enjeux d’une entreprise aquacole et analyser son impact sur le milieu aquatique dont elle dépend,
- . Pluri : co-construction d’un outil d’évaluation de la durabilité d’une entreprise aquacole (IDEA4/IDEAqua)
- Les professionnels rencontrés en Erasmus sont devenus des contacts pour les stages des apprenants en Europe.
- Les élèves ingénieurs de l'Institut Agro (Agrocampus Ouest) ont reçu également des BTS Aquaculture une "commande" d'étude sur la problématique de la valorisation des boues d’élevage, qui s’appuie sur une préoccupation concrète des pisciculteurs.
Autre valorisation
. fiche pollen SAGER : lien
. fiche pollen MEDUSA : lien
. fiche pollen "Comment rendre utilisables de manière écologique et durable les boues d’élevage aquacoles ?" : lien
. poster de présentation : cf. ci-dessous
. vidéo interview d'Amélie Taggliaferro, cheffe de projet : cf. ci-dessous
. intervention en séminaire Agreenium "La transition vers des systèmes d'élevage basés sur la diversité animale" (19 janvier 2020)
. fiche pollen MEDUSA : lien
. fiche pollen "Comment rendre utilisables de manière écologique et durable les boues d’élevage aquacoles ?" : lien
. poster de présentation : cf. ci-dessous
. vidéo interview d'Amélie Taggliaferro, cheffe de projet : cf. ci-dessous
. intervention en séminaire Agreenium "La transition vers des systèmes d'élevage basés sur la diversité animale" (19 janvier 2020)
Calendrier
Projet SAGER : 2018-2021
CASDAR MEDUSA : 2020-2023
CASDAR MEDUSA : 2020-2023
Perspective
Journée de fin de projet SAGER : mars 2021
Poursuite du projet MEDUSA > 2023
Poursuite du projet MEDUSA > 2023
Partenariats techniques/financiers
Eco-conception : Explore, Konk Ar Lab, Low tech Lab, BET LA HAUT...
Expérimentation : INRAe, ITAVI, Institut Agro Rennes, partenaires des CASDAR ADAPT, BEA, MEDUSA, professionnels de la filière aquacole (STEB, CIPA, CRC, FFA) ...
Innovation : APIVA, ERASMUS...
Pédagogie : Institut agro, Bergerie nationale, EPLE Guérande, DNA Rennes, ...
Financiers : MAA/DGER (dispositif "Chef.fe de projet de partenariat" 2018-2021 et CASDAR TAE 2020-2023), Fondation crédit agricole, Région Bretagne, Agence de l'eau Loire-Bretagne
Expérimentation : INRAe, ITAVI, Institut Agro Rennes, partenaires des CASDAR ADAPT, BEA, MEDUSA, professionnels de la filière aquacole (STEB, CIPA, CRC, FFA) ...
Innovation : APIVA, ERASMUS...
Pédagogie : Institut agro, Bergerie nationale, EPLE Guérande, DNA Rennes, ...
Financiers : MAA/DGER (dispositif "Chef.fe de projet de partenariat" 2018-2021 et CASDAR TAE 2020-2023), Fondation crédit agricole, Région Bretagne, Agence de l'eau Loire-Bretagne
Fichier : OptimisationDeLaGestionDeLEauEtDeLEne_fichierinitiative1_poster-sager.pdf
Télécharger
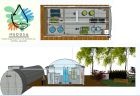
Lien vers vidéo de présentation (1)
https://www.youtube.com/watch?v=dd5fi8golnw&feature=youtu.be
Lien vers vidéo de présentation(2)
https://www.youtube.com/watch?v=g3NSoAqkyCU&feature=youtu.be
Vidéo de présentation (1)
Vidéo de présentation (2)
Mar'Péda, création de zone humide en compensation écologique (Ribécourt - Oise)
Nom de la structure
EPLEFPA de Ribécourt
Téléphone
03 44 75 77 20
Contact (courriel)
julien.renard@educagri.fr
Code postal
60170
Ville
Ribécourt
Département
Oise
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- milieu naturel
Contexte
En 2014, la zone 20 du parc paysager de l’EPLEFPA de Ribécourt est une peupleraie, située dans la partie nord du parc, à proximité d’une zone de lotissement et proche du centre-ville de Ribécourt-Dreslincourt. Il est décidé, dans le cadre d'une mesure de compensation écologique avec Voies Navigables de France et la Société du Canal Seine-Nord Europe, l’abattage des peupliers pour la création d’une zone à vocation humide "en mouvement" dans le but de valoriser la biodiversité...
Objectif
- sauvegarder un espace naturel sur un territoire soumis aux pressions de l’urbanisation
- accueillir des publics (scolaires, professionnels, citoyens …) tout en proposant une vitrine de savoir-faire techniques environnementaux
- inciter les communes à préserver ou développer les zones humides ainsi qu’à maintenir leur patrimoine naturel
- accueillir des publics (scolaires, professionnels, citoyens …) tout en proposant une vitrine de savoir-faire techniques environnementaux
- inciter les communes à préserver ou développer les zones humides ainsi qu’à maintenir leur patrimoine naturel
Description de l'action
2014 : Suppression des peupliers et remise à nue de la zone
2016-2018 : Projets de conceptions par les BTS apprentis Aménagements paysagers
2018 :
. Réalisation par l’entreprise GAY de deux mares (profondes de 80 cm maximum, au milieu de la zone humide de part et d’autre d’un ru qui la traverse d’Ouest en Est), du ponton d'observation et du sentier pédagogique.
. Premières interventions des classes d'élèves pour l'entretien (suppression des repousses, rejets, et nettoyage). Installation d'un troupeau de 10 moutons d'Ouessant pour l'éco-pâturage (gestion des repousses et de la ripisylve, lutte contre la renouée du Japon...)
. Dégagement de la source contenue, aménagement de la sortie d’eau de la source, aménagement et entretien du ru et aménagement / nettoyage de la sortie d’eau vers la rivière souterraine de Ribécourt.
2016-2018 : Projets de conceptions par les BTS apprentis Aménagements paysagers
2018 :
. Réalisation par l’entreprise GAY de deux mares (profondes de 80 cm maximum, au milieu de la zone humide de part et d’autre d’un ru qui la traverse d’Ouest en Est), du ponton d'observation et du sentier pédagogique.
. Premières interventions des classes d'élèves pour l'entretien (suppression des repousses, rejets, et nettoyage). Installation d'un troupeau de 10 moutons d'Ouessant pour l'éco-pâturage (gestion des repousses et de la ripisylve, lutte contre la renouée du Japon...)
. Dégagement de la source contenue, aménagement de la sortie d’eau de la source, aménagement et entretien du ru et aménagement / nettoyage de la sortie d’eau vers la rivière souterraine de Ribécourt.
Résultats
Inscrit depuis 2010 dans une démarche d’écolabel et de « zéro-phyto » le parc du lycée a été précurseur dans la labellisation en tant qu’éco-jardin. Ce projet et cette gestion s’inscrit donc parfaitement dans cette labellisation et permet encore de diversifier les activités sur le parc de 13 ha : de ce fait de nouvelles formations sont envisageables en éco-pâturage, en gestion des milieux humides et en gestion des espaces naturels. Partenaires et coopérateurs pourront donc profiter de cet espace pédagogique.
Utilisation pédagogique
implication des apprenants dans la conception et la gestion différenciée de cette parcelle, comme sur le reste du parc...
Perspective
- Poursuite de l'entretien, des plantations et des aménagements : godets forestiers d’espèces arborées (Chêne rouvre, Charme commun, Erable champêtre) ou arbustives (Cornouiller sanguin et Noisetiers), arbres isolés (Frêne élevé, Bouleau pubescent et Aulne glutineux), aménagement de la ripisylve ((Aulnes glutineux, Saules blancs, Saules des vanniers et pourpres, Cornouillers sanguins)
- Entretien et aménagement sélectifs et raisonnés, à l'image d'un jardin "en mouvement"
- Actions de communication et de formation
- Entretien et aménagement sélectifs et raisonnés, à l'image d'un jardin "en mouvement"
- Actions de communication et de formation
Partenariats techniques/financiers
- Entreprise GAY
- Voies navigables de France
- Société du Canal Seine-Nord Europe
- Voies navigables de France
- Société du Canal Seine-Nord Europe
Fichier : MarPedaCreationDeZoneHumideEnCompensati_fichierinitiative1_fiche_mar-peda_ribecourt.pdf
Télécharger
Mise en place d'une rotation longue en AB avec couverture permanente et cultures associées (Carcassonne - Aude)
Nom de la structure
EPLEFPA Carcassonne
Téléphone
04 68 11 91 19
Contact (courriel)
florian.sanchez@educagri.fr
Code postal
11000
Ville
Carcassonne
Département
Aude
Type d'initiative
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
L’EPLFEPA travaille déjà sur des itinéraires techniques bas intrants (dans le cadre de l’Action 16 du Plan Ecophyto) et sur une évaluation et une mise en valeur de la biodiversité fonctionnelle (dans le cadre du projet Biodiv’EA).
Par ailleurs, sur le territoire, l’eau du bassin versant de l’Aude a une qualité dégradée par les nitrates et les produits phytosanitaires. Le cours d’eau "Palajanel" traverse plusieurs parcelles agricoles de l'exploitation...
La SAU engagée sur cette action correspond à 10 ha de grandes cultures.
Par ailleurs, sur le territoire, l’eau du bassin versant de l’Aude a une qualité dégradée par les nitrates et les produits phytosanitaires. Le cours d’eau "Palajanel" traverse plusieurs parcelles agricoles de l'exploitation...
La SAU engagée sur cette action correspond à 10 ha de grandes cultures.
Objectif
- sensibiliser les apprenants aux pollutions,
- co-construire une rotation innovante en grandes cultures par les BTSA APV
- étudier les performances environnementales et technico-économiques de parcelles exploitées en bio,
- comparer l’impact sur la qualité de l’eau de parcelles exploitées en bio et de parcelles "raisonnées"
Description de l'action
Réalisation d'un schéma décisionnel d'un système de culture, avec rotation sur 10 ans (cf. pj)
Leviers mobilisés : allongement de la rotation et diversification de l'assolement, couverture permanente du sol (semis sous couvert - vivant ou mulch), lutte biologique, travail en non labour du sol, choix variétal.
Point de vigilance : pression adventices
Leviers mobilisés : allongement de la rotation et diversification de l'assolement, couverture permanente du sol (semis sous couvert - vivant ou mulch), lutte biologique, travail en non labour du sol, choix variétal.
Point de vigilance : pression adventices
Résultats
à suivre (3e année de rotation en 2014...)
Utilisation pédagogique
- action pleinement intégrée au M59 des BTSA APV (concevoir et évaluer de nouveaux SDC pour répondre aux enjeux environnementaux)
- poster réalisé en projet PIC (cf. pj)
- lien interfilières avec STAV (chantier de semis), GPN (plantation de haie, mesures de la qualité des eaux de ruissellement des parcelles)
Calendrier
action débutée en 2012
Perspective
Relier l'évolution du système de culture aux mesures d'évaluation de la biodiversité et de la qualité des eaux de ruissellement des parcelles
Partenariats techniques/financiers
Coop Agribio Union, Ecocert, Bio CIVAM, prestataire technique, éleveur, Conseil régional LR (cf. schéma ci-joint)
+ Agence de l'eau RMC, syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières et communauté d'agglo pour les aspects liés à l'impact sur la qualité des eaux (analyses d'eau)
+ Agence de l'eau RMC, syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières et communauté d'agglo pour les aspects liés à l'impact sur la qualité des eaux (analyses d'eau)
Fichier : fichierinitiative1_enquete_carcassonne_schema.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative3_Rotation_Cazaban_APV_2.pdf
Télécharger
Mise en place de systèmes de cultures innovants (Venoy - Yonne)
Nom de la structure
EPL des Terres de l'Yonne
Téléphone
03 86 94 60 00
Contact (courriel)
Alexandra.CHERIFI@educagri.fr
Site Web
http://www.terresdelyonne.com
Code postal
89290
Ville
Venoy
Département
Yonne
Type d'initiative
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
Le département de l'Yonne a mis en évidence 90 points de captage d'eau dont la situation en terme de qualité de l'eau est catastrophique. Cet essai propose un levier d'action aux pouvoirs publics et aux acteurs du territoire pour tenter de redresser la situation. D'autre part, les professionnels de l'agriculture sont conscients de leurs impacts sur l'environnement. Ils sont dans l'attente de propositions et de démonstration concrètes permettant de le réduire. Les résultats de cet essai sont donc très attendus par la profession en vue de son développement.
Le département de l'Yonne a mis en évidence 90 points de captage d'eau dont la situation en terme de qualité de l'eau est catastrophique. Cet essai propose un levier d'action aux pouvoirs publics et aux acteurs du territoire pour tenter de redresser la situation. D'autre part, les professionnels de l'agriculture sont conscients de leurs impacts sur l'environnement. Ils sont dans l'attente de propositions et de démonstration concrètes permettant de le réduire. Les résultats de cet essai sont donc très attendus par la profession en vue de son développement.
Description de l'action
Mise en place d'une rotation sur 7 ans avec 6 cultures (Pois Colza Blé Orge d'hiver Chanvre Blé Orge de printemps) qui passe par la diversification des cultures, l'alternance de cultures d'hiver et de printemps, la mise en place de mesures préventives aux interventions phytosanitaires, l'utilisation de successions culturales induisant des bénéfices agronomiques, la mise en place de couverts hivernaux. L'objectif principal étant : « Plus d'agronomie, moins d'intrants ». Il s'agit de développer un système plus durable selon les trois axes de la durabilité :
Mise en place d'une rotation sur 7 ans avec 6 cultures (Pois Colza Blé Orge d'hiver Chanvre Blé Orge de printemps) qui passe par la diversification des cultures, l'alternance de cultures d'hiver et de printemps, la mise en place de mesures préventives aux interventions phytosanitaires, l'utilisation de successions culturales induisant des bénéfices agronomiques, la mise en place de couverts hivernaux. L'objectif principal étant : « Plus d'agronomie, moins d'intrants ». Il s'agit de développer un système plus durable selon les trois axes de la durabilité :
- Economique : le système de cultures développé doit s'avérer rentable économiquement si l'on souhaite qu'il se développe
- Sociétal : mise en place d'un système permettant d'étaler au mieux le travail pour conserver une certaine qualité de vie
- Environnemental : le protocole a été rédigé de façon a proposer un système respectueux de l'environnement en limitant autant que faire se peut l'utilisation d'intrants.
Utilisation pédagogique
Cet essai permet de montrer aux élèves l'intérêt de l'agronomie en agriculture et la possibilité de s'affranchir de produits phytosanitaires dans certains cas.
Cet essai permet de montrer aux élèves l'intérêt de l'agronomie en agriculture et la possibilité de s'affranchir de produits phytosanitaires dans certains cas.
Calendrier
Débuté en août 2007 pour une durée d'au moins 7 ans
Débuté en août 2007 pour une durée d'au moins 7 ans
- Fin 2006 à juin 2007 : discussion et rédaction du protocole d'essai
- Juin 2007 : Validation du protocole
- Août 2007 : début de la mise en place du protocole (1ère campagne)
- Campagne 2008 à 2009 : 2ème campagne
- Janvier 2009 : présentation des premiers résultats
Mobilisation régionale pour former les agriculteurs de demain aux systèmes de cultures économes et performants (Rambouillet - Yvelines)
Nom de la structure
Bergerie nationale, EPLEFPA La Bretonnière, EPLEFPA St Germain-en-Laye, LEAP Sully de Maganville
Téléphone
01 61 08 68 52
Contact (courriel)
jean-xavier.saint-guily@bergerie-nationale.fr
Contact2 (courriel)
guilhem.boit@educagri.fr
Contact3 (courriel)
roland.trousseau@cneap.fr
Code postal
78500
Ville
Rambouillet
Département
Yvelines
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
Dans le cadre de la transition agroécologique, ces 4 établissements d’enseignement agricole d’Île-de- France ont tous engagé des réflexions et des actions en lien avec l’agroécologie et la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. En réponse à l'appel à projet Ecophyto lancé par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, le projet vise à concevoir et mettre en place au sein de ces 4 établissements et en synergie un panel d'actions d’expérimentation, de sensibilisation et de formation des futurs agriculteurs concernant la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires et la protection de la ressource en eau. Cette démarche s’appuie sur les exploitations des établissements ou celles de leurs territoires. Les exploitations ou les parcelles pédagogiques des établissements présentent en effet une diversité de production, de contextes territoriaux et d’enjeux relatifs à la protection de l’eau (en particulier celles situées sur des aires d'alimentation de captage)
. Bergerie nationale : conversion à l’agriculture biologique des 260 ha de cultures et du troupeau de vache laitière, maintien de 60 ha en prairie permanente et entretien de 114 ha de prairie temporaire multiespèces, plantation en agroforesterie de 400 arbres sur 4 ha de prairies, plateforme de compostage des effluents d’élevage et suivi de la qualité de l’eau du forage du site (cf. fichiers à télécharger : dossier technique exploitation de la Bergerie nationale et article BNInfos) - contact : jean-xavier.saint-guily@bergerie-nationale.fr
. EPLEFPA la Bretonnière : présence d’un verger conservatoire certifié en agriculture biologique, parcelle expérimentale (chambre d’agriculture d’IDF) en agriculture raisonnée, itinéraires techniques et choix de cultures très peu dépendants des produits phytosanitaires (prairies, chanvre, …), projet d’animation et de développement des territoires : « valoriser la transition agroécologique par les circuits-courts » - contact : guilhem.boit@educagri.fr
. EPLEFPA de Saint-Germain-en-Laye : production en agriculture biologique ou en itinéraire technique à bas niveau d’intrants, désherbage mécanique, paillage ou enherbement des interangs, lutte biologique intégrée, récupération des eaux de pluie pour l’arrosage et l’irrigation (cf. article) - contats : sixtine.cayeux@educagri.fr et jean-lou.chestier@educagri.fr
. LEAP Sully : prairie temporaire mélange poacées-Trèfle blanc avec fertilisation azotée réduite, apport de fumier de cheval composté sur une parcelle tous les 3 ans, pas de fertilisation phosphopotassique minérale, itinéraire technique en conduite intégrée sur 2 parcelles avec choix de variétés résistantes, stratégie à un seul fongicide si nécessaire selon risques, pas d’insecticides sur céréales, semis tardifs de céréales, réduction d’objectif de rendement, une parcelle cultivée en agriculture biologique, une parcelle en agroforesterie, une parcelle en luzerne dans la rotation des parcelles, perchoirs à rapaces pour maitriser les populations de campagnols - contacts : murielle.guyard@cneap.fr et roland.trousseau@cneap.fr
. Bergerie nationale : conversion à l’agriculture biologique des 260 ha de cultures et du troupeau de vache laitière, maintien de 60 ha en prairie permanente et entretien de 114 ha de prairie temporaire multiespèces, plantation en agroforesterie de 400 arbres sur 4 ha de prairies, plateforme de compostage des effluents d’élevage et suivi de la qualité de l’eau du forage du site (cf. fichiers à télécharger : dossier technique exploitation de la Bergerie nationale et article BNInfos) - contact : jean-xavier.saint-guily@bergerie-nationale.fr
. EPLEFPA la Bretonnière : présence d’un verger conservatoire certifié en agriculture biologique, parcelle expérimentale (chambre d’agriculture d’IDF) en agriculture raisonnée, itinéraires techniques et choix de cultures très peu dépendants des produits phytosanitaires (prairies, chanvre, …), projet d’animation et de développement des territoires : « valoriser la transition agroécologique par les circuits-courts » - contact : guilhem.boit@educagri.fr
. EPLEFPA de Saint-Germain-en-Laye : production en agriculture biologique ou en itinéraire technique à bas niveau d’intrants, désherbage mécanique, paillage ou enherbement des interangs, lutte biologique intégrée, récupération des eaux de pluie pour l’arrosage et l’irrigation (cf. article) - contats : sixtine.cayeux@educagri.fr et jean-lou.chestier@educagri.fr
. LEAP Sully : prairie temporaire mélange poacées-Trèfle blanc avec fertilisation azotée réduite, apport de fumier de cheval composté sur une parcelle tous les 3 ans, pas de fertilisation phosphopotassique minérale, itinéraire technique en conduite intégrée sur 2 parcelles avec choix de variétés résistantes, stratégie à un seul fongicide si nécessaire selon risques, pas d’insecticides sur céréales, semis tardifs de céréales, réduction d’objectif de rendement, une parcelle cultivée en agriculture biologique, une parcelle en agroforesterie, une parcelle en luzerne dans la rotation des parcelles, perchoirs à rapaces pour maitriser les populations de campagnols - contacts : murielle.guyard@cneap.fr et roland.trousseau@cneap.fr
Objectif
En lien avec le plan national Ecophyto 2 et sa déclinaison régionale, la démarche intégrera les enjeux de la performance des systèmes de culture économes en intrants, la préservation des aires d’alimentation de captage face aux pollutions diffuses, la structuration de nouvelles filières et les démarches collectives entre agriculteurs. Afin de renforcer son impact et son efficience, le projet vise également à valoriser et capitaliser ces actions tout en mobilisant l’assistance technique nécessaire à leur mise en œuvre.
Description de l'action
Les actions attendues :
- Visites d'exploitations innovantes et voyages d’étude dans toute l’Île-de-France et dans d’autres régions (Normandie)
- Développement, implantation et test de supports pédagogiques (panneaux de sensibilisation et d'information
- Groupes de travail prospectifs sur l'évolution des systèmes de production, mise en place, suivi et valorisation pédagogique d’expérimentations techniques
- Achat, utilisation et valorisation pédagogique de matériels et d’équipements innovants (désherbage mécanique par herse étrille)
- Suivi des auxiliaires et des bioagresseurs
- Participation au réseau d'observation du bulletin de santé du végétal grandes cultures
- Création de bases de données technico-économiques sur les systèmes de production, analyse des performances et avantages sur la préservation de la ressource en eau
- Production d’articles de capitalisation et de valorisation
- Organisation de rencontres régionales rassemblant les équipes pédagogiques
- Gestion du partenariat régional et de l’enveloppe budgétaire
Le projet global sera animé par un chargé de mission de la Bergerie nationale (Jean-Xavier Saint-Guily), avec un responsable de projet par établissement (dont deux enseignants référents régionaux "Enseigner à produire autrement")
- Visites d'exploitations innovantes et voyages d’étude dans toute l’Île-de-France et dans d’autres régions (Normandie)
- Développement, implantation et test de supports pédagogiques (panneaux de sensibilisation et d'information
- Groupes de travail prospectifs sur l'évolution des systèmes de production, mise en place, suivi et valorisation pédagogique d’expérimentations techniques
- Achat, utilisation et valorisation pédagogique de matériels et d’équipements innovants (désherbage mécanique par herse étrille)
- Suivi des auxiliaires et des bioagresseurs
- Participation au réseau d'observation du bulletin de santé du végétal grandes cultures
- Création de bases de données technico-économiques sur les systèmes de production, analyse des performances et avantages sur la préservation de la ressource en eau
- Production d’articles de capitalisation et de valorisation
- Organisation de rencontres régionales rassemblant les équipes pédagogiques
- Gestion du partenariat régional et de l’enveloppe budgétaire
Le projet global sera animé par un chargé de mission de la Bergerie nationale (Jean-Xavier Saint-Guily), avec un responsable de projet par établissement (dont deux enseignants référents régionaux "Enseigner à produire autrement")
Utilisation pédagogique
Les effectifs d’apprenants visés sur les 3 ans du projet :
- CEZ-Bergerie nationale : 80
- EPLEFPA de la Bretonnière : 72
- EPLEFPA Saint-Germain-en-Laye : 111
- Lycée agricole privé Sully : 105
Les filières concernées sont nombreuses : CAPA technique horticole, maraichage ou production agricole, Bac Pro Productions horticoles, Bac pro CGEA, BPREA Maraichage, CS Maraichage biologique, BTSA Productions horticoles, Analyse, conduite et stratégie d’entreprise agricole, Productions animales ou végétales.
Un travail est prévu dans chaque établissement pour évaluer l’impact des actions auprès des apprenants visés.
Un bilan quantitatif et qualitatif sera réalisé à la fin du projet.
- CEZ-Bergerie nationale : 80
- EPLEFPA de la Bretonnière : 72
- EPLEFPA Saint-Germain-en-Laye : 111
- Lycée agricole privé Sully : 105
Les filières concernées sont nombreuses : CAPA technique horticole, maraichage ou production agricole, Bac Pro Productions horticoles, Bac pro CGEA, BPREA Maraichage, CS Maraichage biologique, BTSA Productions horticoles, Analyse, conduite et stratégie d’entreprise agricole, Productions animales ou végétales.
Un travail est prévu dans chaque établissement pour évaluer l’impact des actions auprès des apprenants visés.
Un bilan quantitatif et qualitatif sera réalisé à la fin du projet.
Autre valorisation
. Articles BNInfos (cf. pièces jointes)
. Quizz et jeu sérieux sur "effluents d'élevage et qualité des eaux (cf. article BN infos 56 ) et fiches ressources Quizz et Jeu sérieux Efflu'eau . productions des apprenants (posters, panneaux,...)
. 2 webinaires de restitution "Enseigner la préservation de la ressource en eau : quels supports pour quelles démarches pédagogiques ?", 26 janvier (Les actions mises en place dans l'enseignement agricole) et 9 février 2023 (Des démarches pédagogiques à valoriser) (cf. article site adt)
. Quizz et jeu sérieux sur "effluents d'élevage et qualité des eaux (cf. article BN infos 56 ) et fiches ressources Quizz et Jeu sérieux Efflu'eau . productions des apprenants (posters, panneaux,...)
. 2 webinaires de restitution "Enseigner la préservation de la ressource en eau : quels supports pour quelles démarches pédagogiques ?", 26 janvier (Les actions mises en place dans l'enseignement agricole) et 9 février 2023 (Des démarches pédagogiques à valoriser) (cf. article site adt)
Calendrier
2020-2023
Partenariats techniques/financiers
Co-financement Agence de l'eau Seine-Normandie (Appel à projet Ecophyto) (172 000 euros / 227 000 euros)
Fichier : Webinaires_MREA_2023.pdf
Télécharger
Fichier : MobilisationRegionalePourFormerLesAgricult_fichierinitiative2_article_bninfos40.pdf
Télécharger
Fichier : MobilisationRegionalePourFormerLesAgricult_fichierinitiative3_article_bninfos_45.pdf
Télécharger
Fichier : MobilisationRegionalePourFormerLesAgricult_fichierinitiative4_article_bninfos_47.pdf
Télécharger
Optimisation de l'utilisation de l'eau et diminution des charges rejetées en atelier agroalimentaire laitier (Mamirolle-Doubs)
Nom de la structure
ENIL Mamirolle (atelier technologique agroalimentaire laitier)
Téléphone
03 81 55 92 00
Contact (courriel)
jean-louis.berner@educagri.fr
Contact2 (courriel)
richard.revy@educagri.fr
Site Web
http://www.enil.fr
Code postal
25620
Ville
Mamirolle
Département
Doubs
Type d'initiative
- économie d'eau
- traitement des effluents
- qualité de l'eau
Contexte
L’atelier technologique de l’ENIL de Mamirolle transforme chaque année environ 1,15 millions de litres de lait en fromages (environ 230 tonnes de produits fabriqués et commercialisés), contribuant à la formation pratique d’apprenants de différents niveaux (du CAP à la licence professionnelle).
Le secteur d’activité de transformation du lait est considéré comme un grand consommateur d’eau (de 1 à 3 litres d’eau par litre de lait transformés), et générateur d’importantes charges d’effluent (eaux blanches).
Dans le cadre de la principale activité de formation des futurs acteurs de la transformation laitière, mais aussi de la présence depuis 1999 de formations dans le domaine de la gestion de l’eau (BTS GEMEAU, Licence professionnelle GASTE), l’ENIL s’est résolument engagée dans la réduction des consommations d’eau, accompagnée d’une sensibilisation de ses apprenants (Agenda 21, diagnostics énergie et impact environnemental)...
Le secteur d’activité de transformation du lait est considéré comme un grand consommateur d’eau (de 1 à 3 litres d’eau par litre de lait transformés), et générateur d’importantes charges d’effluent (eaux blanches).
Dans le cadre de la principale activité de formation des futurs acteurs de la transformation laitière, mais aussi de la présence depuis 1999 de formations dans le domaine de la gestion de l’eau (BTS GEMEAU, Licence professionnelle GASTE), l’ENIL s’est résolument engagée dans la réduction des consommations d’eau, accompagnée d’une sensibilisation de ses apprenants (Agenda 21, diagnostics énergie et impact environnemental)...
Objectif
- mettre en place un ratio entre la quantité de lait à transformer et la quantité d’eau utilisée et sensibiliser les apprenants à l'utilité du suivi et de l'amélioration de ce ratio
- diminuer les charges rejetées avec l'utilisation d'eau électrolysée dans le process de nettoyage en vue de substituer les produits chimiques
- valider la faisabilité d'un tel dispositif dans le nettoyage du secteur de la transformation agro-alimentaire
Description de l'action
. Analyse des données obtenues
. Dans le cadre du MIL BTSA GEMEAU « Gestion de l’eau et des effluents en transformation laitière », deux groupes d’apprenant ont complété cette première analyse de ces données par des observations en atelier lors de la production. Ce travail d’observation et d’analyse a été complété par des échanges avec les opérateurs (apprentis et stagiaires formation continue de la formation BTSA STA) qui ont expliqué ce qu’ils faisaient. Ces échanges ont permis d’affiner les consignes (bonnes pratiques de nettoyage) en intégrant au mieux les contraintes de la fabrication
. mise en place d’un système de prélèvement en sortie de la NEP
. évaluation de l’effet de l’eau électrolysée sur l’inox
. étude de l’effet détergent de l’eau électrolysée alcaline
. étude de l’effet bactéricide et bactériostatique de l’eau électrolysée acide
réalisées chacune par un groupe d’étudiant BTS GEMEAU au cours des séquences MIL
- action 1 : consommations d'eau :
. Analyse des données obtenues
. Dans le cadre du MIL BTSA GEMEAU « Gestion de l’eau et des effluents en transformation laitière », deux groupes d’apprenant ont complété cette première analyse de ces données par des observations en atelier lors de la production. Ce travail d’observation et d’analyse a été complété par des échanges avec les opérateurs (apprentis et stagiaires formation continue de la formation BTSA STA) qui ont expliqué ce qu’ils faisaient. Ces échanges ont permis d’affiner les consignes (bonnes pratiques de nettoyage) en intégrant au mieux les contraintes de la fabrication
- action 2 : diminution des charges des effluents :
. mise en place d’un système de prélèvement en sortie de la NEP
. évaluation de l’effet de l’eau électrolysée sur l’inox
. étude de l’effet détergent de l’eau électrolysée alcaline
. étude de l’effet bactéricide et bactériostatique de l’eau électrolysée acide
réalisées chacune par un groupe d’étudiant BTS GEMEAU au cours des séquences MIL
Résultats
. mise en place d'un affichage spécifique (bons gestes) et chapitre dédié dans le livret d’accueil de l’atelier technologique, distribué à tous les apprenants et stagiaires extérieurs
> réduction de 40 % des consommations d'eau entre 2008 et 2018
. les premiers essais sur l’eau électrolysée montrent des résultats intéressants, toutefois des problèmes subsistent quant à la stabilité des solutions, en particulier pour l’eau électrolysée acide et sa teneur en chlore.
- action 1 : consommations d'eau :
. mise en place d'un affichage spécifique (bons gestes) et chapitre dédié dans le livret d’accueil de l’atelier technologique, distribué à tous les apprenants et stagiaires extérieurs
> réduction de 40 % des consommations d'eau entre 2008 et 2018
- action 2 : diminution des charges des effluents :
. les premiers essais sur l’eau électrolysée montrent des résultats intéressants, toutefois des problèmes subsistent quant à la stabilité des solutions, en particulier pour l’eau électrolysée acide et sa teneur en chlore.
Utilisation pédagogique
- MIL "Gestion de l'eau et effluents en industrie agroalimentaire" des BTSA GEMEAU : sujets d'expérimentations par groupe (impact de l'eau électrolysée acide sur les inox, évaluation du potentiel bactéricide de l'eau électrolysée acide, évaluation du potentiel détergent de l'eau électrolysée alcaline,...)
- interaction BTSA GEMEAU-BTSA STA sur la formation aux bons gestes liés à la consommation en eau pour le nettoyage en place
- développement d'un "enseignable" sur la gestion durable de l'eau en transformation laitière, dans le cadre d'un MIL avec les BTSA STA (cf. poster en pj)
Autre valorisation
- Utilisation de la Halle de Technologie Laitière et Alimentaire de l’ENIL pour apprendre à enseigner autrement – Jean-Louis Berner – Présentation lors d’un cycle de formation DGER : « Agroalimentaire : apprendre à enseigner autrement » – Sup Agro Florac – 18 novembre 2015
- Regards croisés pour une gestion durable de l’eau. Enseigner la transition agro-écologique à l’ENIL. Jean-Louis BERNER. Revue des ENIL n° 344 - Juillet / Août 2016
- Posters, film de valorisation et "enseignable" sur la gestion durable de l'eau en transformation laitière (2020)
Calendrier
action débutée en 2015
Perspective
- production d'un guide méthodologique de diagnostic du ratio quantité d'eau utilisée rapporté à la quantité de lait transformé (selon le type de transformation sur l'atelier), transposable dans le secteur professionnel
- une communication interne sur le suivi du rejet est mise en place à l’intention des apprenants dans le cadre des enseignements du BTSA STA et du personnel - un guide méthodologique de diagnostic de rejet, transposable dans le secteur professionnel sera produit et diffusable aux différents acteurs du domaine. Des PME du secteur agroalimentaire, ainsi que des collectivités partenaires de l'établissement depuis de nombreuses années, sont prêtes à suivre cette démarche pour valider in situ des résultats établis par l’ENIL de Mamirolle.
Partenariats techniques/financiers
- Société Cleanea
- Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse
- Réseau Mixte Technologique ECOVAL (ECO-compatibilité des produits et des procédés et VALorisation des coproduits)
- PME du secteur agro-alimentaire et collectivités partenaire de l'ENIL
Fichier : OptimisationDeLUtilisationDeLEauEtDimin_fichierinitiative1_posters_mamirolle.pdf
Télécharger
Lien vers vidéo de présentation (1)
http://www.dailymotion.com/video/x2o0xvh_mamirolle-2015_school
Lien vers vidéo de présentation(2)
https://www.dailymotion.com/video/x7u40e1
Vidéo de présentation (1)
mamirolle_2015 par eau-ea
mamirolle_2015 par eau-ea
Vidéo de présentation (2)
Plateforme de démonstration de gestion intégrée des eaux pluviales à l'échelle du bassin Adour-Garonne (Albi -Tarn)
Nom de la structure
EPL Albi-Plateforme technologique GH2O
Téléphone
05 63 49 43 70
Contact (courriel)
jean-pierre.estivals@educagri.fr
Contact2 (courriel)
nicolas.alvarez@educagri.fr
Contact3 (courriel)
sylvie.dolet@educagri.fr
Site Web
http://www.tarn.educagri.fr
Code postal
81000
Ville
Albi
Département
Tarn
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- traitement des effluents
- milieu naturel
- qualité de l'eau
Contexte
Suite aux appels à projets sur la désimperméabilisation des sols lancés en 2020 et 2021 par l'Agence de l'eau Adour-Garonne et le Conseil régional Occitanie, l'EPLEFPA s'est déclaré intéressé, par la voix notamment de la Plateforme technologique GH2O. Le très fort intérêt des partenaires techniques et financiers sur le projet a conduit à le faire grandir et évoluer vers la création d'une véritable Plateforme de démonstration à l'échelle du bassin Adour-Garonne (à l'instar des plateformes gérées par l'ADOPTA à Douai et par l'OIEau à Limoges). L'association des syndicats de bassins versants Tarn-Aveyron accompagne ce projet (depuis juillet 2023)
Objectif
- Répondre à un enjeu environnemental
- Améliorer le cadre de vie sur le campus
- S’inscrire dans un projet de territoire multipartenarial
- Créer un site de démonstration et d’expérimentation
- Impliquer les équipes pédagogiques et les apprenants
- Transférer les résultats
- Diffuser : journées techniques, Semaine de l’Eau,…
- Sensibiliser et former
- Améliorer le cadre de vie sur le campus
- S’inscrire dans un projet de territoire multipartenarial
- Créer un site de démonstration et d’expérimentation
- Impliquer les équipes pédagogiques et les apprenants
- Transférer les résultats
- Diffuser : journées techniques, Semaine de l’Eau,…
- Sensibiliser et former
Description de l'action
Le projet porte sur 4 zones du campus Fonlabour. Surface totale concernée par la désimperméabilisation : 6 000 m²
. Parking Pôle A : 2 400 m²
. Parking Pôle B : 1 800 m²
. Allée Pôle B : 800 m²
. Allée Administration/Auditorum : 1 000 m²
Avec propositions de divers types de revêtement perméables/d'équipements enterrés (tranchée d'infiltration, chaussée à structure réservoir, bassin enterré, puits d'infiltration, réservoir d'eau pluviale) et privilégiant les Solutions fondées sur la Nature (échelle d'eau, arbre de pluie, module végétalisé, mur végétal autonome, noue, jardin de pluie, parc inondable, toiture végétalisée, espace d'eau permanent)
(voir détails en pj, comité technique novembre 2024)
Programme d'étude 2024-2025 :
Zonage : plan et topographie
Etat des lieux des revêtements actuels
Plan de circulation et contraintes
Analyse paysagère
Etudes hydraulique et géotechnique
Etudes environnementales et réglementaires
Etude bibliographique, retours d’expériences et attentes du projet
Elaboration du CDC général du projet : Comité technique
Comité de pilotage : Validation du CDC général du projet
Dimensionnement des aménagements
Rédaction d'un "Matériel et Méthodes"
Cahier des charges de l’animation de la plateforme
Comité de pilotage : Validation de l'Avant-Projet Sommaire
. Parking Pôle A : 2 400 m²
. Parking Pôle B : 1 800 m²
. Allée Pôle B : 800 m²
. Allée Administration/Auditorum : 1 000 m²
Avec propositions de divers types de revêtement perméables/d'équipements enterrés (tranchée d'infiltration, chaussée à structure réservoir, bassin enterré, puits d'infiltration, réservoir d'eau pluviale) et privilégiant les Solutions fondées sur la Nature (échelle d'eau, arbre de pluie, module végétalisé, mur végétal autonome, noue, jardin de pluie, parc inondable, toiture végétalisée, espace d'eau permanent)
(voir détails en pj, comité technique novembre 2024)
Programme d'étude 2024-2025 :
Zonage : plan et topographie
Etat des lieux des revêtements actuels
Plan de circulation et contraintes
Analyse paysagère
Etudes hydraulique et géotechnique
Etudes environnementales et réglementaires
Etude bibliographique, retours d’expériences et attentes du projet
Elaboration du CDC général du projet : Comité technique
Comité de pilotage : Validation du CDC général du projet
Dimensionnement des aménagements
Rédaction d'un "Matériel et Méthodes"
Cahier des charges de l’animation de la plateforme
Comité de pilotage : Validation de l'Avant-Projet Sommaire
Utilisation pédagogique
implication active des étudiants des filières GEMEAU, Aménagement paysager et STAV : description du site, analyses préalables, identification des attentes et besoins, fonctionnement hydraulique du site, analyse de la qualité des eaux, réceuil de données (matériel et méthode), recherche de références, esquisses et plans
Autre valorisation
Journée technique "Le défi de la gestion intégrée des eaux pluviales : Conduire un projet de désimperméabilisation des sols" (21 novembre 2024. cf article)
Calendrier
2023-2028
Partenariats techniques/financiers
Association des syndicats du bassin versant Tarn-Aveyron (partenaire technique, assistance à maîtrise d'ouvrage)
Agence de l'eau Adour-Garonne (soutien technique et financier)
Région Occitanie (maître d'ouvrage, accompagnement, appui technique, diffusion d'information)
Département du Tarn (soutien technique et financier)
DDT du Tarn (appui réglementaire et technique)
OIEau (appui technique, accompagnement, promotion)
Syndicat mixte de bassin versant Tarn aval (appui technique)
Bureau d'études (assistance à maîtrise d'ouvarge et maîtrise d'oeuvre)
Communuaté d'agglo de l'Albigeois (appui technique)
Pôle Aqua Valley (mise en relation avec entreprises innovantes, diffusion des documlents produits)
Partenaires cibles :
Collectivités maîtres d'ouvarges (accompagnement/démonstartion)
Architectes, urbanistes, constructeurs (cahiers des charges, législation, freins et leviers du changement)
Entreprises (savoir-faire, technicité)
Particuliers (sensibilisation, parcours-découverte)
Agence de l'eau Adour-Garonne (soutien technique et financier)
Région Occitanie (maître d'ouvrage, accompagnement, appui technique, diffusion d'information)
Département du Tarn (soutien technique et financier)
DDT du Tarn (appui réglementaire et technique)
OIEau (appui technique, accompagnement, promotion)
Syndicat mixte de bassin versant Tarn aval (appui technique)
Bureau d'études (assistance à maîtrise d'ouvarge et maîtrise d'oeuvre)
Communuaté d'agglo de l'Albigeois (appui technique)
Pôle Aqua Valley (mise en relation avec entreprises innovantes, diffusion des documlents produits)
Partenaires cibles :
Collectivités maîtres d'ouvarges (accompagnement/démonstartion)
Architectes, urbanistes, constructeurs (cahiers des charges, législation, freins et leviers du changement)
Entreprises (savoir-faire, technicité)
Particuliers (sensibilisation, parcours-découverte)
Fichier : presentation_Comite_technique_12_novembre_2024.pdf
Télécharger
Fichier : presentation_copil_09avril2025.pdf
Télécharger


Plateforme expérimentale d'évaluation du compostage de déchets verts en agriculture (Aix-en-Provence - Bouches-du-Rhône)
Nom de la structure
EPLEFPA Aix Valabre Marseille
Téléphone
04 42 65 43 20
Contact (courriel)
serge.banet@educagri.fr
Contact2 (courriel)
michel.neviere@educagri.fr
Site Web
http://www.epl.valabre.educagri.fr
Code postal
13548
Ville
Gardanne
Département
Bouches-du-Rhône
Type d'initiative
- économie d'eau
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
Dans la région sous climat méditerranéen, les pratiques agricoles actuelles conduisent fréquemment à une baisse de teneur en matière organique des sols qui induit une chute des performances des cultures. Pour compenser cette baisse, l'agriculture conventionnelle propose en réponse l'apport de fertilisants externes chimiques avec des impacts connus sur les nappes phréatiques et le GES.
Avec la plateforme de compostage, il s’agit d’améliorer le taux de matière organique des sols en utilisant des déchets verts issus de zone urbaine de proximité (jardins et espaces verts), permettant d’augmenter la résilience, l’autonomie (dont la capacité de rétention en eau) et les capacités fonctionnelles biologiques des sols.
Dans la région sous climat méditerranéen, les pratiques agricoles actuelles conduisent fréquemment à une baisse de teneur en matière organique des sols qui induit une chute des performances des cultures. Pour compenser cette baisse, l'agriculture conventionnelle propose en réponse l'apport de fertilisants externes chimiques avec des impacts connus sur les nappes phréatiques et le GES.
Avec la plateforme de compostage, il s’agit d’améliorer le taux de matière organique des sols en utilisant des déchets verts issus de zone urbaine de proximité (jardins et espaces verts), permettant d’augmenter la résilience, l’autonomie (dont la capacité de rétention en eau) et les capacités fonctionnelles biologiques des sols.
Objectif
- mettre au point un process de compostage de déchets verts au champ avec suivi et évaluation de l'impact environnemental
- évaluer la valeur agronomique des produits organiques à divers stades de maturation en grandes cultures et en vigne
- mettre au point un process de compostage de déchets verts au champ avec suivi et évaluation de l'impact environnemental
- évaluer la valeur agronomique des produits organiques à divers stades de maturation en grandes cultures et en vigne
Description de l'action
1/ Co-construction (en partenariat) de protocoles et d'expérimentations :
- évaluation de la maturité du compost
- évaluation des transferts vers le sol au cours du compostage
process de compostage, réalisé de novembre 2015 à décembre 2016 sur deux types de déchets verts : criblés (<4 cm), non criblés
avec suivi de la maturation et analyse de la composition des lixiviats et des eaux de ruissellement. Un suivi a également été réalisé sur tas de déchets verts criblés irrigué (cf. rapport ci-joint)
- évaluation de la valeur agronomique des composts sur les systèmes de grandes cultures et en production viticole biologique
2/ Conduite d'actions d'expérimentation :
- différentes modalités de compostage, suivi de l'évolution du produit et suivi des transferts vers le sol
- épandages selon différentes modalités
- collecte de données conformément aux protocoles
3/ Traitement et analyse des données :
- validation du protocole de compostage optimal
- évaluation de l'impact du compost sur l'autonomie des systèmes (fertilité chimique et biologique du sol)
- valeur agronomique du produit et production de références
4/ Diffusion des résultats
- visites professionnels, classes
- interventions, valorisation de la démarche
- rédaction et diffusion de documents de synthèse
1/ Co-construction (en partenariat) de protocoles et d'expérimentations :
- évaluation de la maturité du compost
- évaluation des transferts vers le sol au cours du compostage
process de compostage, réalisé de novembre 2015 à décembre 2016 sur deux types de déchets verts : criblés (<4 cm), non criblés
avec suivi de la maturation et analyse de la composition des lixiviats et des eaux de ruissellement. Un suivi a également été réalisé sur tas de déchets verts criblés irrigué (cf. rapport ci-joint)
- évaluation de la valeur agronomique des composts sur les systèmes de grandes cultures et en production viticole biologique
2/ Conduite d'actions d'expérimentation :
- différentes modalités de compostage, suivi de l'évolution du produit et suivi des transferts vers le sol
- épandages selon différentes modalités
- collecte de données conformément aux protocoles
3/ Traitement et analyse des données :
- validation du protocole de compostage optimal
- évaluation de l'impact du compost sur l'autonomie des systèmes (fertilité chimique et biologique du sol)
- valeur agronomique du produit et production de références
4/ Diffusion des résultats
- visites professionnels, classes
- interventions, valorisation de la démarche
- rédaction et diffusion de documents de synthèse
Utilisation pédagogique
- intégration dans le module MIL expérimentation pour les BTSA APV (mise en place, conduite des essais, analyse statistique). Intervention en BPREA
- support de TP en BTSA APV : étude du sol, de la biodiversité, des pratiques culturales et du suivi de cultures
- support de satge pour 2 BTSA APV : analyse de systèmes de culture et conduites innovantes
- transmission des BTS vers les terminales S et STAV (suivis de terrain), 1eres et 2ndes (EATDD)
- intégration dans le module MIL expérimentation pour les BTSA APV (mise en place, conduite des essais, analyse statistique). Intervention en BPREA
- support de TP en BTSA APV : étude du sol, de la biodiversité, des pratiques culturales et du suivi de cultures
- support de satge pour 2 BTSA APV : analyse de systèmes de culture et conduites innovantes
- transmission des BTS vers les terminales S et STAV (suivis de terrain), 1eres et 2ndes (EATDD)
Autre valorisation
Vers la profession : visites d'essais, participation et interventions dans des réunions techniques, plaquettes nationales et régionales, compte-rendus d'expérimentations, articles de presse (régionale, agricole), journées inter-régionales...
Vers la profession : visites d'essais, participation et interventions dans des réunions techniques, plaquettes nationales et régionales, compte-rendus d'expérimentations, articles de presse (régionale, agricole), journées inter-régionales...
Perspective
échéance 2020
échéance 2020
Partenariats techniques/financiers
- GIS Grandes cultures de Valabre
- Universités de Toulon et de Marseille
- Chambre d'agriculture des Bouches du Rhône
- Conseil régional PACA
- Conseil départemental des Bouches du Rhône
- Vert Carbone
- Agence de l'eau RMC
- GIS Grandes cultures de Valabre
- Universités de Toulon et de Marseille
- Chambre d'agriculture des Bouches du Rhône
- Conseil régional PACA
- Conseil départemental des Bouches du Rhône
- Vert Carbone
- Agence de l'eau RMC
Fichier : fichierinitiative1_C.R._Compostage_et_dechets_verts_2016.pdf
Télécharger

Plateforme expérimentale en agro-écologie (Toulouse - Haute-Garonne)
Nom de la structure
EPLEFPA Toulouse Auzeville
Téléphone
05 61 00 30 70
Contact (courriel)
frederic.robert@educagri.fr
Contact2 (courriel)
sophie.rousval@educagri.fr
Site Web
https://plateforme-agroecologie.fr/
Code postal
31326
Ville
Castanet-Tolosan
Département
Haute-Garonne
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- économie d'eau
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
La plateforme agro-écologique est portée par l'exploitation de l'EPL qui est située en zone périurbaine en bordure du Canal du Midi entre Ramonville d'un coté et Castanet-Tolosan de l'autre. Cette exploitation agricole est constituée de 40 ha exploités en grandes cultures (dont 20 ha en agriculture biologique) d'un atelier apicole et d'un atelier avicole. L'exploitation consacre environ 5 ha à l'expérimentation, répartis en plusieurs parcelles.
En 2010, L'exploitation intègre le réseau DEPHY Ferme en tant qu'exploitation pilote. L'engagement en faveur de l'agro-écologie aboutit à la création de la plateforme en 2012 afin de faciliter la transition des agriculteurs de Midi-Pyrénées vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement.
Les actions sont mises en oeuvre en partenariat avec des organismes professionnels agricoles ou de la recherche agronomique. Elles ont pour but de contribuer à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion de pratiques nouvelles...
En 2010, L'exploitation intègre le réseau DEPHY Ferme en tant qu'exploitation pilote. L'engagement en faveur de l'agro-écologie aboutit à la création de la plateforme en 2012 afin de faciliter la transition des agriculteurs de Midi-Pyrénées vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement.
Les actions sont mises en oeuvre en partenariat avec des organismes professionnels agricoles ou de la recherche agronomique. Elles ont pour but de contribuer à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion de pratiques nouvelles...
Objectif
- Replacer les enjeux territoriaux au coeur de l'enseignement agricole
- Créer des références techniques répondant aux enjeux du territoire
- Informer et former les acteurs futurs du territoire
- Créer des références techniques répondant aux enjeux du territoire
- Informer et former les acteurs futurs du territoire
Description de l'action
Thématiques de travail : gestion des adventices (rotation et diversification des cultures, décalage et densité de semis, non labour, désherbage mécanique,...), nutrition et santé de la plante (biostimulants, biocontrôle, stimulateurs de défense), gestion durable et fertilité des sols (travail du sol vs couverts végétaux), développement de filières et autonomie des territoires et des exploitations (diversification de filières courtes, adaptation des itinéraires techniques,autonomie fourragère,...), gestion de l'eau (optimisation de la réserve utile, biostimulants foliaires,...)
> essais sur site ou délocalisés chez des agriculteurs
> mise en place de formations courtes adaptées au contexte territorial à destination des agriculteurs et techniciens (transfert des références locales)
> journée d'animations techniques
> journée porte ouverte annuelle (cf. article en pj)
Développement de l'action en réseau avec 2 autres exploitations de lycées agricoles : Castelnaudary et Lavaur (dispositif "chef de projet de partenariat" 2017-2020)
> essais sur site ou délocalisés chez des agriculteurs
> mise en place de formations courtes adaptées au contexte territorial à destination des agriculteurs et techniciens (transfert des références locales)
> journée d'animations techniques
> journée porte ouverte annuelle (cf. article en pj)
Développement de l'action en réseau avec 2 autres exploitations de lycées agricoles : Castelnaudary et Lavaur (dispositif "chef de projet de partenariat" 2017-2020)
Résultats
cf. projets menés : https://plateforme-agroecologie.fr/projets
Utilisation pédagogique
Les apprenants sont acteurs du développement du projet :
- Co-conception des références techniques par les BTSA APV
- Transfert d'essais chez agriculteurs par les étudiants en licence professionnelle COSYCA (Conseil en Système de Culture Agroécologique)
- Conseil et animation de groupes d'agriculteurs en associant les organismes de développement (LP COSYCA)
- Création de livrables à destination des agriculteurs (BTS ACSE)
- Organisation de visites des essais de la plateforme par les BTS APV et les LP COSYCA ; à destination des autres lycées agricoles, des agriculteurs et techniciens
- Co-conception des références techniques par les BTSA APV
- Transfert d'essais chez agriculteurs par les étudiants en licence professionnelle COSYCA (Conseil en Système de Culture Agroécologique)
- Conseil et animation de groupes d'agriculteurs en associant les organismes de développement (LP COSYCA)
- Création de livrables à destination des agriculteurs (BTS ACSE)
- Organisation de visites des essais de la plateforme par les BTS APV et les LP COSYCA ; à destination des autres lycées agricoles, des agriculteurs et techniciens
Autre valorisation
- Vulgarisation de référence pour les formations agricoles
- Création de supports pédagogiques à destination de l'enseignement technique agricole
- Diffusion de supports de conférences : cf. https://plateforme-agroecologie.fr/savoir-faire/ et https://www.youtube.com/channel/UCxGb6wZk7cTvNJbxLyRnddg/videos
- Création de supports pédagogiques à destination de l'enseignement technique agricole
- Diffusion de supports de conférences : cf. https://plateforme-agroecologie.fr/savoir-faire/ et https://www.youtube.com/channel/UCxGb6wZk7cTvNJbxLyRnddg/videos
Calendrier
2012-2022
Perspective
Transformation en GIP " en 2022
Partenariats techniques/financiers
- Chambre régionale d'agriculture Occitanie, chambres départementales d'agriculture de Haute-Garonne, Ariège, Tarn-et-Garonne
- coopératives Coop de France, Qualisol
- Association de coordination technique agricole (ACTA) : Arvalis et Terre Inovia
- INRA Toulouse
- Agence de l'eau Adour-Garonne
- RMT Florad / CASDAR Vancouver
- coopératives Coop de France, Qualisol
- Association de coordination technique agricole (ACTA) : Arvalis et Terre Inovia
- INRA Toulouse
- Agence de l'eau Adour-Garonne
- RMT Florad / CASDAR Vancouver
Fichier : fichierinitiative1_article_Toulouse_JPO_2017.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative2_Toulouse_projet_agro-ecologie_.pdf
Télécharger
Lien vers vidéo de présentation (1)
http://www.dailymotion.com/video/x5ojlhc_toulouse-2017-jpo-plateforme-agro-ecologique_school
Vidéo de présentation (1)
Toulouse_2017_JPO_plateforme_agro-ecologique par eau-ea
Toulouse_2017_JPO_plateforme_agro-ecologique par eau-ea
Pour la création du Parlement de la Mer (La Canourgue - Lozère)
Nom de la structure
Lycée Louis Pasteur (EPLEFPA Lozère)
Téléphone
04 66 32 83 54
Contact (courriel)
legta.la-canourgue@educagri.fr
Site Web
http://wwweplealozere.fr
Adresse postale
LEGTPA Louis PASTEUR
Adresse (suite)
Chemin de Fraissinet
Code postal
48500
Ville
LA CANOURGUE
Département
Lozère
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
Contexte
Pour prendre en main la Méditerranée, le Président du conseil régional Languedoc-Roussillon crée le Parlement de la mer et mobilise le monde maritime du littoral à l'arrière-pays autour de réunions publiques pour rassembler les acteurs et aborder les problématiques qui les touchent.
Pour prendre en main la Méditerranée, le Président du conseil régional Languedoc-Roussillon crée le Parlement de la mer et mobilise le monde maritime du littoral à l'arrière-pays autour de réunions publiques pour rassembler les acteurs et aborder les problématiques qui les touchent.
Objectif
Les étudiants de BTSA Aquaculture , de BTSA Gestion et Maitrise de l'Eau du Lycée de La Canourgue, ainsi que les étudiants du BTSA Technico-commercial produits alimentaires et boissons du CFAA de Marvejols (tous étudiants de l'EPLEFPA de La Lozère) sont sollicités par le Conseil Régional Lanquedoc Roussillon pour contribuer à la réunion publique organisée à Mende le 28 novembre 2012.
Les étudiants de BTSA Aquaculture , de BTSA Gestion et Maitrise de l'Eau du Lycée de La Canourgue, ainsi que les étudiants du BTSA Technico-commercial produits alimentaires et boissons du CFAA de Marvejols (tous étudiants de l'EPLEFPA de La Lozère) sont sollicités par le Conseil Régional Lanquedoc Roussillon pour contribuer à la réunion publique organisée à Mende le 28 novembre 2012.
Description de l'action
Les étudiants préparent en amont leur contribution à la création du Parlement de la Mer avec les enseignants et présentent cette contribution le 28 novembre 2012 à Mende :
- le territoire lozérien (pays des sources trois bassins versants)
- leurs formations du secteur de la production et des services : Le BTSA Aquaculture qui aborde à la fois l'aquaculture d'étang, la salmoniculture et l'aquaculture marine ; Le BTS Gestion et Maîtrise de l'Eau qui traite de la gestion et de la maîtrise du bassin versant, de l'utilisation de l'eau pour les activités agricoles, piscicoles, de potabilisation de l'eau, de son traitement et de la maîtrise des rejets ; le BTS Technico-commercial produits alimentaires qui associe à la fois la connaissance d'un produit (élevage et transformation du poisson) et sa commercialisation.
- les outils construits par le Conseil Régional Languedoc Roussillon pour l'EPLEFPA de La Lozère (ateliers de transformation à Florac et à La Canourgue, exploitation piscicole, circuit fermé thermo-régulé, halle hydraulique), qui permettent de développer la technicité des formations et une approche concrète des métiers)
- les liens qu'ils ont avec la mer (les risques d'impact des activités terrestres agricoles, industrielles, urbaines sur le littoral, la nécessité de trouver un compromis entre les activités terrestres et maritimes)
- leurs attentes en termes d'emplois
- le domaine de l'aquaculture (émergence d'une aquaculture économe en eau et minimisant les rejets, mise en place de systèmes hydroponiques innovants, développement de l'algoculture pour l'alimentation animale et la chimie verte),
- l'importance d'une filière de production aquacole privilégiant de nouveaux marchés alimentaires, répondant aux évolutions sociétales avec des produits de qualité,
- le développement des métiers de la gestion de l'eau dans un contexte de changement climatique, de maintien des équilibres biologiques et du patrimoine naturel, d'élimination des substances dangereuses dans l'eau mais aussi d'aménagement du territoire et d'urbanisme,
- leurs propositions par rapport au Parlement de La Mer (création d'un collège "étudiants").
- le territoire lozérien (pays des sources trois bassins versants)
- leurs formations du secteur de la production et des services : Le BTSA Aquaculture qui aborde à la fois l'aquaculture d'étang, la salmoniculture et l'aquaculture marine ; Le BTS Gestion et Maîtrise de l'Eau qui traite de la gestion et de la maîtrise du bassin versant, de l'utilisation de l'eau pour les activités agricoles, piscicoles, de potabilisation de l'eau, de son traitement et de la maîtrise des rejets ; le BTS Technico-commercial produits alimentaires qui associe à la fois la connaissance d'un produit (élevage et transformation du poisson) et sa commercialisation.
- les outils construits par le Conseil Régional Languedoc Roussillon pour l'EPLEFPA de La Lozère (ateliers de transformation à Florac et à La Canourgue, exploitation piscicole, circuit fermé thermo-régulé, halle hydraulique), qui permettent de développer la technicité des formations et une approche concrète des métiers)
- les liens qu'ils ont avec la mer (les risques d'impact des activités terrestres agricoles, industrielles, urbaines sur le littoral, la nécessité de trouver un compromis entre les activités terrestres et maritimes)
- leurs attentes en termes d'emplois
- le domaine de l'aquaculture (émergence d'une aquaculture économe en eau et minimisant les rejets, mise en place de systèmes hydroponiques innovants, développement de l'algoculture pour l'alimentation animale et la chimie verte),
- l'importance d'une filière de production aquacole privilégiant de nouveaux marchés alimentaires, répondant aux évolutions sociétales avec des produits de qualité,
- le développement des métiers de la gestion de l'eau dans un contexte de changement climatique, de maintien des équilibres biologiques et du patrimoine naturel, d'élimination des substances dangereuses dans l'eau mais aussi d'aménagement du territoire et d'urbanisme,
- leurs propositions par rapport au Parlement de La Mer (création d'un collège "étudiants").
Résultats
Suite à cette présentation, les étudiants ont participé au lancement du Parlement de la mer le 21 mars 2013 à Montpellier.
Ils seront invités dans le cadre du fonctionnement du Parlement à participer au Forum, réseau des résidents de la mer, dont les adhérents seront informés et invités à l'ensemble des manifestations maritimes du Languedoc Roussillon dont une réunion annuelle publique
Le Parlement comprendra également une assemblée de 85 membres désignés, élus et acteurs de la mer participant aux commissions mises en place :
. Activités, emplois et métiers d'avenir
. Aménagements durables et environnement
. Coopérations et vivre ensemble
...Ainsi qu'un Bureau de sept membres (le Président du Parlement, six vice- présidents et un membre représentant l'Etat)
Suite à cette présentation, les étudiants ont participé au lancement du Parlement de la mer le 21 mars 2013 à Montpellier.
Ils seront invités dans le cadre du fonctionnement du Parlement à participer au Forum, réseau des résidents de la mer, dont les adhérents seront informés et invités à l'ensemble des manifestations maritimes du Languedoc Roussillon dont une réunion annuelle publique
Le Parlement comprendra également une assemblée de 85 membres désignés, élus et acteurs de la mer participant aux commissions mises en place :
. Activités, emplois et métiers d'avenir
. Aménagements durables et environnement
. Coopérations et vivre ensemble
...Ainsi qu'un Bureau de sept membres (le Président du Parlement, six vice- présidents et un membre représentant l'Etat)
Utilisation pédagogique
Tout comme la consultation publique concernant le projet Aquadomitia à laquelle les étudiants du lycée Louis Pasteur ont participé en 2012, cette implication dans la création du Parlement de la Mer permet aux jeunes en formation de comprendre les enjeux d'un rassemblement d'acteurs divers ayant des intérêts variés et parfois contradictoires sur la façon de "prendre en main la Méditerranée" :
pêcheurs, aquaculteurs, plaisanciers, professionnels du tourisme, de l'alimentation, de la gestion de l'eau, des milieux naturels, institutions, élus, associations...
Cette participation met en perspective les opportunités d'insertion professionnelle au sein des filières aquaculture, GEMEAU et commerce des produits alimentaires pour les étudiants en formation (module M 11 des référentiels de BTSA). Elle incite à présenter les opportunités offertes par l'EPLEFPA de la Lozère en matière de conduite d'expérimentations dans le domaine de l'eau et de l'aquaculture : de nouveaux enjeux se concrétisent actuellement autour de l'algoculture, et notamment tous les enjeux autour des micro- algues dans le domaine du traitement de l'eau et de la chimie verte mais aussi dans celui de l'aquaculture.
Face à des enjeux stratégiques mondiaux relatifs au développement des bioénergies et des produits biosourcés, les micro-algues offrent un potentiel d'innovation pour les secteurs de l'énergie, de la chimie, de la nutrition humaine et animale et de la cosmétique de par leur richesse intrinsèque. Elles apparaissent aujourd'hui comme une solution porteuse d'avenir et de développements économiques majeurs à un horizon d'une dizaine d'années.
Le développement de la mobilité des jeunes à l'international pour favoriser leur insertion professionnelle apparait également comme un enjeu stratégique majeur pour les 3 secteurs de formations développés. Les pays de la Méditerranée sont demandeurs sur les thématiques aquaculture, algoculture, aquaponie, traitement de l'eau et transformation agro -alimentaire.
Tout comme la consultation publique concernant le projet Aquadomitia à laquelle les étudiants du lycée Louis Pasteur ont participé en 2012, cette implication dans la création du Parlement de la Mer permet aux jeunes en formation de comprendre les enjeux d'un rassemblement d'acteurs divers ayant des intérêts variés et parfois contradictoires sur la façon de "prendre en main la Méditerranée" :
pêcheurs, aquaculteurs, plaisanciers, professionnels du tourisme, de l'alimentation, de la gestion de l'eau, des milieux naturels, institutions, élus, associations...
Cette participation met en perspective les opportunités d'insertion professionnelle au sein des filières aquaculture, GEMEAU et commerce des produits alimentaires pour les étudiants en formation (module M 11 des référentiels de BTSA). Elle incite à présenter les opportunités offertes par l'EPLEFPA de la Lozère en matière de conduite d'expérimentations dans le domaine de l'eau et de l'aquaculture : de nouveaux enjeux se concrétisent actuellement autour de l'algoculture, et notamment tous les enjeux autour des micro- algues dans le domaine du traitement de l'eau et de la chimie verte mais aussi dans celui de l'aquaculture.
Face à des enjeux stratégiques mondiaux relatifs au développement des bioénergies et des produits biosourcés, les micro-algues offrent un potentiel d'innovation pour les secteurs de l'énergie, de la chimie, de la nutrition humaine et animale et de la cosmétique de par leur richesse intrinsèque. Elles apparaissent aujourd'hui comme une solution porteuse d'avenir et de développements économiques majeurs à un horizon d'une dizaine d'années.
Le développement de la mobilité des jeunes à l'international pour favoriser leur insertion professionnelle apparait également comme un enjeu stratégique majeur pour les 3 secteurs de formations développés. Les pays de la Méditerranée sont demandeurs sur les thématiques aquaculture, algoculture, aquaponie, traitement de l'eau et transformation agro -alimentaire.
Autre valorisation
Valorisation lors des journées portes ouvertes (6 avril 2013) et des manifestations organisées par l'EPL
Valorisation lors des journées portes ouvertes (6 avril 2013) et des manifestations organisées par l'EPL
Calendrier
Participation des étudiants au forum et représentation du lycée souhaitée à l'assemblée créée au sein du Parlement de la Mer
Participation des étudiants au forum et représentation du lycée souhaitée à l'assemblée créée au sein du Parlement de la Mer
Perspective
- développement des liens déjà existants entre les établissements de formation du littoral et de la Lozère : Université de Montpellier II, Lycée de la Mer à Sète, CTA Intechmer, SAS Greenstar, mais aussi avec le milieu de la recherche (CIRAD, INRA).
- ouverture du BTSA Technico-commercial Produits Alimentaires par la voie initiale en 2014 à La Canourgue, développement de formations dans le domaine de l'algoculture (plateforme de formation GREENSTAR).
- conduite d'expérimentations innovantes (Appel à Projet CASDAR APIVA Tiers temps ingénieur Animation et Développement des Territoires Ruraux) dans le domaine de l'eau et de l'aquaculture, auxquelles les élèves et les étudiants seront associés (y compris ceux venant des formations des établissements du littoral).
- participation du LEGTPA de La Canourgue à l'Assemblée du Parlement de la mer : commission activités, emplois, métiers d'avenir.
Partenariats techniques/financiers
- soutien financier du Conseil Régional Languedoc Roussillon
- partenariat avec la filière professionnelle , la recherche, les instituts techniques.
Fichier : fichierinitiative1_presentation_parlement_de_la_mer_GEMEAU.pdf
Télécharger
Préservation, gestion et sensibilisation autour d'une zone humide (Valdoie - Territoire de Belfort)
Nom de la structure
EPLEFPA de Valdoie
Téléphone
0384584960
Contact (courriel)
pierre.yves.perroud@educagri.fr
Contact2 (courriel)
corinne.mammou@educagri.fr
Contact3 (courriel)
vincent.dufraisse@educagri.fr
Site Web
http://www.valdoie-formation.fr
Code postal
90300
Ville
Valdoie
Département
Territoire-de-Belfort
Type d'initiative
- milieu naturel
- qualité de l'eau
Contexte
Les quatre étangs historiques situés dans le domaine de l'EPLEFPA font partie du réseau d'étangs de Malsaucy. Si trois de ces étangs sont encore en eau (et valorisés en pisciculture), le troisième, l'étang « Subiger » (ou « étang n° 4 ») a été identifié zone humide par la DDT en 2011. Il n’est plus en eau que de façon partielle et transitoire et la strate arbustive (saules) se développe, entraînant la fermeture progressive de cette zone humide. Conscient de la richesse de son patrimoine naturel, l'établissement et le CEN Franche-Comté ont souhaité mettre en œuvre des actions de gestion visant à restaurer et à mettre en valeur cet ancien étang. Une convention quadripartite avec également la SNCF (financement de mesure compensatoire) et le conseil régional vise à mettre en place un plan de gestion décennal de ce domaine, situé dans la zone de captage rapprochée des puits alimentant toute la commune en eau potable...
Objectif
- Préserver le fonctionnement de la zone humide et maintenir la spécificité écologique des habitats et des espèces
- Sensibiliser et impliquer la population et les différents acteurs locaux dans la conservation du site
- Suivre l'évolution du site, approfondir les connaissances et évaluer les résultats de la gestion mise en œuvre
Description de l'action
- maintien d'un fonctionnement hydrologique pérenne de la zone humide (niveau d'eau)
- contention de l’embroussaillement du site (débroussaillage ligneux, maintien des hélophytes)
- limitation de la prolifération des espèces invasives (jussie)
- vieillissement des arbres remarquables, conservation du bois mort sur pied et au sol
- animations/sensibilisation auprès des scolaires
- valorisation de l'intérêt du site (sentier, panneaux, observatoire)
- mise en place d'un conservateur local (pouvant être confié à un groupe d'élèves encadrés par un/des enseignant.s)
- mise en place d'une réunion annuelle de concertation entre les partenaires
- suivi de l'impact sur le sol et sur la végétation de la gestion des niveaux d'eau (équipement en piézomètres)
- suivi du peuplement de libellule comme indicateur de la biodiversité du site (programme RHOMEO)
- analyse plus poussée du fonctionnement hydrologique à l’échelle du bassin versant de la zone humide
- bilan annuel de la gestion mise en place, ainsi qu’au terme du plan de gestion
- engagement dans le dispositif national EDUC'Ecophyto de l'enseignement agricole (2017-2020)
Utilisation pédagogique
Le plan de gestion de gestion rédigé par le CEN Franche-Comté est utilisé comme support pédagogique : les élèves (bac pro aménagement) réalisent notamment les opérations d’entretien des espaces en vue de développer des techniques professionnelles liées au référentiel du diplôme ; ils participent au suivi de l’évolution de la flore et de la faune sur les espaces entretenus, préparent et s’inscrivent dans une action de communication relative à la gestion patrimoniale de cet espace (en partenariat avec le CEN Franche-Comté et SNCF Réseau). cf. fiche pollen
Autre valorisation
- Fiche pollen :lien
- Plaquette de communication (cf. pj)
- Plaquette de communication (cf. pj)
Calendrier
Plan de gestion 2018-2027
Partenariats techniques/financiers
Conseil régional, SNCF Réseau, CEN Franche-Comté
Agence de l'eau AERMC
Agence de l'eau AERMC
Fichier : PreervationGestionEtSensibilisationAutour_fichierinitiative1_plaquette-projet-gestion_site.pdf
Télécharger
Fichier : PreervationGestionEtSensibilisationAutour_fichierinitiative2_plan-de-gestion-2018-2027_valdoie.pdf
Télécharger


Préserver la qualité de l'eau et la biodiversité en Pays de Bray humide (Brémontier-Merval - Seine maritime)
Nom de la structure
EPL de Seine maritime - exploitation de Brémontier-Merval
Téléphone
0232899663
Contact (courriel)
exploitation.merval@educagri.fr
Site Web
http://www.lyceedupaysdebray.fr/lycee/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=59
Code postal
76220
Ville
Brémontier-Merval
Département
Seine-Maritime
Type d'initiative
- milieu naturel
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
Au printemps 2012, l'exploitation s'est engagée dans une nouvelle Mesure Agro-Environnementale Territorialisée sur le périmètre du Site Natura 2000 du Pays de Bray humide.
Au printemps 2012, l'exploitation s'est engagée dans une nouvelle Mesure Agro-Environnementale Territorialisée sur le périmètre du Site Natura 2000 du Pays de Bray humide.
Objectif
- préserver la qualité de l'eau
- préserver la biodiversité du site Natura 2000, qui abrite des habitats naturels rares ainsi qu'une importante population de Tritons crêtés (batracien protégé). La présence de mares et d'un important maillage de haies offre des conditions de vie favorables à l'espèce.
Description de l'action
Préalablement à l'engagement, un diagnostic initial a été réalisé avec la Chambre d'Agriculture de Seine Maritime, et a débouché sur un plan de gestion qui précise les modalités d'entretien et de réhabilitation des infrastructures agroécologiques.
Quatre infrastructures agroécologiques présentes sur l'exploitation sont concernées par cette MAET :
Quatre infrastructures agroécologiques présentes sur l'exploitation sont concernées par cette MAET :
- les mares : 5 mares ont été engagées, sur lesquelles nous nous engageons à établir un plan de gestion (curage adapté, entretien de la végétation aquatique et des berges)
- les haies : un linéaire de 600m est concerné par la mesure, sur lequel un plan de gestion précise le nombre de tailles à effectuer, leur périodicité, les essences locales à réimplanter
- les arbres et alignements d'arbres : 57 arbres figurant sur la liste des espèces éligibles ont été répertoriés. Il s'agira de définir le type de taille à réaliser et sa mise en oeuvre. Les rémanents seront valorisés ou maintenus sur place en tas
- les prairies naturelles : la mesure porte sur le mode de gestion des 9,9 ha engagés : absence de désherbage chimique, limitation de la fertilisation N/P/K à 60/30/60 U/ha (pour 9 ha) et absence de fertilisation (pour 0,9 ha), limitation du chargement à 1,4 UGB/ha, mise en place d'un cahier d'enregistrement des interventions de fertilisation, mécaniques et de pâturage.
Utilisation pédagogique
La mise en oeuvre du plan de gestion constituera un support pédagogique privilégié pour les enseignants de biologie et d'agronomie et les élèves de l'établissement
La mise en oeuvre du plan de gestion constituera un support pédagogique privilégié pour les enseignants de biologie et d'agronomie et les élèves de l'établissement
Calendrier
2012-2014
2012-2014
Perspective
Nous avons comme objectif de renouveler l'engagement au delà de cette période. Le plus gros du travail consitera à évaluer la dynamique des mares présentes sur l'exploitation et engagées dans la mesure. Par ailleurs, nous venons d'acquérir 9 ha de foncier en zone NATURA 2000, sur lesquels trois autres mares sont à réhabiliter...
Nous avons comme objectif de renouveler l'engagement au delà de cette période. Le plus gros du travail consitera à évaluer la dynamique des mares présentes sur l'exploitation et engagées dans la mesure. Par ailleurs, nous venons d'acquérir 9 ha de foncier en zone NATURA 2000, sur lesquels trois autres mares sont à réhabiliter...
Partenariats techniques/financiers
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Produire autrement : vers l'excellence en production florale sous serre (Castelnau le Lez - Hérault)
Nom de la structure
EPL Castelnau le Lez
Téléphone
04 99 58 36 58
Contact (courriel)
francesco.picasso@educagri.fr
Code postal
34170
Ville
Castelnau le Lez
Département
Hérault
Type d'initiative
- économie d'eau
- traitement des effluents
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
Les serres horticoles de La Frondaie du lycée Honoré de Balzac, rénovées en 2014, constituent un outil très performant sur les plans technique et pédagogique.
Les équipements, ainsi que l'engagement des personnels d'exploitation et d'enseignement, permettent de répondre efficacement aux exigences de la transition agroécologique pour produire autrement et apprendre à produire autrement.
L'exploitation a notamment été pionnière dans la protection biologique intégrée (depuis 2005), certifiée ISO 14001 dans le cadre du groupe « Terre de Languedoc » (depuis 2012), ...
Les équipements, ainsi que l'engagement des personnels d'exploitation et d'enseignement, permettent de répondre efficacement aux exigences de la transition agroécologique pour produire autrement et apprendre à produire autrement.
L'exploitation a notamment été pionnière dans la protection biologique intégrée (depuis 2005), certifiée ISO 14001 dans le cadre du groupe « Terre de Languedoc » (depuis 2012), ...
Objectif
- répondre aux objectifs de la certification « agriculture raisonnée » et de l'axe « horticulture durable » du projet d'exploitation
- articuler produire autrement et enseigner à produire autrement au sein de l'établissement (placer l'exploitation au coeur de la pédagogie, axe fort du Plan local Enseigner à produire autrement)
- articuler produire autrement et enseigner à produire autrement au sein de l'établissement (placer l'exploitation au coeur de la pédagogie, axe fort du Plan local Enseigner à produire autrement)
Description de l'action
. double vitrage à gaz rare isolant avec ruptures de pont thermique
. raccordement à la chaufferie à bois (énergie renouvelable), apports chauffage par réseau basse température sous les tablettes (eau entre 20 et 35 °C)
. rafraichissement de l'atmosphère par cooling-système (extraction de l'air chaud intérieur et passage de l'air extérieur au travers d'un matelas poreux humidifié)
. récupération de l'eau de pluie
. arrosage par sub-irrigation
. recyclage des solutions nutritives d’irrigation
. utilisation d'engrais chimique à libération lente, et d'engrais organique bio (granulés) pour les chrysanthèmes et les suspensions
. gestion des équipements techniques par un ordinateur relié à une station météo et à internet
. accès aux paramètres de régulation sur appareils mobiles grâce à une borne wifi installée dans les serres
. lutte prophylactique : maintien des serres propres, densité correcte, bassinage contre les acariens, arrosage goutte à goutte, pratiques culturales raisonnées, sélection de variétés plutôt résistantes,...
. lutte éthologique : observations, piégeage par pièges englués chromatiques, pièges à phéromones sexuelles (confusion)
. lutte biologique par auxiliaires (prédateurs, parasites, pathogènes)
. lutte chimique : produits de traitements homologués bio (pyrèthre) ou autres substances actives compatibles avec les lâchers d'auxiliaires mais avec parcimonie (car n'épargne pas ces derniers) , sel de Potassium anti-fongique. Planning des besoins en auxiliaires réalisé annuellement en décembre
. récupération et traitement des bidons de produits phytosanitaires par l'ADEME et par l'entreprise spécialisée Chimirec
. compostage des déchets végétaux
. désinfection annuelle des tablettes par nettoyeur haute pression (suppression des produits chimiques)
. évaluation et plan d'action annuel, dans le cadre de la certification ISO 14001
- Intrants (économies eau, énergies, engrais,...) :
. double vitrage à gaz rare isolant avec ruptures de pont thermique
. raccordement à la chaufferie à bois (énergie renouvelable), apports chauffage par réseau basse température sous les tablettes (eau entre 20 et 35 °C)
. rafraichissement de l'atmosphère par cooling-système (extraction de l'air chaud intérieur et passage de l'air extérieur au travers d'un matelas poreux humidifié)
. récupération de l'eau de pluie
. arrosage par sub-irrigation
. recyclage des solutions nutritives d’irrigation
. utilisation d'engrais chimique à libération lente, et d'engrais organique bio (granulés) pour les chrysanthèmes et les suspensions
. gestion des équipements techniques par un ordinateur relié à une station météo et à internet
. accès aux paramètres de régulation sur appareils mobiles grâce à une borne wifi installée dans les serres
- Protection contre les ravageurs (protection biologique intégrée) :
. lutte prophylactique : maintien des serres propres, densité correcte, bassinage contre les acariens, arrosage goutte à goutte, pratiques culturales raisonnées, sélection de variétés plutôt résistantes,...
. lutte éthologique : observations, piégeage par pièges englués chromatiques, pièges à phéromones sexuelles (confusion)
. lutte biologique par auxiliaires (prédateurs, parasites, pathogènes)
. lutte chimique : produits de traitements homologués bio (pyrèthre) ou autres substances actives compatibles avec les lâchers d'auxiliaires mais avec parcimonie (car n'épargne pas ces derniers) , sel de Potassium anti-fongique. Planning des besoins en auxiliaires réalisé annuellement en décembre
- Management environnemental :
. récupération et traitement des bidons de produits phytosanitaires par l'ADEME et par l'entreprise spécialisée Chimirec
. compostage des déchets végétaux
. désinfection annuelle des tablettes par nettoyeur haute pression (suppression des produits chimiques)
. évaluation et plan d'action annuel, dans le cadre de la certification ISO 14001
Résultats
Le système de production des serres de La Frondaie permet d'éviter l’utilisation de produits dommageables à l'environnement et à la santé humaine et donne des produits de haute qualité, labellisés Fleurs de France vendus majoritairement sur place auprès des particuliers (90 % des ventes) ou des collectivités de proximité.
Utilisation pédagogique
- tous les apprenants de la filière horticulture (production et conseil-vente) travaillent en situation professionnelle sur place (TP) et individuellement au moins une semaine par an (mini-stage)
- sensibilisation des autres filières dans le cadre de l'éducation au développement durable
- lien aux écoresponsables de l'établissement (PLEPA)
- sensibilisation des autres filières dans le cadre de l'éducation au développement durable
- lien aux écoresponsables de l'établissement (PLEPA)
Autre valorisation
- journées portes ouvertes
- visites de groupes (scolaires ou autres)
- clientèle (vente directe)
- lien avec la profession
- action inter-filières "La soupe d'Honoré" : les légumes cultivés dans la serre maraîchère pédagogique attenante à la serre de production florale, complétés si besoin par l'achat de légumes bio en circuit court, servent à l’élaboration par les élèves du lycée de « la Soupe d'Honoré » (filière labo), qui assurent également la sécurité sanitaire du produit transformé. Cette soupe est vendue lors du « Marché d'Honoré » aux parents d'élèves, aux personnels, aux enseignants et aux visiteurs, une journée par an à l'occasion d'un marché de producteurs locaux
- lien articles site adt.educagri.fr (2017)
- visites de groupes (scolaires ou autres)
- clientèle (vente directe)
- lien avec la profession
- action inter-filières "La soupe d'Honoré" : les légumes cultivés dans la serre maraîchère pédagogique attenante à la serre de production florale, complétés si besoin par l'achat de légumes bio en circuit court, servent à l’élaboration par les élèves du lycée de « la Soupe d'Honoré » (filière labo), qui assurent également la sécurité sanitaire du produit transformé. Cette soupe est vendue lors du « Marché d'Honoré » aux parents d'élèves, aux personnels, aux enseignants et aux visiteurs, une journée par an à l'occasion d'un marché de producteurs locaux
- lien articles site adt.educagri.fr (2017)
- (2022) à venir
Perspective
- remplacer le support de culture tourbe par une ressource plus durable (fibre broyée de coco ou autre)
- labellisation Plante bleue
- développer les liens à la R&D concernant la lutte biologique intégrée
- s'adapter aux nouvelles conditions liées aux changements climatiques (besoin de rafraîchissement l'été, affranchissement du chauffage l'hiver, ...)
- labellisation Plante bleue
- développer les liens à la R&D concernant la lutte biologique intégrée
- s'adapter aux nouvelles conditions liées aux changements climatiques (besoin de rafraîchissement l'été, affranchissement du chauffage l'hiver, ...)
Partenariats techniques/financiers
Conseil régional Occitanie, Institut Agro Montpellier, société Koppert, CER France, association terr’avenir, filière professionnelle locale,...
Fichier : fichierinitiative1_PBI_CastelnauleLez.pdf
Télécharger

Lien vers vidéo de présentation (1)
https://www.dailymotion.com/video/x8eo8hn
Lien vers vidéo de présentation(2)
http://www.dailymotion.com/video/x5iuqlp
Vidéo de présentation (1)
Vidéo de présentation (2)
Projets hydrotechniques GEMEAU sur le site de l'exploitation (Courcelles-Chaussy - Moselle)
Nom de la structure
EPLEFPA Metz-Courcelles-Chaussy
Téléphone
03 87 64 00 17
Contact (courriel)
colette.kieffer@educagri.fr
Contact2 (courriel)
alexandre.toussaint@educagri.fr
Site Web
http://www.eplea.metz.educagri.fr/
Code postal
57530
Ville
Courcelles-Chaussy
Département
Moselle
Type d'initiative
- traitement des effluents
- milieu naturel
- qualité de l'eau
Contexte
Le module M54 "Projets d'équipements hydrotechniques" de la formation BTSA Gestion et maitrise de l'eau (GEMEAU) vise à faire réaliser par des groupes de trois étudiants maximum un projet d’équipement d’un système hydrotechnique, défini par un cahier des charges, en analysant ses tenants et aboutissants, dans au moins un des champs professionnels de la formation : hydraulique agricole, hydraulique urbaine et rurale, aménagements localisés d'écosystèmes d'eau douce. L'équipe pédagogique propose à chaque promotion des sujets en lien avec les problématiques rencontrées dans l'enceinte de l'établissement : site de l'exploitation (180 ha de SAU) ou espaces non agricoles. Ces projets sont généralement suivis d'une mise en œuvre opérationnelle par les promotions suivantes, dans le cadre pédagogique également...
Exemples de projets travaillés : étude des réseaux d'eaux usées et pluviales, test de l'efficacité de plantes épuratrices sur les produits phytosanitaires dans les eaux de drainage, optimisation de la consommation en eau du maraichage biologique, sécurisation de l'alimentation en eau de la mare, traitement des effluents de l'atelier bovins lait, restauration du ruisseau de la Goulotte,...Zoom sur ces deux derniers projets
Le module M54 "Projets d'équipements hydrotechniques" de la formation BTSA Gestion et maitrise de l'eau (GEMEAU) vise à faire réaliser par des groupes de trois étudiants maximum un projet d’équipement d’un système hydrotechnique, défini par un cahier des charges, en analysant ses tenants et aboutissants, dans au moins un des champs professionnels de la formation : hydraulique agricole, hydraulique urbaine et rurale, aménagements localisés d'écosystèmes d'eau douce. L'équipe pédagogique propose à chaque promotion des sujets en lien avec les problématiques rencontrées dans l'enceinte de l'établissement : site de l'exploitation (180 ha de SAU) ou espaces non agricoles. Ces projets sont généralement suivis d'une mise en œuvre opérationnelle par les promotions suivantes, dans le cadre pédagogique également...
Exemples de projets travaillés : étude des réseaux d'eaux usées et pluviales, test de l'efficacité de plantes épuratrices sur les produits phytosanitaires dans les eaux de drainage, optimisation de la consommation en eau du maraichage biologique, sécurisation de l'alimentation en eau de la mare, traitement des effluents de l'atelier bovins lait, restauration du ruisseau de la Goulotte,...Zoom sur ces deux derniers projets
Objectif
- Recueillir des données nécessaires à l’élaboration d’un projet
- S’approprier les contraintes techniques d’un cahier des charges préétabli
- Elaborer des solutions techniques respectant le cahier des charges préétabli
- Analyser la faisabilité des solutions techniques dans une perspective de durabilité
- Réaliser l’étude technique de la solution retenue
- Participer à la gestion d’un projet technique
- Soutenir un argumentaire technique
- Recueillir des données nécessaires à l’élaboration d’un projet
- S’approprier les contraintes techniques d’un cahier des charges préétabli
- Elaborer des solutions techniques respectant le cahier des charges préétabli
- Analyser la faisabilité des solutions techniques dans une perspective de durabilité
- Réaliser l’étude technique de la solution retenue
- Participer à la gestion d’un projet technique
- Soutenir un argumentaire technique
Description de l'action
1/ traitement des effluents de l'atelier bovins lait (promotion 2012-2014) :
Les effluents de la salle de traite (eaux brunes - eaux pluviales souillées par les déjections sur les aires découvertes -, eaux vertes - nettoyage des quais de la salle de traite - et eaux blanches - nettoyage des canalisations de la salle de traite et du tank à lait) étaient rejetés dans la fosse à lisier, à raison de 3,5 m3/jour. Pour une mise aux normes et une meilleure efficience de la valorisation agronomique du lisier, il s'agissait de proposer une solution de traitement séparé de ces effluents.
- choix de la solution parmi celles étudiées par la promotion précédente : filtre planté de roseau (FPR) avec cuve-tampon en pré-fosse
- analyses de la qualité de l'effluent pour dimensionner les ouvrages (DBO5, DCO, MES, résidus secs)
- choix du site d'implantation par étude de perméabilité
- étude technique et dimensionnement des ouvrages : 7,2 m3 pour pré-fosse, 20 m2 pour FPR en gravitaire, infiltration par percolation sur culture de phragmites fixés
- évaluation des travaux d'entretien
- chiffrage des coûts matériel et main d’œuvre (possibilité de valoriser le coût main d’œuvre en auto-construction, par les apprenants GEMEAU, bacs pro agro-équipements et aménagements paysagers dans le cadre pédagogique)
2/ restauration du ruisseau de la Goulotte (promotion 2014-2016) :
Le ruisseau de la Goulotte draine un bassin-versant au niveau de l'exploitation du lycée d'environ 15ha. En parallèle d'études d'impact des pratiques agricoles sur la qualité des eaux de drainage et de tests d'efficacité de plantes épuratrices en vue d'implantation de zones tampons humide artificielle (ZTHA), le projet consiste à mettre en place, sur une trentaine de mètres linéaires, une zone de démonstration d'aménagement de berges, ici très dégradées (érosion, embâcles, mauvais écoulement, affaissement de berges, sédimentation, ripisylve envahissante)
- suppression des embâcles
- choix de la zone d'aménagement
- contacts avec professionnels et demande de devis
- choix des techniques (peignes, épis, tunages en bois, banquettes d'hélophytes)
- réalisation d'aménagements
1/ traitement des effluents de l'atelier bovins lait (promotion 2012-2014) :
Les effluents de la salle de traite (eaux brunes - eaux pluviales souillées par les déjections sur les aires découvertes -, eaux vertes - nettoyage des quais de la salle de traite - et eaux blanches - nettoyage des canalisations de la salle de traite et du tank à lait) étaient rejetés dans la fosse à lisier, à raison de 3,5 m3/jour. Pour une mise aux normes et une meilleure efficience de la valorisation agronomique du lisier, il s'agissait de proposer une solution de traitement séparé de ces effluents.
- choix de la solution parmi celles étudiées par la promotion précédente : filtre planté de roseau (FPR) avec cuve-tampon en pré-fosse
- analyses de la qualité de l'effluent pour dimensionner les ouvrages (DBO5, DCO, MES, résidus secs)
- choix du site d'implantation par étude de perméabilité
- étude technique et dimensionnement des ouvrages : 7,2 m3 pour pré-fosse, 20 m2 pour FPR en gravitaire, infiltration par percolation sur culture de phragmites fixés
- évaluation des travaux d'entretien
- chiffrage des coûts matériel et main d’œuvre (possibilité de valoriser le coût main d’œuvre en auto-construction, par les apprenants GEMEAU, bacs pro agro-équipements et aménagements paysagers dans le cadre pédagogique)
2/ restauration du ruisseau de la Goulotte (promotion 2014-2016) :
Le ruisseau de la Goulotte draine un bassin-versant au niveau de l'exploitation du lycée d'environ 15ha. En parallèle d'études d'impact des pratiques agricoles sur la qualité des eaux de drainage et de tests d'efficacité de plantes épuratrices en vue d'implantation de zones tampons humide artificielle (ZTHA), le projet consiste à mettre en place, sur une trentaine de mètres linéaires, une zone de démonstration d'aménagement de berges, ici très dégradées (érosion, embâcles, mauvais écoulement, affaissement de berges, sédimentation, ripisylve envahissante)
- suppression des embâcles
- choix de la zone d'aménagement
- contacts avec professionnels et demande de devis
- choix des techniques (peignes, épis, tunages en bois, banquettes d'hélophytes)
- réalisation d'aménagements
Résultats
1/ traitement des effluents de l'atelier bovins lait :
Soumission du dossier auprès des partenaires
2/ restauration du ruisseau de la Goulotte :
- diminution de la largeur du lit, augmentation de la profondeur et de la vitesse d'écoulement
- parcours plus sinueux (re-naturation)
- sédimentation localisée au niveau du peigne et des épis
1/ traitement des effluents de l'atelier bovins lait :
Soumission du dossier auprès des partenaires
2/ restauration du ruisseau de la Goulotte :
- diminution de la largeur du lit, augmentation de la profondeur et de la vitesse d'écoulement
- parcours plus sinueux (re-naturation)
- sédimentation localisée au niveau du peigne et des épis
Utilisation pédagogique
L'utilisation pédagogique est intinsèque à la formation. De plus, les liens sont faits avec les autres filières de formation de l'établissement (secteurs aménagement, production et agro-équipement) au niveau des chantiers opérationnels qui s'ensuivent, ainsi qu'au niveau du suivi et de la maintenance des ouvrages et aménagements.
L'utilisation pédagogique est intinsèque à la formation. De plus, les liens sont faits avec les autres filières de formation de l'établissement (secteurs aménagement, production et agro-équipement) au niveau des chantiers opérationnels qui s'ensuivent, ainsi qu'au niveau du suivi et de la maintenance des ouvrages et aménagements.
Autre valorisation
Communication générale de l'établissement
Communication générale de l'établissement
Perspective
1/ traitement des effluents de l'atelier bovins lait :
validation et financement du projet par les partenaires, mise en place d'une bande enherbée avant restitution au milieu naturel (cours d'eau la Nied française)
2/ restauration du ruisseau de la Goulotte :
réalisation de panneaux informatifs, poursuite de l'aménagement sur le reste du lit du ruisseau, aménagements de ZTHA en bordure des parcelles agricoles...
1/ traitement des effluents de l'atelier bovins lait :
validation et financement du projet par les partenaires, mise en place d'une bande enherbée avant restitution au milieu naturel (cours d'eau la Nied française)
2/ restauration du ruisseau de la Goulotte :
réalisation de panneaux informatifs, poursuite de l'aménagement sur le reste du lit du ruisseau, aménagements de ZTHA en bordure des parcelles agricoles...
Partenariats techniques/financiers
- Agence de l'eau Rhin-Meuse
- entreprises locales en aménagement, foresterie, bureaux d'études et équipementiers eau et assainissement
- laboratoires d'analyses
- Agence de l'eau Rhin-Meuse
- entreprises locales en aménagement, foresterie, bureaux d'études et équipementiers eau et assainissement
- laboratoires d'analyses
Fichier : fichierinitiative1_projet_effluents_atelier_lait.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative2_amenagement_berges.pdf
Télécharger
Quatre dispositifs pour protéger la ressource en eau sur l'exploitation horticole : bassin de recyclage, saulaie phytoépuratrice, biobac et phytocat (Angers - Maine et Loire)
Nom de la structure
EPLEFPA Angers le Fresne
Téléphone
02 41 68 60 00
Contact (courriel)
Eric.Duclaud@educagri.fr
Code postal
49 0000
Ville
Angers
Département
Maine-et-Loire
Type d'initiative
- traitement des effluents
- milieu naturel
- qualité de l'eau
Contexte
L'exploitation horticole est un outil pédagogique central pour l'EPL d'Angers le Fresne. Située à proximité immédiate des prairies fragiles et protégées des Basses Vallées Angevines (site Ramsar, Natura 2000, patrimoine mondial de l'humanité, etc.) et implantée au coeur d'un territoire marqué sur le plan environnemental par une forte pression horticole, l'exploitation se devait d'agir dans le sens d'une gestion durable de l'eau. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de l'établissement de montrer l'exemple, à la fois vis-à-vis des apprenants, des professionnels et du grand public.
Description de l'action
L'exploitation pédagogique de l'EPL d'Angers le Fresne est dotée d'une pépinière hors sol de deux hectares, irriguée par aspersion. Chaque année 15000 mètres cubes d'eaux chargées en engrais et pesticides ruissellent depuis cette production et viennent contaminer le milieu. Pour palier ce problème, l'exploitation a investi en 2008 dans quatre dispositifs destinés à protéger la ressource en eau, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. Ainsi, un bassin de recyclage de l'eau de 4000 m3 permet de récupérer les eaux de ruissellement de la pépinière puis de les réutiliser en irrigation. Une saulaie de 5000 m2 quant à elle récupère les eaux du trop plein du bassin qu'elle « phytoépure », notamment grace au rôle de pompe à nitrates joué par les saules. Par ailleurs les effluents phytosanitaires de l'exploitation sont traités soit dans un Biobac (lit bactérien sur mélange terre paille), soit dans un Phytocat (oxydation poussée des molécules de phytosanitaires sous l'action des Ultra-Violets).
Résultats
- Bassin de recyclage : une économie annuelle de l'ordre de 50% est attendue, soit chaque année 15000 m3 d'eau économisés, à la fois au plan quantitatif et financier. Une autonomie de 8-10 jours l'été en cas de restriction de pompage dans la Loire (sécheresse)
- Saulaie phytoépuratrice : la saulaie du Fresne est un dispositif totalement expérimental qui s'inspire de la technique des Taillis a Très Courte Rotation développée depuis une vingtaine d'années par les Suédois. Au cours de l'année 2008-2009, des échantillons d'eau ont été régulièrement prélevés dans la saulaie (boîtes enterrées) puis stockés (congélation) au GIRPA (laboratoire d'analyses de produits agro-pharmaceutiques). Les analyses ont faites en une seule fois au printemps 2009. Elles portent sur les concentrations en nitrates, glyphosates, et multi-résidus et permettent de comparer ces taux entre l'amont et l'aval de la pépinière (efficacité de la phytoépuration).
- Biobac : dans des conditions optimales, l'efficacité du Biobac s'élève à 90-99%. Cependant, cela dépend en grande partie de la bonne régulation du taux d'humidité du mélange terre paille et donc de l'espacement des apports afin d'éviter l'ennoiement du dispositif. Le tassement du mélange peut également diminuer l'efficacité du Biobac : il convient donc de le retourner régulièrement.
- Phytocat : l'efficacité du Phytocat est de 99%. Cette efficacité est assurée à condition de bien entretenir la machine et de respecter les consignes d'utilisation (changement des médias filtrants après chaque cycle, etc.).
Utilisation pédagogique
Tous les dispositifs ont des implications pédagogiques en tant qu'outils de démonstration ou qu'exercices pratiques (études de cas). La saulaie par exemple a mobilisé plusieurs classes :
- BTS Aménagement du Paysage : conception (CCF), land-art (CCF), réalisation du plan de plantation
- BEPA et Bacs Professionnels Travaux Paysagers : chantier de plantation, construction des marches d'accès au belvédère, empierrement du belvédère
- Classes préparatoires BCPST dans le cadre des TIPE (Travaux d'Initiative Personnelle Encadrés) : expérimentation en conditions contrôlées sur des boutures de saules
- Premières STAV dans le cadre des stages « territoire »
- 2004 : Régis Chevallier, stage de Maîtrise des Sciences et Techniques « Gestion de l'environnement » (Université Angers) (sujet : étude de l'opportunité d'aménager une saulaie phytoépuratrice ou un bassin de recyclage sur la pépinière hors sol d'Angers le Fresne)
- 2008 : Julie Savary, stage de Master 1 Ecologie Environnement (Université Angers) (sujet : caractérisation écologique de la saulaie, étude de la biodiversité sur les amphibiens et calcul d'IBGN (Indice Biologique Global Normalisé)
- 2009 : Pauline Girard, stage de DUT Chimie (IUT Le Mans) (sujet : dosage des nitrates, glyphosates et multirésidus sur les échantillons de la saulaie)
Autre valorisation
- L'exploitation valorise sa démarche auprès de la profession horticole à travers de nombreuses visites sur site (visites par le Bureau Horticole Régional ; dans le cadre du SIVAL 2009)
- Sur la saulaie, un volet land-art est développé avec la construction de deux oeufs monumentaux sur site (un oeuf en schiste de 4 mètres de haut et un oeuf en ceps de vigne de 8 mètres de haut)
- La saulaie est ouverte au public avec un accès depuis le chemin des Communs très fréquenté par les promeneurs le week-end. Un sentier de découverte est aménagé à travers la saulaie avec un panneautage et un accès au belvédère où est installée une table de lecture du paysage. Cette ouverture doit améliorer les ventes de la jardinerie école (ouverte le samedi).
- Valorisation paysagère (travail sur le bois de saule : couleurs, plessage, tressage)
- Vannerie
- Entretien par une association de réinsertion, chômeurs de longue durée
Calendrier
- Avril 2007 : réfection du réseau de récupération des eaux de ruissellement de la pépinière (fossés et buses).
- Juillet 2007 : terrassement de la saulaie (creusement des noues d'irrigation, mise en place de barrages en grès à l'intersection des noues)
- Décembre 2007 : pose de 2 piézomètres et de 4 boîtes enterrées de prélèvement de l'eau dans la saulaie
- Mars 2008 : acquisition du Phytocat
- Avril 2008 : chantier de plantation de la saulaie
- 2 débroussaillages en juin et septembre 2008
- Juin 2008 : installation du puisard de récupération des eaux de ruissellement en aval de la pépinière et installation d'une pompe de 15m3/h pour envoyer cette eau dans le bassin de 4000 m3 situé en amont de la pépinière. Creusement du bassin, pose d'un géotextile sur les bords, et installation du local de pompage (pompe de 35m3/h et 63 filtres à sable)
- Septembre 2008 : construction du Biobac (décanteur-déshuileur, pompe de relevage, bac de mélange terre paille) et de l'aire de lavage
- 2008-2009 : conception et réalisation de deux oeufs monumentaux : un oeuf en schiste de 4 mètres de haut et un oeuf en souches de vignes de 8 mètres de haut (art nature)
- 2009-2010 : accueil public : aménagement du sentier de visite (dont passerelles pour franchir les noues), conception et réalisation de la signalétique, dont une table de lecture du paysage (belvédère)
- 2007-2010 : suivi scientifique du dispositif, à travers des analyses régulières de l'eau entre l'amont et l'aval de la saulaie (nitrates, glyphosate et multi-résidus)
Partenariats techniques/financiers
- Cemagref de Lyon
- Laboratoire « Paysages et Biodiversité » de l'Université d'Angers
- Vannier de Bouchemaine (M. Olivier Huré)
- Agglomération d'Angers, à travers le volet artistique notamment
- Association de réinsertion (chômeurs de longue durée)
- Conseil Régional des Pays de Loire : 13 500 euros
- Stockholm Junior Water Prize : 1 000 euros
Fichier : fichierinitiative1_poster_Exploitation_Angers.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative2_poster_Saulaie_Angers.pdf
Télécharger
Lien vers vidéo de présentation (1)
http://www.dailymotion.com/video/xh4ymy_gestion-innovante-de-l-eau-en-horticulture_school
Lien vers vidéo de présentation(2)
https://www.youtube.com/watch?v=2fiejR_PHQ8
Réaménagement d'un cours d'eau dégradé : le Buffalon (Nîmes - Gard)
Nom de la structure
EPLEFPA de Nîmes-Rodilhan
Téléphone
04 66 20 67 67
Contact (courriel)
riadh.ourabah@educagri.fr
Contact2 (courriel)
patrick.fairon@educagri.fr
Site Web
http://www.epl.nimes.educagri.fr
Code postal
30230
Ville
Rodilhan
Département
Gard
Type d'initiative
- milieu naturel
- qualité de l'eau
- risques
Contexte
Le Buffalon, affluent du Vistre, est un cours d'eau fortement dégradé. Son réaménagement vise à :
Le Buffalon, affluent du Vistre, est un cours d'eau fortement dégradé. Son réaménagement vise à :
- réduire les apports en crue (réduire le ruissellement à la parcelle, ralentir la propagation des crues vers l'aval, restaurer des zones inondables pour les petites crues)
- réduire les apports en pollution diffuses et directes (amélioration des pratiques culturales, recréation de haies pour limiter le transfert de pollution, meilleure gestion des rejets ponctuels)
- retrouver un fonctionnement écologique satisfaisant
Description de l'action
- réaménagement du Buffalon : reméandrage (en utilisant le foncier disponible), revégétalisation des berges (ripisylve)
- aménagement d'une zone humide sur le Couladou, affluent du Buffalon (bassin de rétention de 5 000 m3 environ)
- mesures complémentaires au sein de l'espace agricole : implantation de 5 haies composites pour une connexion entre les haies préexistantes (couloirs écologiques), enherbement (spontané), gestion de l'irrigation (tensiomètres répartis sur les cultures), lutte contre la pollution diffuse puis conversion à l'agriculture biologique
- suivi de l'impact de la restauration sur la qualité physico-chimique et biologique de l'eau, le fonctionnement dynamique de la rivière, l'évolution des écosystèmes (biodiversité, inventaires, auxilliaires de cultures,...), le paysage, la conduite et la durabilité de l'exploitation agricole.
Résultats
- légère amélioration de la biologie de la rivière
- légère autoépuration amont-aval
- stabilité globale du cours d'eau (crues contenues jusqu'à présent)
- augmentation relative de la biodiversité
- augmentation des populations d'auxiliaires des cultures
- augmentation nette de la note de durabilité de l'exploitation (IDEA)
Utilisation pédagogique
- implication des étudiants de BTSA GEMEAU dans tous les axes du projet (choix des partenaires et des bureaux d'étude, travaux, mesures, suivi)
- création d'un sentier d'interprétation par des étudiants de BTSA Aménagement paysager
- support de formation pour des BTSA GPN : "Agriculture et biodiversité" (Bergerie nationale de Rambouillet)
Autre valorisation
- journées des portes ouvertes de l'EPLEFPA
- journée de la biodiversité, journée de l'environnement, semaine du développement durable
- dossier dans l'ouvrage "initiation aux métiers de l'aménagement, Bac STAV", Educagri éditions
- enquête nationale INRA "Etude des critères de mesure de la biodiversité"
- label "1000 défis pour ma planète", 2007
Calendrier
- 2003-2004 : travaux de réaménagement
- depuis 2005 : suivi de l'impact (prélèvements, mesures, observations photographiques) et mesures complémentaires au sein de l'espace agricole
- 2007 : sentier d'interprétation
- depuis 2010 : conversion à l'agriculture biologique sur près de 8 ha de l'exploitation (démonstration de l'impact sur la qualité des eaux de ruissellement)
Perspective
- travail d'entretien de la ripisylve (gestion du développement des saules, risque de fermeture de l'espace)
- gestion d'une plante invasive : la Jussie
Partenariats techniques/financiers
techniques :
techniques :
- Syndicat mixte du bassin versant du Vistre
- Conception : CEDRAT Développement
- Maître d'oeuvre : GREN
- Entreprises : Rodriguez, SERPE, Maniebat
- Etudes : Asconit (qualité du cours d'eau), Ecosphère (inventaires faunistiques)
- Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes
- Centre expérimental horticole de Marsillargues
- Chambre d'agriculture du Gard
- aménagements : Agence de l'Eau (40 %), Etat (33 %), Conseil Régional (10 %), Syndicat mixte départemental (4 %) : 87 %
- suivi : Agence de développement agricole et rural, Syndicat mixte du bassin versant du Vistre
Fichier : fichierinitiative1_Diaporama_buffalon.pdf
Télécharger
Reboisement en milieu humide (Meymac - Corrèze)
Nom de la structure
EPLEFPA de Haute Correze
Téléphone
06 83 69 79 10
Contact (courriel)
jean-paul.goursolas@educagri.fr
Site Web
http://www.lycees-neuvic-meymac.fr/
Code postal
19250
Ville
Meymac
Département
Corrèze
Type d'initiative
- milieu naturel
- qualité de l'eau
Contexte
La parcelle était un peuplement d'Épicéas de Sitka, coupé en 2008.
Les parcelles entourent un captage d'eau communal (captage des Ayguettes), une canalisation traverse la parcelle.
Une partie des parcelles à reboiser se trouve dans une zone humide avec un ruisseau qui la traverse (ruisseau des Ayguettes). L'arrêté interdit les travaux de déssouchage. L'utilisation de produits phytosanitaire est règlementé suivant les périmètres.
La parcelle était un peuplement d'Épicéas de Sitka, coupé en 2008.
Les parcelles entourent un captage d'eau communal (captage des Ayguettes), une canalisation traverse la parcelle.
Une partie des parcelles à reboiser se trouve dans une zone humide avec un ruisseau qui la traverse (ruisseau des Ayguettes). L'arrêté interdit les travaux de déssouchage. L'utilisation de produits phytosanitaire est règlementé suivant les périmètres.
Objectif
- planter des essences forestières adaptées
- prendre en compte la dimension touristique du site
- préserver les zones à sphaignes
- préserver la qualité de l'eau
Description de l'action
En travaux préparatoires au reboisement, nous avons choisi de faire des potets travaillés avec une mini-pelle équipée d'une dent de sous solage. Cette technique consiste à travailler la terre seulement à l'endroit où l'on plante le plant sur une profondeur maximum de 30cm. Ce travail évite de faire des andains qui en plus de détériorer la surface du sol, gêneraient l'écoulement naturel des eaux de pluie vers le ruisseau. De plus, l'utilisation d'une mini-pelle réduit considérablement le tassement du sol. En fonction de l'état du sol nous effectuons ou pas le potet, en effet, dans certains cas, un simple travail superficiel est suffisant.
Le projet de plantation est divisé en 3 parcelles (surface totale à planter de 1,96 ha). Deux d'entre elles (parcelle 1a et 2) se situent sur des zones sèches mais à proximité du captage, elles sont reboisées en Mélèze du Japon. La troisième (parcelle 1b) se situe sur une zone humide et est traversée par un ruisseau. Dans cette parcelle, nous avons délimité les zones les plus humides avec la présence de sphaignes pour la protéger et la conserver, nous n'effectuerons aucune opération dans ces zones. Le reste de cette dernière parcelle est reboisée en Frêne ou Aulne.
Un suivi de la plantation (évaluation du taux de reprise, identification de la cause de mortalité, regarni...) est prévu par les apprenants.
En travaux préparatoires au reboisement, nous avons choisi de faire des potets travaillés avec une mini-pelle équipée d'une dent de sous solage. Cette technique consiste à travailler la terre seulement à l'endroit où l'on plante le plant sur une profondeur maximum de 30cm. Ce travail évite de faire des andains qui en plus de détériorer la surface du sol, gêneraient l'écoulement naturel des eaux de pluie vers le ruisseau. De plus, l'utilisation d'une mini-pelle réduit considérablement le tassement du sol. En fonction de l'état du sol nous effectuons ou pas le potet, en effet, dans certains cas, un simple travail superficiel est suffisant.
Le projet de plantation est divisé en 3 parcelles (surface totale à planter de 1,96 ha). Deux d'entre elles (parcelle 1a et 2) se situent sur des zones sèches mais à proximité du captage, elles sont reboisées en Mélèze du Japon. La troisième (parcelle 1b) se situe sur une zone humide et est traversée par un ruisseau. Dans cette parcelle, nous avons délimité les zones les plus humides avec la présence de sphaignes pour la protéger et la conserver, nous n'effectuerons aucune opération dans ces zones. Le reste de cette dernière parcelle est reboisée en Frêne ou Aulne.
Un suivi de la plantation (évaluation du taux de reprise, identification de la cause de mortalité, regarni...) est prévu par les apprenants.
Résultats
Pas de plantation sur 5m de part et d'autre du cours d'eau.
Pas de plantation sur 2m de part et d'autre de la canalisation d'eau potable.
La plantation se compose de:
Taux de reprise:
Pas de plantation sur 5m de part et d'autre du cours d'eau.
Pas de plantation sur 2m de part et d'autre de la canalisation d'eau potable.
La plantation se compose de:
- 1500 mélèzes
- 120 aulnes
- 200 Frênes
Taux de reprise:
- pour les mélèzes : 72%
- pour les aulnes : 98%
- pour les frênes : 98%
- chevreuil, 15 individus
- hylobe, 5 individus
- plantation, 362 individus, la cause principale est l'asphyxie des racines par l'eau.
Utilisation pédagogique
Les élèves de l'établissement ont matérialisé (avec des piquets) l'endroit où les potets sont réalisés.
Les potets sont réalisés par un professionnel, une classe se déplace sur site pour observer.
La plantation est réalisée par une classe de l'établissement.
Identification de la cause de mortalité par les élèves.
Comptage et évaluation du taux de reprise.
Les élèves de l'établissement ont matérialisé (avec des piquets) l'endroit où les potets sont réalisés.
Les potets sont réalisés par un professionnel, une classe se déplace sur site pour observer.
La plantation est réalisée par une classe de l'établissement.
Identification de la cause de mortalité par les élèves.
Comptage et évaluation du taux de reprise.
Autre valorisation
Une demande d'aide financière a été déposée par le propriétaire auprès du PNR de Millevaches.
Le site est facilement accessible, il pourra servir de démonstration et de support d'étude.
Une demande d'aide financière a été déposée par le propriétaire auprès du PNR de Millevaches.
Le site est facilement accessible, il pourra servir de démonstration et de support d'étude.
Calendrier
- automne 2011 : réalisation des potets
- printemps 2012 : plantation
- octobre 2012 : évaluation des taux de reprise, identification des causes de mortalité.
Perspective
Suivi de la flore et de la faune, réaction du milieu.
Démonstration de plantation en zone humide.
Suivi de la flore et de la faune, réaction du milieu.
Démonstration de plantation en zone humide.
Partenariats techniques/financiers
- EPLEFPA de Haute Corrèze - Atelier technologique
- PNR de Millevaches
Fichier : fichierinitiative1_carte_reboisement_meymac.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative2_plantation.jpg
Télécharger
Fichier : fichierinitiative3_alnus.JPG
Télécharger
Récupération des eaux de pluie et subirrigation en production sous serre (Fayl-Billot - Haute Marne)
Nom de la structure
EPLEFPA de Fayl-Billot
Téléphone
03 25 88 28 27
Contact (courriel)
Bruno.LOUISY@educagri.fr
Code postal
52500
Ville
Fayl-Billot
Département
Haute-Marne
Type d'initiative
- économie d'eau
Contexte
La subirrigation fait circuler une solution nutritive en circuit fermé dans les tablettes de cultures en pots afin d'alimenter les plantes par capillarité. Ce système permet de recycler la solution nutritive et de limiter la consommation en eau pour la production horticole.
La subirrigation fait circuler une solution nutritive en circuit fermé dans les tablettes de cultures en pots afin d'alimenter les plantes par capillarité. Ce système permet de recycler la solution nutritive et de limiter la consommation en eau pour la production horticole.
Description de l'action
Investissement en matériel de subirrigation (matériel informatique, tablettes, tuyaux, gros oeuvre...), de récupération d'eau de pluie et de suivi de la qualité de l'eau.
Investissement en matériel de subirrigation (matériel informatique, tablettes, tuyaux, gros oeuvre...), de récupération d'eau de pluie et de suivi de la qualité de l'eau.
Résultats
- 1 m² de serre en subirrigation consomme environ 1mètre cube d'eau et 1 kg d'engrais par an
- suppression de l'arrosage manuel fastidieux qui représente une charge de travail conséquente en production sous serre
- nécessité de maîtriser le logiciel informatique avec une maintenance spécialisée
- meilleure qualité des plantes obtenues grâce à un arrosage par la racine qui limite le risque de taches sur les feuilles.
Utilisation pédagogique
Les apprenants ont participé à la mise en place de l'action de démonstration et à son suivi.
Les apprenants ont participé à la mise en place de l'action de démonstration et à son suivi.
Autre valorisation
L'action a été présentée dans le cadre des journées portes ouvertes.
L'action a été présentée dans le cadre des journées portes ouvertes.
Calendrier
2005-2007 (action terminée)
2005-2007 (action terminée)
Partenariats techniques/financiers
Action intégrée dans le cadre du réseau des exploitations des EPLEFPA de Champagne-Ardenne
Action intégrée dans le cadre du réseau des exploitations des EPLEFPA de Champagne-Ardenne
- Agence de l'Eau Seine-Normandie
- Conseil Régional de Champagne-Ardenne
Fichier : fichierinitiative1_poster-FaylBillot_pluie+subirrigd_poster.pdf
Télécharger
Récupération des eaux de pluie sur l'exploitation agricole (Dax - Landes)
Nom de la structure
EPL des Landes - LEGTA de Dax - Oeyreluy
Téléphone
05.58.98.70.33
Contact (courriel)
Laurent.LESCOULIE@educagri.fr
Contact2 (courriel)
Jean-Marc.RIHOUX@educagri.fr
Site Web
http://www.formagri40.fr
Code postal
40180
Ville
HEUGAS
Département
Landes
Type d'initiative
- économie d'eau
Contexte
L'eau constitue dans le département des Landes une richesse essentielle a la vie économique de la région. Son utilisation en fonction de sa qualité (douce, salée, chaude) est de ce fait très diversifiée :
- Production d'eau potable : principalement assurée par des forages captant des aquifères profonds.
- Production d'eau embouteillée (Dax, Sore)
- Thermalisme : 1er département thermal français avec 5 stations thermales (Dax, St Paul les Dax, Saubusse, Préchacq, Eugénie les Bains). Le sous-sol landais est riche en eaux chaudes souterraines reconnues pour leurs vertus thérapeutiques.
- Géothermie
- Tourisme : la présence d'eaux chaudes et d'eaux salées permet le développement d'activités ludiques et touristiques (centres de remise en forme, piscines...).
- Industrie : activités nécessitant une eau de bonne qualité.
- Agriculture : irrigation des cultures. Le département des Landes est le premier producteur national de mais.
La gestion de la ressource en eau représente donc un enjeu fort pour le département des Landes.
Le lycée agricole de Dax dispose d'une exploitation grandeur nature, représentative des exploitations de polyculture élevage de la Chalosse.
Les bâtiments agricoles de l'exploitation représentent une grande surface de toiture dans une région où la pluviométrie atteint 1200 mm/an.
Le troupeau en place est constitué de près de 90 bovins de race blondes d'Aquitaine. Ces animaux sont abreuvés quasi exclusivement a partir de l'eau du réseau. Les engins de l'exploitation sont aussi lavés à l'eau du réseau.
L'eau constitue dans le département des Landes une richesse essentielle a la vie économique de la région. Son utilisation en fonction de sa qualité (douce, salée, chaude) est de ce fait très diversifiée :
- Production d'eau potable : principalement assurée par des forages captant des aquifères profonds.
- Production d'eau embouteillée (Dax, Sore)
- Thermalisme : 1er département thermal français avec 5 stations thermales (Dax, St Paul les Dax, Saubusse, Préchacq, Eugénie les Bains). Le sous-sol landais est riche en eaux chaudes souterraines reconnues pour leurs vertus thérapeutiques.
- Géothermie
- Tourisme : la présence d'eaux chaudes et d'eaux salées permet le développement d'activités ludiques et touristiques (centres de remise en forme, piscines...).
- Industrie : activités nécessitant une eau de bonne qualité.
- Agriculture : irrigation des cultures. Le département des Landes est le premier producteur national de mais.
La gestion de la ressource en eau représente donc un enjeu fort pour le département des Landes.
Le lycée agricole de Dax dispose d'une exploitation grandeur nature, représentative des exploitations de polyculture élevage de la Chalosse.
Les bâtiments agricoles de l'exploitation représentent une grande surface de toiture dans une région où la pluviométrie atteint 1200 mm/an.
Le troupeau en place est constitué de près de 90 bovins de race blondes d'Aquitaine. Ces animaux sont abreuvés quasi exclusivement a partir de l'eau du réseau. Les engins de l'exploitation sont aussi lavés à l'eau du réseau.
Objectif
Le but est la réutilisation des eaux pluviales et la réalisation des économies substantielles d'eau potable. Ce projet se veut avant tout pilote pour les professionnels et pédagogiques pour les apprenants de l'établissement.
Le but est la réutilisation des eaux pluviales et la réalisation des économies substantielles d'eau potable. Ce projet se veut avant tout pilote pour les professionnels et pédagogiques pour les apprenants de l'établissement.
Utilisation pédagogique
Ce projet sera effectué par des étudiants de licence professionnelle Aménagement et Gestion des Ressources en Eau et étudié par des étudiants de BTSA GEMEAU du LEGTA H. Serres.
Ce projet sera effectué par des étudiants de licence professionnelle Aménagement et Gestion des Ressources en Eau et étudié par des étudiants de BTSA GEMEAU du LEGTA H. Serres.
Autre valorisation
Présentation en réunion CUMA locale.
Le procédé sera étendu au niveau du lycée tout entier à terme.
Présentation en réunion CUMA locale.
Le procédé sera étendu au niveau du lycée tout entier à terme.
Calendrier
Le projet sera mené pendant l'année scolaire 2008-2009 (réalisation de l'étude technico économique : janvier a avril 2009) puis réalisé l'année suivante, si l'intérêt écologique et la faisabilité économique sont prouvés. Un suivi des économies d'eau sera ensuite effectué afin d'étudier la rentabilité du procédé.
Le projet sera mené pendant l'année scolaire 2008-2009 (réalisation de l'étude technico économique : janvier a avril 2009) puis réalisé l'année suivante, si l'intérêt écologique et la faisabilité économique sont prouvés. Un suivi des économies d'eau sera ensuite effectué afin d'étudier la rentabilité du procédé.
Partenariats techniques/financiers
- Université de Pau et des Pays de l'Adour.
- LEGTA, CFA et CFPPA de l'EPLEFPA H. Serres.
Réduction de la consommation en eau et en intrants en horticulture (Antibes - Alpes Maritimes)
Nom de la structure
EPL d'Antibes
Téléphone
04 92 91 44 44
Contact (courriel)
jean-claude.boucaud@educagri.fr
Site Web
http://www.vertdazur.educagri.fr
Code postal
06600
Ville
Antibes
Département
Alpes-Maritimes
Type d'initiative
- économie d'eau
- qualité de l'eau
Contexte
Le diagnostic global en matière de développement durable mené sur l'exploitation agricole de l'EPL d'Antibes (1 ha de serres et 2 ha de vergers) a permis de mettre en évidence des marges de progression rapide en terme notamment de consommation en eau d'arrosage et d'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires...
Le diagnostic global en matière de développement durable mené sur l'exploitation agricole de l'EPL d'Antibes (1 ha de serres et 2 ha de vergers) a permis de mettre en évidence des marges de progression rapide en terme notamment de consommation en eau d'arrosage et d'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires...
Description de l'action
- identification, culture et promotion de gammes végétales adaptées au climat méditerranéen utilisées pour les toitures végétalisées (réseau d'expérimentation «Plantes et Cités»)
- développement de nouvelles gammes végétales (plantes aromatiques) plus économes en eau, pour les professionnels des espaces verts (projet européen transfrontalier AROMA)
- mise en place de thermodiscs en fibres de coco biodégradables afin de stopper la germination des plantes adventices (suppression totale de désherbant anti-germinatif, maintien d'une certaine humidité pour la plante et meilleure activité microbienne du sol)
- paillage du sol (suppression des désherbants, non compactage du sol, maintien d'une humidité importante en période de sécheresse, amélioration de la texture, de la structure et de la vie microbienne du sol)
Utilisation pédagogique
Autre valorisation
Articulation avec les autres actions menées dans le cadre de l'Agenda 21, piloté par le CFA : http://cfa.antibes.agenda21.free.fr
Articulation avec les autres actions menées dans le cadre de l'Agenda 21, piloté par le CFA : http://cfa.antibes.agenda21.free.fr
Perspective
- mettre en place des sondes hygrométriques pour le suivi de la teneur en eau du sol et pour l'arrosage
- mettre en place un système de récupération des eaux pluviales
Partenariats techniques/financiers
- Conseil régional PACA
- réseau d'expérimentation «Plantes et Cités»
- INRA
- chambre d'agriculture 06
- universités italiennes...
Réhabilitation de mares (Gouville - Eure)
Nom de la structure
EPL de l'Eure-LEGTA E. de Chambray
Téléphone
02 32 35 61 70
Contact (courriel)
patrice.duhamel@educagri.fr
Contact2 (courriel)
isabelle.raimbourg@educagri.fr
Site Web
http://www.eplea-eure.educagri.fr/
Code postal
27240
Ville
Gouville
Département
Eure
Type d'initiative
- milieu naturel
Contexte
En un siècle, 90% des mares de Haute-Normandie ont disparu, du fait de l'agriculture et du mode de vie. Après la découverte d'amphibiens strictement protégés dans ses 2 mares, l'exploitation agricole du lycée E. de Chambray a décidé de mener une action de fond s'inscrivant sur deux dimensions : la protection d'espèces protégées à travers la préservation de leur habitat et la sensibilisation des acteurs.
En un siècle, 90% des mares de Haute-Normandie ont disparu, du fait de l'agriculture et du mode de vie. Après la découverte d'amphibiens strictement protégés dans ses 2 mares, l'exploitation agricole du lycée E. de Chambray a décidé de mener une action de fond s'inscrivant sur deux dimensions : la protection d'espèces protégées à travers la préservation de leur habitat et la sensibilisation des acteurs.
Objectif
- pédagogique : enrichissement du support d'étude des filières agricoles et d'aménagement du territoire ;
- environnemental : amélioration de la biodiversité et du paysage par l'augmentation de la diversité des milieux et par l'application de modes de gestion appropriés ;
- relationnel : sensibilisation et communication
Description de l'action
- inventaires faunistiques (six espèces d'amphibiens se reproduisent dans les deux mares, dix espèces d'odonates) et floristiques (quatorze espèces végétales dont deux espèces présentant un intérêt patrimonial)
- curage des mares, leur redonnant leur forme d'origine. arrachage partiel des massettes, réalisés en partie par l'exploitation et complétés par un arrachage manuel effectué par les élèves du club CPN (connaître et protéger la nature)
- relevé topographique réalisé par les étudiants en BTS GEMEAU afin de déterminer les zones de ruissellement
- mise en AB des prairies extensives jouxtant les mares
- implantation d'une bande en jachère messicole entre les mares et une parcelle culturale voisine
- attention particulière portée à la communication à travers la sensibilisation des apprenants, des particuliers, des élus et des agriculteurs
Résultats
- de nouvelles espèces végétales, dont le Rubanier simple, sont apparues et des herbiers aquatiques, lieux de pontes pour les libellules, se sont considérablement développés.
- 41 pontes d'amphibiens en 2009 (17 en 2008)
Utilisation pédagogique
- sensibilisation des apprenants sur les rôles et intérêts des mares par le biais d'interventions, de présentations de diaporamas et de sorties terrain ;
- réalisation d'une enquête par les BTS Gémeau dans le cadre d'un module d'initiative locale développement durable auprès de propriétaires afin d'identifier les freins et motivations relatifs à la restauration et l'entretien des mares sur la commune de Gouville
Autre valorisation
- organisation d'une conférence : journées de sensibilisation auprès des élus et agriculteurs
- organisation d'un chantier de restauration d'une mare par des particuliers volontaires, dans le cadre de journées de sensibilisation grand public (mare utilisée pour les animations scolaires par le centre de ressources et d'éducation à l'environnement - CRÉE - du lycée de Chambray
- parution d'articles dans la presse locale et reportage diffusé sur France 3 Normandie.
Perspective
- création de mares sur le domaine de Chambray
- organisation d'une journée technique à l'attention des élus (aménagements intégrés des mares)
- participation au programme d'observation M.A.R.E du Museum national d'histoire naturelle, le CRÉE, avec le club Connaitre et Protéger la Nature (CPN) du lycée
- participation au groupe de travail "mares" de l'observatoire régional de la biodiversité (OBHN)
Partenariats techniques/financiers
- DREAL
- CG 27
- Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
- AREHN
- CAUE 27
- MNHN
- PNR des boucles de la Seine Normande, Pays du Roumois, CFEN Basse-Normandie
- mairies de Gouville, de Balines
- Conservatoire des espaces naturels de Haute-Normandie
- Agence de l'eau Seine-Normandie
Fichier : fichierinitiative1_amphibiens.pdf
Télécharger
Lien vers vidéo de présentation (1)
http://www.dailymotion.com/video/xx6n92_edechambray-cree_school#.UQt5AejoU7A
Vidéo de présentation (1)
Réhabilitation du Bief du Potet, petit cours d'eau affluent de la Saône (Tournus - Saone-et-Loire)
Nom de la structure
EPL Tournus
Téléphone
03 85 32 26 00
Contact (courriel)
aurelie.nalin@educagri.fr
Site Web
http://www.epl-tournus.educagri.fr
Code postal
71700
Ville
Tournus
Département
Saône-et-Loire
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- milieu naturel
- qualité de l'eau
Contexte
Le lycée de l'horticulture et du paysage de Tournus a entrepris depuis 2009, soutenu par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et dans le cadre du contrat des rivières du Mâconnais, la réhabilitation du Bief du Potet, traversant son terrain et bordant son verger écologique, qui conflue directement à la Saône en plein centre de la ville de Tournus. En tant que ""très petit cours d'eau", ce ruisseau n'est pas référencé dans le SDAGE, mais le dynamisme des acteurs du territoire a permis une prise en compte des problématiques sur le bassin-versant, et le recensement des enjeux principaux : dysfonctionnement du système d'assainissement, problèmes de continuité écologique et de morphodynamique du ruisseau, pollutions aux phytosanitaires par les riverains, captages et pompages illégaux, détournements illégaux du tracé, non respect réglementaire de la bande des 5 m, drainages en tête de bassin-versant, mauvaise gestion de la ripisylve,...
Objectif
- améliorer la qualité chimique, physique et écologique du cours d'eau
- sensibiliser les apprenants, le grand public, les élus et les professionnels du territoire aux bonnes pratiques et à la gestion durable des milieux aquatiques
Description de l'action
- sensibilisation des particuliers aux risques liés aux pesticides, à la police de l'eau
- réalisation d'inventaires floristiques et faunistiques aquatiques
- réalisation d'un plan de gestion de la ripisylve sur le tronçon du verger écologique : ré-ouverture et aménagement doux des berges, création d'une zone humide (anse), création d'un belvédère (sensibilisation du grand public), par décapage d'un talus de berge et remblai à proximité de l'autoroute
- participation à la restauration du Bief sur d'autres tronçons et à la réalisation d'une "zone de loisirs" en aval de l'autoroute
- lutte contre le développement de la Renouée du Japon, renforcée par plantations de boutures de saules
- valorisation patrimoniale (circuit historique sur la ville de Tournus)
- valorisation écologique/ sensibilisation des publics (bornes flashcodes et panneaux sur parcours de valorisation)
Utilisation pédagogique
classe de seconde générale et élèves de la filière STAV, dans le cadre de leur enseignement de "pratique professionnelle"
Autre valorisation
- communication auprès des élus du territoire
- nombreux articles de presse, bulletins municipaux,...
- journées portes ouvertes
Partenariats techniques/financiers
- EPTB Saône-Loire
- Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse
- collectivités locales (commune, Conseil départemental et régional)
- Société d'histoire naturelle d'Autun
- Musée Greuze de Tournus, Pays d'art et d'histoire "Entre Cluny et Tournus", Office de tourisme, Amis des arts et sciences de Tournus
Fichier : AmenagementDunQtresPetitCoursDeauqtour_fichierinitiative2_flashcodes.pdf
Télécharger
Fichier : AmenagementDunQtresPetitCoursDeauqtour_fichierinitiative3_articlespresse_tournus.pdf
Télécharger

Lien vers vidéo de présentation (1)
http://www.dailymotion.com/video/xr10ly_tournus-biefdupotet2012_school
Réhabilitation et renauration des bassins de décantation de l'exploitation horticole (Niort - Deux-Sèvres)
Nom de la structure
Lycée horticole Gaston Chaissac Niort
Téléphone
0549733661
Contact (courriel)
lpa.niort@educagri.fr
Adresse postale
130, route de Coulonges
Code postal
79011
Ville
NIORT
Département
Deux-Sèvres
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- traitement des effluents
- milieu naturel
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
D’une surface de 3,5 ha l’exploitation horticole de l’établissement est située en limite d’une zone nodale, réservoir de biodiversité. Elle est enclavée par des parcelles agricoles et fait le lien entre le milieu urbain et le milieu naturel.
1/3 de la surface de l’exploitation est artificialisé (route, bâtiment) et si l’on compte la partie de production sur planches hors sol, cela représente au total la moitié de la surface. Des bassins de récupération des eaux d’irrigation par gravité sont en place à proximité de la zone hors sol. Au total, 3 bassins sont creusés et étanchéifiés avec une bâche. Mis à part un développement d’algues, la végétation aquatique ou subaquatique semble y être inexistante. Pauvres en biodiversité, ces bassins nécessitent d’être réhabilités.
La biodiversité étant un élément clé du projet de l’établissement et le financement de ce type de chantiers écoles étant assuré (appel d’offre de la fondation LISEA remporté par l’établissement), la réhabilitation des bassins de décantation des eaux d’arrosage de l’exploitation horticole a été effectuée.
Pour conduire à bien le projet, l’équipe pédagogique a profité :
- des heures d’EIE sur le thème de l’étude des milieux naturels pour réaliser des états des lieux du site avant et après réhabilitation
D’une surface de 3,5 ha l’exploitation horticole de l’établissement est située en limite d’une zone nodale, réservoir de biodiversité. Elle est enclavée par des parcelles agricoles et fait le lien entre le milieu urbain et le milieu naturel.
1/3 de la surface de l’exploitation est artificialisé (route, bâtiment) et si l’on compte la partie de production sur planches hors sol, cela représente au total la moitié de la surface. Des bassins de récupération des eaux d’irrigation par gravité sont en place à proximité de la zone hors sol. Au total, 3 bassins sont creusés et étanchéifiés avec une bâche. Mis à part un développement d’algues, la végétation aquatique ou subaquatique semble y être inexistante. Pauvres en biodiversité, ces bassins nécessitent d’être réhabilités.
La biodiversité étant un élément clé du projet de l’établissement et le financement de ce type de chantiers écoles étant assuré (appel d’offre de la fondation LISEA remporté par l’établissement), la réhabilitation des bassins de décantation des eaux d’arrosage de l’exploitation horticole a été effectuée.
Pour conduire à bien le projet, l’équipe pédagogique a profité :
- des heures d’EIE sur le thème de l’étude des milieux naturels pour réaliser des états des lieux du site avant et après réhabilitation
- de plusieurs chantiers "école" pour sa mise en œuvre.
Objectif
cf. doc enjeux de l'action à télécharger ci-dessous
cf. doc enjeux de l'action à télécharger ci-dessous
Description de l'action
Ouverte au grand public et aux professionnels souhaitant y acheter leurs végétaux, la pépinière du lycée horticole constitue un îlot de biodiversité pour les espèces se déplaçant de la Sèvre Niortaise jusqu’aux forêts avoisinantes. C’est ainsi que les bassins artificiels d’irrigation de l’exploitation horticole sont en cours de végétalisation. Ce travail financé par la fondation Lisea-Biodiversité est conduit dans le cadre de plusieurs chantiers école par des élèves de 2nde NJPF GEN de l’établissement, accompagnés par des enseignants en aménagements paysagers et en biologie.
Il permet de protéger les bâches des rayons UV et de favoriser l’accroissement de la population d’auxiliaires de culture (ennemis naturels des ravageurs).
Un panneau d’information sur ces auxiliaires (habitat, régime alimentaire…) sera d’ailleurs prochainement installé sur le site.
L’espoir étant qu’au-delà des élèves de l’établissement, formés à ces nouvelles techniques, chaque visiteur réutilise ces nouvelles connaissances dans la gestion de son jardin…
Ouverte au grand public et aux professionnels souhaitant y acheter leurs végétaux, la pépinière du lycée horticole constitue un îlot de biodiversité pour les espèces se déplaçant de la Sèvre Niortaise jusqu’aux forêts avoisinantes. C’est ainsi que les bassins artificiels d’irrigation de l’exploitation horticole sont en cours de végétalisation. Ce travail financé par la fondation Lisea-Biodiversité est conduit dans le cadre de plusieurs chantiers école par des élèves de 2nde NJPF GEN de l’établissement, accompagnés par des enseignants en aménagements paysagers et en biologie.
Il permet de protéger les bâches des rayons UV et de favoriser l’accroissement de la population d’auxiliaires de culture (ennemis naturels des ravageurs).
Un panneau d’information sur ces auxiliaires (habitat, régime alimentaire…) sera d’ailleurs prochainement installé sur le site.
L’espoir étant qu’au-delà des élèves de l’établissement, formés à ces nouvelles techniques, chaque visiteur réutilise ces nouvelles connaissances dans la gestion de son jardin…
Utilisation pédagogique
La réussite du projet n’a pu se faire que par la grande volonté des enseignants en décidant de :
- consacrer des heures d’EIE et l’intégralité d’un chantier école au projet,
- s’impliquer personnellement sur un projet rapprochant la biodiversité et la production. « C’était ma volonté de participer au chantier école. Ça nous a permis avec les élèves de poursuivre les observations faites pendant l’état des lieux et rapprocher de ce qu’on avait vu en cours » dit Isabelle Bouhier, enseignante en biologie.
Désormais, il appartient aux équipes pédagogiques de l’apprentissage et de la formation continue de faire participer au projet : identification des auxiliaires de culture et sensibiliation au « produire autrement ».
La réussite du projet n’a pu se faire que par la grande volonté des enseignants en décidant de :
- consacrer des heures d’EIE et l’intégralité d’un chantier école au projet,
- s’impliquer personnellement sur un projet rapprochant la biodiversité et la production. « C’était ma volonté de participer au chantier école. Ça nous a permis avec les élèves de poursuivre les observations faites pendant l’état des lieux et rapprocher de ce qu’on avait vu en cours » dit Isabelle Bouhier, enseignante en biologie.
Désormais, il appartient aux équipes pédagogiques de l’apprentissage et de la formation continue de faire participer au projet : identification des auxiliaires de culture et sensibiliation au « produire autrement ».
Partenariats techniques/financiers
La réalisation du projet a été décidée au sein d'un comité de pilotage dans lequel sont représentés :
- l'équipe de direction de établissement,
- les enseignants de l'établissement,
- les collectivités locales,
- les associations environnementalistes,
- la profession horticole et du paysage,
- l'enseignement supérieur et la recherche.
Le financement de l'action est assuré en intégralité par la fondation LISEA Biodiversité.
La réalisation du projet a été décidée au sein d'un comité de pilotage dans lequel sont représentés :
- l'équipe de direction de établissement,
- les enseignants de l'établissement,
- les collectivités locales,
- les associations environnementalistes,
- la profession horticole et du paysage,
- l'enseignement supérieur et la recherche.
Le financement de l'action est assuré en intégralité par la fondation LISEA Biodiversité.
Fichier : fichierinitiative1_enjeux_action_Niort.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative2_Travail_eleves__Niort.pdf
Télécharger
Lien vers vidéo de présentation (1)
https://vimeo.com/119451234
Vidéo de présentation (1)
clip
Restauration d'habitat pour amphibiens sur l'exploitation (Luçon-Pétré - Vendée)
Nom de la structure
EPL de Luçon-Pétré
Téléphone
02 51 27 09 18
Contact (courriel)
stephane.bodin@educagri.fr
Code postal
85400
Ville
Sainte-Gemme-La-Plaine
Département
Vendée
Type d'initiative
- milieu naturel
Contexte
L'établissement de Luçon-Pétré, au travers de son exploitation, s'est toujours impliqué dans la préservation des espèces animales et végétales et se veut aussi sensible à la préservation de la biodiversité dans les zones humides, en ayant des conduites d'élevage et culturales les moins impactantes possibles sur les milieux (réduction des intrants, élevage extensif, etc.).
Au travers de ce projet sur la restauration des habitats de la grenouille agile, le lycée veut se donner une nouvelle impulsion pour sensibiliser les apprenants sur ce thème de la préservation de la biodiversité locale.
L'établissement de Luçon-Pétré, au travers de son exploitation, s'est toujours impliqué dans la préservation des espèces animales et végétales et se veut aussi sensible à la préservation de la biodiversité dans les zones humides, en ayant des conduites d'élevage et culturales les moins impactantes possibles sur les milieux (réduction des intrants, élevage extensif, etc.).
Au travers de ce projet sur la restauration des habitats de la grenouille agile, le lycée veut se donner une nouvelle impulsion pour sensibiliser les apprenants sur ce thème de la préservation de la biodiversité locale.
Objectif
Trouver une corrélation entre l'état du fossé et la présence de cet amphibien pour mieux protéger les habitats de cette espèce.
Trouver une corrélation entre l'état du fossé et la présence de cet amphibien pour mieux protéger les habitats de cette espèce.
Description de l'action
- 2007-2008 : estimation de la présence de la grenouille agile et des autres amphibiens sur les terrains gérés par le lycée (prairies et terrées) ainsi que de l'état des fossés dans lesquels elles sont présentes. Cette première phase a permis de montrer l'absence de ponte dans certains secteurs. Une hypothèse émerge : le non entretien des fossés en serait la cause principale.
- 2008-2009 : travaux de modelage des lieux de ponte des grenouilles sous forme d'expérimentation. Des fossés sont curés selon des modalités différentes (simple élagage, curage profond partiel ou total), d'autres sont laissés tels quels, de toutes petites mares sont aussi creusées. Cette gestion différenciée est mise en place avant les pluies d'hiver. Ces travaux doivent permettre de laisser en eau les fossés sur une période plus importante, de créer de nouveaux points d'eau et ainsi favoriser les pontes de l'amphibien.
- 2009-2010 : nouvelle campagne de comptage de grenouilles agiles et de leurs pontes...
Résultats
Les résultats sont décevants dans le sens où il n'y a pas eu d'amélioration en nombre de ponte. Le milieu étudié s'est trop développé et s'est refermé, il n'y a pas assez de lumière pour favoriser les pontes. Plusieurs pistes sont alors envisagées : laisser évoluer ces parcelles sans qu'il y ait d'interventions anthropiques directes ; en effet, le travail d'entretien pourrait sembler disproportionné pour que le nombre de pontes de la grenouille agile augmente dans les terrées. Elles trouveraient ainsi leur équilibre naturel. Ou alors s'engager dans un nouveau projet avec un travail plus important d'élagage (pour ouvrir le milieu), ce qui permettrait de valider la seconde hypothèse d'un manque de lumière. Cette dernière voie semble être envisageable dans les quelques années à venir.
Les résultats sont décevants dans le sens où il n'y a pas eu d'amélioration en nombre de ponte. Le milieu étudié s'est trop développé et s'est refermé, il n'y a pas assez de lumière pour favoriser les pontes. Plusieurs pistes sont alors envisagées : laisser évoluer ces parcelles sans qu'il y ait d'interventions anthropiques directes ; en effet, le travail d'entretien pourrait sembler disproportionné pour que le nombre de pontes de la grenouille agile augmente dans les terrées. Elles trouveraient ainsi leur équilibre naturel. Ou alors s'engager dans un nouveau projet avec un travail plus important d'élagage (pour ouvrir le milieu), ce qui permettrait de valider la seconde hypothèse d'un manque de lumière. Cette dernière voie semble être envisageable dans les quelques années à venir.
Utilisation pédagogique
Plusieurs élèves ont suivi le projet, soit au travers de leurs cours (classe de bac professionnel CGEA, TP et PH) soit au travers de club (club exploitation).
Le projet entre pour partie aussi dans la formation des éco-délégués en début d'année afin de les sensibiliser, entre autres, au pilier environnemental du développement durable.
Plusieurs élèves ont suivi le projet, soit au travers de leurs cours (classe de bac professionnel CGEA, TP et PH) soit au travers de club (club exploitation).
Le projet entre pour partie aussi dans la formation des éco-délégués en début d'année afin de les sensibiliser, entre autres, au pilier environnemental du développement durable.
Autre valorisation
Création d'un visuel (panneau) retraçant les trois années du projet ainsi que ses enjeux. Cette présentation du projet se fait de manière ponctuelle lors d'événements comme les portes ouvertes de l'établissement.
Une synthèse de l'action est aussi consultable sur le site Internet du lycée
Création d'un visuel (panneau) retraçant les trois années du projet ainsi que ses enjeux. Cette présentation du projet se fait de manière ponctuelle lors d'événements comme les portes ouvertes de l'établissement.
Une synthèse de l'action est aussi consultable sur le site Internet du lycée
Partenariats techniques/financiers
Parc interrégional du marais Poitevin
Parc interrégional du marais Poitevin
Restauration d'une zone humide sur le site du campus (Albi - Tarn)
Nom de la structure
EPL Albi-Plateforme technologique GH2O
Téléphone
05 63 49 43 70
Contact (courriel)
fabrice.jeanson@educagri.fr
Contact2 (courriel)
nicolas.alvarez@educagri.fr
Site Web
http://www.tarn.educagri.fr
Code postal
81000
Ville
Albi
Département
Tarn
Type d'initiative
- milieu naturel
- qualité de l'eau
Contexte
La zone humide présente sur le terrain de l'établissement voit ces dernières années une modification importante de la qualité et de la quantité de ses eaux. A la faveur de profonds changements et d'une urbanisation massive de la zone, on observe depuis 2008 une modification significative des volumes d'eaux de ruissèlement qui transitent dans le bassin versant de Fonlabour (flux discontinus en flux permanents) et une altération de la qualité de ces eaux (pollution aux hydrocarbures visuelle, accident écologique en 2009 de mortalité massive des cyprinidés). La mise en place d'un site de mesures a permis d'identifier précisement la présence d'hydrocarbures, de métaux lourds (Cuivre et Zinc) d'Azote et de Phosphore ainsi que des pollutions organiques d'origine domestique, en quantité non négligeable.
Objectif
- Créer une zone tampon végétalisée, de lissage hydraulique et d'épuration en amont du lac collinaire afin de restaurer la qualité des eaux de ce dernier
- Créer un site de démonstration qui servira de support d’exérimentations et d’outil pédagogique (étude du lac menée par des BTSA)
- Réaliser la diffusion scientifique et technique en permettant l’accès au site à différents publics : institutionnels, éducateurs, enseignants, professionnels avec possibilité d'avoir accès aux données de suivi de l'eau (hydrauliques, physico-chimiques, biologiques)
- Devenir autonome pour l’irrigation des aires de jeux, des terrains de sport et des espaces verts du lycée
- Créer un site de démonstration qui servira de support d’exérimentations et d’outil pédagogique (étude du lac menée par des BTSA)
- Réaliser la diffusion scientifique et technique en permettant l’accès au site à différents publics : institutionnels, éducateurs, enseignants, professionnels avec possibilité d'avoir accès aux données de suivi de l'eau (hydrauliques, physico-chimiques, biologiques)
- Devenir autonome pour l’irrigation des aires de jeux, des terrains de sport et des espaces verts du lycée
Description de l'action
- 2011-2012 : Aménagement site de mesure
- 2012-2013 : Suivi hydraulique et analytique
- 2013-2014 : Etat de l'art, étude technico-économique du dispositif épuratoire + Choix et dimensionnement du dispositif épuratoire et de lissage hydraulique innovant, adapté aux pollutions et aux débits préalablement mesurés.
- 2014 : Aménagement du site zone humide
- depuis 2015 : Suivi technique et analytique (qualité des eaux superficielles et gestion de la ressource en eau) assuré par la PFT et le service technique (travaux paysagers) de l'établissement. Valorisation pédagogique, sensibilisation
Utilisation pédagogique
- tous les apprenants des pôles "eau" et "aménagement paysager" impliqués dans les réalisations de chantiers et de mesures de suivi hydraulique, physico-chimique et biologique,
- projet tuteuré licence pro "eaux, boues, déchets" dans la phase d'étude préalable : étude du bassin-versant, proposition de système d'épuration des eaux,
- projets techniques (M54) de BTS GEMEAU,
- accueil de publics internes et externes (apprenants, professionnels) pour la sensibilisation, apprentissage, communication scientifique,
- appui pédagogique pour les filières de l'eau et de l'aménagement paysager
Autre valorisation
- suivi du site et entretien de la zone humide,
- accueil de tous types de publics et diffusion scientifique (structures publiques, entreprises, enseignants et apprenants),
- partenariats techniques et industriels pour l'utilisation de ce site de démonstration,
- constitution d'une base de données accessible aux structures futures utilisatrices du site : constructeurs-équipementiers de systèmes de traitement, professionnels du paysage, partenaires techniques et industriels, structures publiques et parapubliques en charge de la création, du développement, de la restauration ou de la préservation de zones humides naturelles.
- page web dédiée : https://epl-tarn.mon-ent-occitanie.fr/lycee-agricole-albi-fonlabour/projet-zone-humide/
- vidéo de présentation réalisée dans le cadre d'un PIC de BTSA GEMEAU 2e année (https://www.youtube.com/watch?v=zPCOnEujxZk)
Partenariats techniques/financiers
- Agence de l'Eau Adour-Garonne
- Conseil départemental du Tarn : PDZH, CATER, SATESE - DDT du Tarn, pôle Eau et Biodiversité
- Syndicat des eaux de la rivière Tarn
- Communauté d'Agglomération de l'Albigeois
- Commune du Séquestre
- Société EPURSCOP
- EPLEFPA du Tarn : PFT GH2O, service technique aménagement, enseignants
- DRRT MESR
- Conseil régional Occitanie
Fichier : fichierinitiative1_planche_photos_ZH.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative2_Affiche_Projet_zone_humide_2016.pdf
Télécharger
Lien vers vidéo de présentation (1)
https://www.youtube.com/watch?v=zPCOnEujxZk
Vidéo de présentation (1)
Restauration de milieux aquatiques et préservation de la biodiversité (Melle - Deux-Sèvres)
Nom de la structure
EPLEFPA Jacques Bujault de Melle
Téléphone
05 49 27 02 92
Contact (courriel)
christine.le-torch@educagri.fr
Site Web
http://www.melle.educagri.fr
Code postal
79500
Ville
Melle
Département
Deux-Sèvres
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- milieu naturel
Contexte
Depuis 2012, dans le contexte de création de la première réserve naturelle régionale des Deux Sèvres, les BTS "Gestion et protection de la nature" (GPN) de Melle interviennent pour des travaux de restauration
(module M53 du BTS GPN sur la mise en oeuvre d'opération de génie écologique)
Les commanditaires sont les propriétaires de la SCI dont un en particulier et l'association Deux Sèvre Nature Environnement (gestionnaire)...
Depuis 2012, dans le contexte de création de la première réserve naturelle régionale des Deux Sèvres, les BTS "Gestion et protection de la nature" (GPN) de Melle interviennent pour des travaux de restauration
(module M53 du BTS GPN sur la mise en oeuvre d'opération de génie écologique)
Les commanditaires sont les propriétaires de la SCI dont un en particulier et l'association Deux Sèvre Nature Environnement (gestionnaire)...
Objectif
- protéger la biodiversité
- mener un inventaire local de faune et de flore
- former de futurs techniciens de protection de l'environnement.
Description de l'action
- 2012 : chantier d'arrachage de Saule et de Frêne colonisant les bordures exhondées de l'étang (objectif: restauration des gazons amphibies). Valorisation des 500 Saules et 400 Frênes pour des projets de plantations après mise en pépinière.
- 2013 : travaux de finition (intégration paysagère + pente douce) de six nouvelles mares prairiales créées. Mise en place des exclos (objectif: suivi de la colonisation)
- 2014 : restauration de quatre mares du "Bocage des Antonins" à Saint-Marc-la-Lande, pour préserver la présence de 8 espèces d'amphibiens recensées localement (tritons, grenouilles, crapauds et salamandres)
Utilisation pédagogique
TP des BTSA GPN (cf. ci-dessus)
+ Chaque année, étude hydrobiologique d'un cours d'eau :
. commande et terrain co encadré par l'ONEMA
. diagnostic (profils en long, en plan, transect; IBGN, score d'hétérogénéité, IBGN, ripisylve, mesures de débit et analyses physico chimiques etc.) et programme d'actions comme support de projet tutoré collectif
. restitution écrite pour l'ONEMA (orale devant le conseil d'exploitation quand l'intervention porte sur des tronçons des 3km de cours d'eau de l'exploitation)
+ En complément, depuis 2011, EIE et MAP des 1 GMNF :
. en EIE : approche paysagère et des des acteurs à l'échelle du bassin versant (production de la carte d'utilisation des sols)
. en MAP : mesures et analyses (production d'une cartographie des herbiers, de la granulomètrie du fond et du recouvrement de la ripisylve...), recherche sur une espèce piscicole, CCF sur les potentalités d'accueil de ce cours d'eau pour ce poisson.
+ Chaque année, étude hydrobiologique d'un cours d'eau :
. commande et terrain co encadré par l'ONEMA
. diagnostic (profils en long, en plan, transect; IBGN, score d'hétérogénéité, IBGN, ripisylve, mesures de débit et analyses physico chimiques etc.) et programme d'actions comme support de projet tutoré collectif
. restitution écrite pour l'ONEMA (orale devant le conseil d'exploitation quand l'intervention porte sur des tronçons des 3km de cours d'eau de l'exploitation)
+ En complément, depuis 2011, EIE et MAP des 1 GMNF :
. en EIE : approche paysagère et des des acteurs à l'échelle du bassin versant (production de la carte d'utilisation des sols)
. en MAP : mesures et analyses (production d'une cartographie des herbiers, de la granulomètrie du fond et du recouvrement de la ripisylve...), recherche sur une espèce piscicole, CCF sur les potentalités d'accueil de ce cours d'eau pour ce poisson.
Partenariats techniques/financiers
Deux-Sèvres Nature Environnement,
CNRS de Chizé,
CPIE de Coutière,
groupe de propriétaires locaux
Deux-Sèvres Nature Environnement,
CNRS de Chizé,
CPIE de Coutière,
groupe de propriétaires locaux
Restauration des fonctionnalités du sol et optimisation de la ressource en eau (Lavaur - Tarn)
Nom de la structure
EPLEFPA du Tarn, ferme En Darassou de Lavaur-Flamarens
Téléphone
05 63 42 38 00
Contact (courriel)
lea.boutard@educagri.fr
Contact2 (courriel)
nathalie.latger@educagri.fr
Code postal
81500
Ville
Lavaur
Département
Tarn
Type d'initiative
- économie d'eau
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
L’exploitation agricole polyculture-élevage d’En Darassou se situe dans la plaine alluviale de la rivière Agout (90 hectares de surface agricole utile, 45 bovins allaitants race Blonde d'aquitaine et 30 brebis pour écopâturage), en zone vulnérable Nitrates. Les sols sont de types boulbènes (matrice limoneuse et proportions de sable ou d’argile très variables selon les parcelles). Ces terres sont très sensibles aux phénomènes hydriques (battance, ruissellement, glaçage, sécheresse), du fait de leur texture mais également de faibles taux de matières organiques : 1,9 % environ (conséquence d’un travail excessif du sol, de la minéralisation suite à l'irrigation et de l'exportation des cultures pour le troupeau). La réserve utile en eau est faible à moyenne (50 à 150 mm), avec de très forts ETP estivaux. Les grandes cultures (60 ha), composées de cultures d'hiver (blé, orge, lin) et de cultures irriguées d'été (maïs, soja), sont gérées en semis direct (TCS) et couverture permanante des sols depuis 2016 (agriculture de conservation des sols).
Objectif
- garantir un maximum d'autonomie fourragère tout en améliorant les fonctionnalités du sol avec l'agriculture de conservation (avec notamment les couverts d'été et les méteils)
- réduire les intrants et maîtriser au mieux les besoins en eau d'irrigation (référence réglementaire 120 000 m3/an))
- réduire les intrants et maîtriser au mieux les besoins en eau d'irrigation (référence réglementaire 120 000 m3/an))
Description de l'action
1/ couverture permanente des sols :rotation irriguée maïs > (couvert hiver méteil) > soja > blé tendre > (couvert été) > orge ou lin > (couvert été) > (couvert hiver méteil) > maïs ...
2/ arrêt total du glyphosate et des herbicides racinaires (action dans le cadre du projet régional TAArGET 2019-20222) 3/ suivi de la qualité des eaux de drainage
4/ efficience de l'irrigation :
. suivi par sondes tensiométriques d'une parcelle de référence
. investissements : changement des pompes immergées (dans l'Agout) et émergées, achat d'un enrouleur à régulation électronique, changement du busage (sprinkler) du pivot (stopage des fuites)
5/ amélioration de l'implantation des couverts d'été : expérimentation en 2021 avec 5 modalités (mélanges) différentes, avec ou sans irrigation (cf. fichiers joints)
2/ arrêt total du glyphosate et des herbicides racinaires (action dans le cadre du projet régional TAArGET 2019-20222) 3/ suivi de la qualité des eaux de drainage
4/ efficience de l'irrigation :
. suivi par sondes tensiométriques d'une parcelle de référence
. investissements : changement des pompes immergées (dans l'Agout) et émergées, achat d'un enrouleur à régulation électronique, changement du busage (sprinkler) du pivot (stopage des fuites)
5/ amélioration de l'implantation des couverts d'été : expérimentation en 2021 avec 5 modalités (mélanges) différentes, avec ou sans irrigation (cf. fichiers joints)
Résultats
- diminution d'environ 40% des consommations d'eau et 50% des consommations d'énergie liées à l'irrigation
- remontée du taux de matières organiques des sols
- qualité des eaux de drainage : résultats d'analyse 2020 (sous traitance LDA 31) : glyphosate < 0,1 microgramme/l, AMPA < 0,6 microgramme/l, iodosulfuron-méthyl-sodium < 0,05 microgramme/l
- expérimentation couverts d'été : la contrainte majeure au développement des couverts estivaux est le manque d’eau. L’irrigation peut être une solution pour développer cette biomasse mais n’est pas une solution satisfaisante d’un point de vue de gestion des adventices. D’autres techniques d’implantation et de mélanges d’espèces devraient permettre d’aboutir à des résultats prometteurs comme les techniques de semis à la volée au printemps dans la culture en place ou de semis à l’automne simultanément au semis de la culture principale. L’amélioration attendue du sol grâce à la continuité des pratiques d’agriculture de conservation va dans le sens d’une amélioration des performances des couverts d’été notamment avec l’amélioration de la réserve utile des sols. Essais 2021 : les modalités où la biomasse est élevée sont les mélanges à base de sorgho fourrager.
- remontée du taux de matières organiques des sols
- qualité des eaux de drainage : résultats d'analyse 2020 (sous traitance LDA 31) : glyphosate < 0,1 microgramme/l, AMPA < 0,6 microgramme/l, iodosulfuron-méthyl-sodium < 0,05 microgramme/l
- expérimentation couverts d'été : la contrainte majeure au développement des couverts estivaux est le manque d’eau. L’irrigation peut être une solution pour développer cette biomasse mais n’est pas une solution satisfaisante d’un point de vue de gestion des adventices. D’autres techniques d’implantation et de mélanges d’espèces devraient permettre d’aboutir à des résultats prometteurs comme les techniques de semis à la volée au printemps dans la culture en place ou de semis à l’automne simultanément au semis de la culture principale. L’amélioration attendue du sol grâce à la continuité des pratiques d’agriculture de conservation va dans le sens d’une amélioration des performances des couverts d’été notamment avec l’amélioration de la réserve utile des sols. Essais 2021 : les modalités où la biomasse est élevée sont les mélanges à base de sorgho fourrager.
Utilisation pédagogique
Les élèves et étudiant sont été particulièrement impliqués, en particulier pour les essais d'amélioration des couverts d'été : protocole d'expérimentation et présentation aux autres étudiants, élèves et professionnels par BTSA APV, test bèches, comptage vers de terre, relevés de biomasse, constitution de base de données et destruction des couverts par bac pro CGEA, analyse des résultats par BTSA APV. Pour la rénovation du système d'irrigation, implication des BTSA GEMEAu d'Albi
Autre valorisation
. cf. vidéo reportage (itw Léa Boutard)
. présentation de l'action lors de la journée technique de la 15e Semaine de l'eau le 31 mars 2022 (article)
. présentation de l'action lors de la journée technique de la 15e Semaine de l'eau le 31 mars 2022 (article)
Partenariats techniques/financiers
- Dispositif local Dephy ferme, régional TAArGET, national Ecopyto'TER
- Accompagnement Plateforme technologique Agroécologie d'Auzeville (désormais GIP Transitions"), Plateforme technologique GH2O
- Chambre d'agriculture du Tarn
- Appui financier Agence de l'eau Adour Garonne, Plan de relance France 2030, Conseil régional Occitanie
- Accompagnement Plateforme technologique Agroécologie d'Auzeville (désormais GIP Transitions"), Plateforme technologique GH2O
- Chambre d'agriculture du Tarn
- Appui financier Agence de l'eau Adour Garonne, Plan de relance France 2030, Conseil régional Occitanie
Fichier : RestaurationDesFonctionnalitesDuSolEtOpti_fichierinitiative1_essai_couverts_estivaux_2021.pdf
Télécharger


Lien vers vidéo de présentation (1)
https://www.dailymotion.com/video/x89w80x
Vidéo de présentation (1)
Restauration de zones humides dans la Vallée des agneaux (Meymac - Corrèze)
Nom de la structure
EPLEFPA de Haute Correze
Téléphone
0683697910
Contact (courriel)
jean-paul.goursolas@educagri.fr
Adresse postale
rue de l'ecole forestière
Code postal
19250
Ville
Meymac
Département
Corrèze
Type d'initiative
- milieu naturel
- qualité de l'eau
Contexte
Le Ruisseau des agneaux se situe sur le bassin versant du Deiro en amont de la prise d'eau AEP de la commune d'Egletons. Ce bassin est également concerné en aval par un plan d'eau de baignade «le lac d'Egletons».
Le projet de restauration de zones humides fait partie d'un Programme pluriannuel de gestion des cours d'eau communautaire (PPG 2012-2016) qui fait l'objet d'une procédure de Déclaration d'intérêt général (D.I.G.).
Le Ruisseau des agneaux se situe sur le bassin versant du Deiro en amont de la prise d'eau AEP de la commune d'Egletons. Ce bassin est également concerné en aval par un plan d'eau de baignade «le lac d'Egletons».
Le projet de restauration de zones humides fait partie d'un Programme pluriannuel de gestion des cours d'eau communautaire (PPG 2012-2016) qui fait l'objet d'une procédure de Déclaration d'intérêt général (D.I.G.).
Objectif
Consciente du rôle écologique et hydraulique que peuvent jouer les zones humides dans la préservation de la ressource en eau, la Communauté de communes de Ventadour s'engage dans un projet de restauration et de préservation de 10 ha de zones humides d'intérêts communautaires dans la Vallée des agneaux.
L'entretien du site se fera par la suite par le pâturage d'animaux.
Consciente du rôle écologique et hydraulique que peuvent jouer les zones humides dans la préservation de la ressource en eau, la Communauté de communes de Ventadour s'engage dans un projet de restauration et de préservation de 10 ha de zones humides d'intérêts communautaires dans la Vallée des agneaux.
L'entretien du site se fera par la suite par le pâturage d'animaux.
Description de l'action
Pour la réalisation de ce chantier, les moyens matériels et humains du lycée forestier de Meymac et du lycée agricole de Neuvic s'allient. Deux tracteurs agricoles (dont un adapté en forestier), un treuil 3 points avec du câble synthétique, un broyeur de branches, des tronçonneuses et beaucoup de courage sont nécessaires pour la réalisation du projet.
Pour le respect du site, l'huile de chaine ainsi que le carburant pour les tronçonneuses sont biodégradables.
Les arbres sont abattus et treuillés entiers dans une zone moins humide (moins sensible). Là ils sont ébranchés, les branches sont broyées. Les troncs sont sortis pour être vendus en bois énergie.
Pour la réalisation de ce chantier, les moyens matériels et humains du lycée forestier de Meymac et du lycée agricole de Neuvic s'allient. Deux tracteurs agricoles (dont un adapté en forestier), un treuil 3 points avec du câble synthétique, un broyeur de branches, des tronçonneuses et beaucoup de courage sont nécessaires pour la réalisation du projet.
Pour le respect du site, l'huile de chaine ainsi que le carburant pour les tronçonneuses sont biodégradables.
Les arbres sont abattus et treuillés entiers dans une zone moins humide (moins sensible). Là ils sont ébranchés, les branches sont broyées. Les troncs sont sortis pour être vendus en bois énergie.
Résultats
L'ouverture et le respect du milieu répondent au cahier des charges fixé par le donneur d'ordres.
L'ouverture et le respect du milieu répondent au cahier des charges fixé par le donneur d'ordres.
Utilisation pédagogique
La Communauté de Communes de Ventadour et l'EPLEFPA de Haute Corrèze et plus spécifiquement le site du lycée agricole de Neuvic collaborent sur ce chantier.
Le chantier est réalisé par les apprenants du lycée agricole selon les consignes du donneur d'ordres.
Une présentation du chantier, de ses contraintes, de ses conséquences sur l'environnement ainsi que de la collaboration des différents organismes a été réalisé par la Communauté de communes auprès des apprenants.
Les apprenants travaillent dans une zone humide sensible. Cela leur fait approcher les contraintes techniques imposées par un tel site. Dans leur vie professionnelle, ils seront amenés à gérer de telles zones.
La Communauté de Communes de Ventadour et l'EPLEFPA de Haute Corrèze et plus spécifiquement le site du lycée agricole de Neuvic collaborent sur ce chantier.
Le chantier est réalisé par les apprenants du lycée agricole selon les consignes du donneur d'ordres.
Une présentation du chantier, de ses contraintes, de ses conséquences sur l'environnement ainsi que de la collaboration des différents organismes a été réalisé par la Communauté de communes auprès des apprenants.
Les apprenants travaillent dans une zone humide sensible. Cela leur fait approcher les contraintes techniques imposées par un tel site. Dans leur vie professionnelle, ils seront amenés à gérer de telles zones.
Autre valorisation
Ce chantier permet aux collectivités d'appréhender concrètement ce que signifie la restauration d'une zone humide.
Ce premier chantier permettra de montrer les compétences de l'établissement dans ce domaine.
Ce chantier permet aux collectivités d'appréhender concrètement ce que signifie la restauration d'une zone humide.
Ce premier chantier permettra de montrer les compétences de l'établissement dans ce domaine.
Calendrier
Le chantier de 10 ha se réalise en au moins 3 tranches:
- première tranche de 4 ha sur l'année scolaire 2012/2013
- seconde tranche de 3 ha sur l'année scolaire 2013/2014
- la dernière tranche sur l'année scolaire 2014/2015.
- première tranche de 4 ha sur l'année scolaire 2012/2013
- seconde tranche de 3 ha sur l'année scolaire 2013/2014
- la dernière tranche sur l'année scolaire 2014/2015.
Perspective
Avec l'ouverture du site par le débroussaillage et éclaircie, l'herbe devrait pousser en quantité pour permettre un apport minimum aux animaux à l'entretien.
Les résultats seront visibles au bout d'une année.
Avec l'ouverture du site par le débroussaillage et éclaircie, l'herbe devrait pousser en quantité pour permettre un apport minimum aux animaux à l'entretien.
Les résultats seront visibles au bout d'une année.
Partenariats techniques/financiers
Pour le côté technique :
- Communauté de communes de Ventadour
- CEN Limousin
Pour le côté financier:
- Conseil général de la Corrèze : 20%
- Agence de l'eau Adour Garonne: 30%
- Conseil Régional du Limousin : 30%
- Autofinancement : 20%
Pour le côté technique :
- Communauté de communes de Ventadour
- CEN Limousin
Pour le côté financier:
- Conseil général de la Corrèze : 20%
- Agence de l'eau Adour Garonne: 30%
- Conseil Régional du Limousin : 30%
- Autofinancement : 20%
Fichier : fichierinitiative1_100_5544.JPG
Télécharger
Fichier : fichierinitiative2_DSCF2627.JPG
Télécharger
Fichier : fichierinitiative3_DSCF4103.JPG
Télécharger
Fichier : fichierinitiative4_DSCF4117.JPG
Télécharger
Sciences participatives : suivi de la qualité de cours d'eau (Morlaix - Finistère)
Nom de la structure
EPLEFPA de Châteaulin Morlaix Kerliver
Téléphone
02 98 72 03 22
Contact (courriel)
jerome.le-borgne@educagri.fr
Contact2 (courriel)
karine.voogden@educagri.fr
Code postal
29600
Ville
Suscinio
Département
Finistère
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- milieu naturel
- qualité de l'eau
Contexte
Travailler l’engagement citoyen, la préservation de l’environnement, ou montrer l’importance de disposer de connaissances scientifiques pour l’action, ne sont pas des sujets toujours simples à aborder en formation. Souvent associés par les élèves à ces « savoirs théoriques qui ne serviront pas dans le monde du travail », les disciplines comme la biologie, l’écologie, la physique, ou encore la chimie peinent parfois à faire spontanément sens à leur yeux. L’établissement de Chateaulin-Morlaix- Kerliver étant engagé depuis plus de 15 ans dans le réseau de science participative Ecoflux, certains enseignants et techniciens de laboratoires s’appuient sur ce partenariat pour créer des situations pédagogiques riches et ouvertes pour intéresser leurs élèves aux sciences.
Travailler l’engagement citoyen, la préservation de l’environnement, ou montrer l’importance de disposer de connaissances scientifiques pour l’action, ne sont pas des sujets toujours simples à aborder en formation. Souvent associés par les élèves à ces « savoirs théoriques qui ne serviront pas dans le monde du travail », les disciplines comme la biologie, l’écologie, la physique, ou encore la chimie peinent parfois à faire spontanément sens à leur yeux. L’établissement de Chateaulin-Morlaix- Kerliver étant engagé depuis plus de 15 ans dans le réseau de science participative Ecoflux, certains enseignants et techniciens de laboratoires s’appuient sur ce partenariat pour créer des situations pédagogiques riches et ouvertes pour intéresser leurs élèves aux sciences.
Objectif
Intéresser les élèves à l’acquisition de connaissances scientifiques avec un réseau de sciences participatives
Intéresser les élèves à l’acquisition de connaissances scientifiques avec un réseau de sciences participatives
Description de l'action
Dans le cadre d'un module d’initiative locale (MIL) de 30 h « systèmes d’information géographique et analyses scientifiques" destiné à faire acquérir aux étudiants BTS Gestion et protection de la nature des compétences en matières d’utilisation d’un SIG, mais aussi des connaissances scientifiques.
De septembre à novembre, les étudiants se préparent pour réaliser leur travail :
- Ils prennent connaissance de la commande d’Ecoflux via l’intervention de l’animatrice qui replace le contexte, les différents dispositifs qui encadrent les politiques de l’eau (de la Directive Cadre Européenne jusqu’au niveau local), les enjeux sur les nitrates, phosphates et silicates et le processus d’eutrophisation, puis le protocole scientifique à suivre,
- Ils étudient les différents éléments physiques et chimiques en jeu pour comprendre la problématique d’ensemble,
- Ils s’entraînent à effectuer les prélèvements et à maîtriser le protocole établi par Ecoflux avec la technicienne de laboratoire, ainsi qu’à utiliser le spectrophotomètre en autonomie,
- Ils prennent connaissances des outils de géolocalisation et le logiciel de SIG,
- Et débattent à partir des cartes des différents itinéraires préparés par l'enseignant de physique-chimie des lieux qui sont possiblement intéressants pour réaliser les prélèvements.
Une fois prêts, les étudiants se trouvent en charge d’un itinéraire sur lequel ils doivent réaliser 5 prélèvements en autonomie.
Enfin, à l’aide du pocket PC, ils prennent des photos et font des commentaires utiles à leur dossier.
A l’issue de leur MIL, ils doivent élaborer un dossier en groupe, et présentent leurs résultats dans le cadre d’une situation professionnelle simulée avec les enseignants et un professionnel du syndicat mixte du Trégor.
Dans le cadre d'un module d’initiative locale (MIL) de 30 h « systèmes d’information géographique et analyses scientifiques" destiné à faire acquérir aux étudiants BTS Gestion et protection de la nature des compétences en matières d’utilisation d’un SIG, mais aussi des connaissances scientifiques.
De septembre à novembre, les étudiants se préparent pour réaliser leur travail :
- Ils prennent connaissance de la commande d’Ecoflux via l’intervention de l’animatrice qui replace le contexte, les différents dispositifs qui encadrent les politiques de l’eau (de la Directive Cadre Européenne jusqu’au niveau local), les enjeux sur les nitrates, phosphates et silicates et le processus d’eutrophisation, puis le protocole scientifique à suivre,
- Ils étudient les différents éléments physiques et chimiques en jeu pour comprendre la problématique d’ensemble,
- Ils s’entraînent à effectuer les prélèvements et à maîtriser le protocole établi par Ecoflux avec la technicienne de laboratoire, ainsi qu’à utiliser le spectrophotomètre en autonomie,
- Ils prennent connaissances des outils de géolocalisation et le logiciel de SIG,
- Et débattent à partir des cartes des différents itinéraires préparés par l'enseignant de physique-chimie des lieux qui sont possiblement intéressants pour réaliser les prélèvements.
Une fois prêts, les étudiants se trouvent en charge d’un itinéraire sur lequel ils doivent réaliser 5 prélèvements en autonomie.
Enfin, à l’aide du pocket PC, ils prennent des photos et font des commentaires utiles à leur dossier.
A l’issue de leur MIL, ils doivent élaborer un dossier en groupe, et présentent leurs résultats dans le cadre d’une situation professionnelle simulée avec les enseignants et un professionnel du syndicat mixte du Trégor.
Utilisation pédagogique
Avec leur dossier, cet entretien tient lieu d’épreuve de CCF du MIL
Avec leur dossier, cet entretien tient lieu d’épreuve de CCF du MIL
Autre valorisation
Chaque année, afin de valoriser et de reconnaître l’engagement des élèves, Ecoflux organise avec les enseignants des lycées bretons impliqués un suivi pédagogique et les projets pédagogiques sont alors présentés lors d’une journée de rencontre annuelle appelée la rencontre inter-établissements.
Chaque année, afin de valoriser et de reconnaître l’engagement des élèves, Ecoflux organise avec les enseignants des lycées bretons impliqués un suivi pédagogique et les projets pédagogiques sont alors présentés lors d’une journée de rencontre annuelle appelée la rencontre inter-établissements.
Perspective
- informer voire coopérer avec les différents propriétaires des terrains qui longent les cours d’eau du bassin versant et apprendre à prendre le temps de travailler avec eux
- associer sur une partie du travail les étudiants de BTSA GPN et les élèves de BAC PRO CGEA
- informer voire coopérer avec les différents propriétaires des terrains qui longent les cours d’eau du bassin versant et apprendre à prendre le temps de travailler avec eux
- associer sur une partie du travail les étudiants de BTSA GPN et les élèves de BAC PRO CGEA
Partenariats techniques/financiers
Réseau Ecoflux
Réseau Ecoflux
Fichier : fichierinitiative1_progression-mil-SIGAS.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative2_evaluation_MIL_SIGAS.pdf
Télécharger

Suivi de la qualité des eaux d'un captage d'eau potable (Vienne - Isère ; St Genis Laval - Rhône)
Nom de la structure
EPLEFPAs Vienne et St Genis Laval
Téléphone
04 78 56 75 75
Contact (courriel)
sophie.bruder@educagri.fr
Contact2 (courriel)
pierre.kabacinski@educagri.fr
Code postal
69230
Ville
Saint Genis Laval
Département
Rhône
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- qualité de l'eau
Contexte
Le captage d'Agnin (Isère) participe à l'alimentation en eau potable un réseau de 330 km sur 8 communes de l'agglomération de Roussillon (environ 35.000 habitants). Situé à quelques km du fleuve Rhône au sud de l'agglomération, il est alimenté par de l'eau de 3 provenances différentes :
- une nappe fluvio-glaciaire alimentant un forage de 12 m de profondeur.
- 2 autres nappes pour lesquelles il se situe en bordure du bassin-versant, elles alimentent un puits de 5 m.
- les eaux de ruissellement provenant d'une source et captées par un drain.
Le bassin versant correspondant au forage représente 1.500 ha dont 1029 ha de SAU sur laquelle on recense 44 agriculteurs. Les systèmes agricoles dominants sont des associations céréales/arboriculture et/ou cultures sous tunnels.
Les deux problématiques principales sont :
- la présence de nitrates dans toutes les eaux à des doses qui peuvent périodiquement menacer la potabilité de l'eau, en particulier dans le forage par des pics supérieurs à la norme en vigueur (50 mg NO3/l),
- le cumul de doses très faibles de pesticides pouvant menacer la norme correspondante dans l'eau potable (0,5 ug/L)
Cela a conduit les autorités à classer ce captage comme prioritaire dans le cadre du grenelle de l'environnement en 2009.
Des MAET ont été mises en place :
Réduction des fertilisations azotées à une dose maximale de 150 kg N/ha/an
Remise de surfaces en herbe pour une durée minimale de 5 ans. 40 ha ont été souscrits par les agriculteurs depuis 2014.
Ces mesures ont commencé à porter leur fruits comme le montrent les suivis d'analyses.
En 2016, 12 molécules différentes de pesticides ont été détectées ; 9 d'entre elles sont régulièrement retrouvées dans l'eau. C'est là que se situe principalement le problème, car si aucune molécule n'atteint les 0,1 µg/l, le nombre de molécules trouvées, d'ailleurs en augmentation, fait que leur somme peut arriver à dépasser la 2ème norme de 0,5 µg/l pour l'ensemble des molécules et empêcher la distribution de l'eau.
Le suivi fin de ce captage présente donc un grand intérêt et un enjeu fort pour l'exploitant, le SIGEARPE (Syndicat Intercommunal de Gestion des Eaux de Roussillon, Péage et Environs). L'un des problèmes que rencontre l'exploitant est en effet la fiabilité des analyses relatives aux molécules phyto....
- une nappe fluvio-glaciaire alimentant un forage de 12 m de profondeur.
- 2 autres nappes pour lesquelles il se situe en bordure du bassin-versant, elles alimentent un puits de 5 m.
- les eaux de ruissellement provenant d'une source et captées par un drain.
Le bassin versant correspondant au forage représente 1.500 ha dont 1029 ha de SAU sur laquelle on recense 44 agriculteurs. Les systèmes agricoles dominants sont des associations céréales/arboriculture et/ou cultures sous tunnels.
Les deux problématiques principales sont :
- la présence de nitrates dans toutes les eaux à des doses qui peuvent périodiquement menacer la potabilité de l'eau, en particulier dans le forage par des pics supérieurs à la norme en vigueur (50 mg NO3/l),
- le cumul de doses très faibles de pesticides pouvant menacer la norme correspondante dans l'eau potable (0,5 ug/L)
Cela a conduit les autorités à classer ce captage comme prioritaire dans le cadre du grenelle de l'environnement en 2009.
Des MAET ont été mises en place :
Réduction des fertilisations azotées à une dose maximale de 150 kg N/ha/an
Remise de surfaces en herbe pour une durée minimale de 5 ans. 40 ha ont été souscrits par les agriculteurs depuis 2014.
Ces mesures ont commencé à porter leur fruits comme le montrent les suivis d'analyses.
En 2016, 12 molécules différentes de pesticides ont été détectées ; 9 d'entre elles sont régulièrement retrouvées dans l'eau. C'est là que se situe principalement le problème, car si aucune molécule n'atteint les 0,1 µg/l, le nombre de molécules trouvées, d'ailleurs en augmentation, fait que leur somme peut arriver à dépasser la 2ème norme de 0,5 µg/l pour l'ensemble des molécules et empêcher la distribution de l'eau.
Le suivi fin de ce captage présente donc un grand intérêt et un enjeu fort pour l'exploitant, le SIGEARPE (Syndicat Intercommunal de Gestion des Eaux de Roussillon, Péage et Environs). L'un des problèmes que rencontre l'exploitant est en effet la fiabilité des analyses relatives aux molécules phyto....
Objectif
- mettre en synergie les compétences complémentaires des 2 établissements (analyses de terrain et de laboratoire) sur une problématique de suivi de qualité des eaux d'un captage et de mise au point de méthodes de dosages sur des molécules très particulières (pesticides)
- permettre la rencontre et l'échange inter-établissements entre étudiants de filières ANABIOTEC et GEMEAU
- permettre la rencontre et l'échange inter-établissements entre étudiants de filières ANABIOTEC et GEMEAU
Description de l'action
Le partenariat entre les LEGTA de St Genis Laval et de Vienne permet la mise en oeuvre de compétences complémentaires :
- la compétence de terrain apportée par l'EPLEFPA de Vienne. Les BTS GEMEAU d'Agrotec trouvent là un cas concret en grandeur nature. Outre les prélèvements d'eau et l'interprétation des résultats d'analyses, ils suivront et développeront les actions sur le terrain en direction des agriculteurs en partenariat avec les techniciens du SIGEARPE et la chambre d'agriculture.
- la compétence de la capacité d' analyse apportée par l'EPLEFPA de St Genis Laval. Les BTS ANABIOTEC ont ainsi un support de terrain donnant du sens aux analyses pratiquées. Ils peuvent également rechercher des protocoles d'analyse fiables pour chaque molécule recensée, en particulier les pesticides.
- la compétence de terrain apportée par l'EPLEFPA de Vienne. Les BTS GEMEAU d'Agrotec trouvent là un cas concret en grandeur nature. Outre les prélèvements d'eau et l'interprétation des résultats d'analyses, ils suivront et développeront les actions sur le terrain en direction des agriculteurs en partenariat avec les techniciens du SIGEARPE et la chambre d'agriculture.
- la compétence de la capacité d' analyse apportée par l'EPLEFPA de St Genis Laval. Les BTS ANABIOTEC ont ainsi un support de terrain donnant du sens aux analyses pratiquées. Ils peuvent également rechercher des protocoles d'analyse fiables pour chaque molécule recensée, en particulier les pesticides.
Utilisation pédagogique
2 journées de rencontres et de pratiques croisées entre les étudiants 2e année de Vienne et de St Genis Laval :
- première journée de terrain, pilotée par les GEMEAU, sur le site du captage d'Agnin (avec rencontre d'un technicien du SIGEARPE et d'un agriculteur) puis sur le site de l'établissement (exposé de la problématique et visite des installations hydrauliques)
- deuxième journée de laboratoire, pilotée par les ANABIOTEC, sur le site de St Genis Laval (visite des différents labos puis TP d'analyses en physique-chimie - dosage HPLC de l'atrazine et dérivés, dosage spectrophotométrique des nitrites et dosage d'ions sodium et potassium dans l'eau par spectrophotométrie de flamme - et de microbiologie - filtration et dilution d'eau, mise en culture et dénombrements)
- première journée de terrain, pilotée par les GEMEAU, sur le site du captage d'Agnin (avec rencontre d'un technicien du SIGEARPE et d'un agriculteur) puis sur le site de l'établissement (exposé de la problématique et visite des installations hydrauliques)
- deuxième journée de laboratoire, pilotée par les ANABIOTEC, sur le site de St Genis Laval (visite des différents labos puis TP d'analyses en physique-chimie - dosage HPLC de l'atrazine et dérivés, dosage spectrophotométrique des nitrites et dosage d'ions sodium et potassium dans l'eau par spectrophotométrie de flamme - et de microbiologie - filtration et dilution d'eau, mise en culture et dénombrements)
Autre valorisation
Lien avec le module M58 pour les BTSA ANABIOTEC (mise en œuvre d'un protocole expérimental, en l’occurrence sur le dosage de doses infinitésimales de différentes molécules de pesticides)
posters (2020) : cf. pj
posters (2020) : cf. pj
Perspective
Pour les dosages de pesticides, ils se devront se faire par HPLC couplée à une spectrophotométrie de masse (MS) que l'EPLEFPA de Saint-Genis Laval a pour but de développer pour ses étudiants dans les années qui arrivent...
Partenariats techniques/financiers
SIGEARPE
chambre d'agriculture
chambre d'agriculture
Lien vers vidéo de présentation (1)
https://www.dailymotion.com/video/k3E7NDdIVzpvNhq9FK2
Vidéo de présentation (1)
Systèmes de Cultures Innovants économes en intrants : élaboration de références sur le bassin versant de l'Yerres (Brie-Comte-Robert - Seine et Marne)
Nom de la structure
EPLEFPA BOUGAINVILLE
Téléphone
01 60 62 33 00
Contact (courriel)
Samuel.QUINTON@educagri.fr
Site Web
http://www.lycee-bougainville.fr
Code postal
77170
Ville
BRIE COMTE ROBERT
Département
Seine-et-Marne
Type d'initiative
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
L'exploitation, située sur un territoire à fort enjeu sur la qualité de l'eau, va tester des systèmes de cultures dont les performances permettront d'assurer la durabilité. Elle compte créer des références pour faire évoluer les pratiques des agriculteurs du territoire dans le cadre du Plan ECOPHYTO 2018 et utilisables par les enseignants de l'EPL dans le cadre de leurs activités pédagogiques.
L'exploitation, située sur un territoire à fort enjeu sur la qualité de l'eau, va tester des systèmes de cultures dont les performances permettront d'assurer la durabilité. Elle compte créer des références pour faire évoluer les pratiques des agriculteurs du territoire dans le cadre du Plan ECOPHYTO 2018 et utilisables par les enseignants de l'EPL dans le cadre de leurs activités pédagogiques.
Description de l'action
- état des lieux des références agronomiques issues de l'exploitation et des pratiques pédagogiques liées à la thématique principale : synthèse des résultats d'essais menée par la chambre d'agriculture de Seine-et-Marne sur le site depuis 2008, complétée par une synthèse bibliographique et des entretiens auprès d'experts dans le domaine. Une enquête auprès des enseignants et formateurs de l'EPL sera également effectuée pour connaître si et comment ils intègrent la notion d'agriculture durable en générale et la réductions des intrants en particulier dans leurs enseignements.
- évolution des systèmes de cultures de l'exploitation de l'EPL et innovations pédagogiques sur le lycée et le CFFPA.
- communication en interne et en externe, sur la méthode mise en oeuvre au sein de l'EPL et les résultats obtenus tant au niveau pédagogique qu'au niveau agronomique. La stratégie de communication vise à présenter la démarche et les résultats obtenus auprès d'autres EPL, à rendre plus visible l'EPL auprès des professionnels agricoles, à faire connaître les formations et les innovations pédagogiques associées sur le territoire de l'EPL.
Utilisation pédagogique
- implication d'enseignants volontaires et des étudiants de BTSA ACSE dans tous les axes du projet (communication, organisation des Journées portes ouvertes, projet "Champs et lycées", groupes de travail,...)
- toutes les activités s'intègrent dans les référentiels et le projet d'établissement.
Autre valorisation
Communication (plaquettes, articles dans presse professionnelle, rencontres professionnelles : Festival de la Terre, Mini-salon agricole de Brie-Comte-Robert...)
Calendrier
- 2010-2011 : état des lieux (diagnostic, enquêtes), démarrage du concours "champs et lycées", organisation d'une journée portes ouvertes, plaquette synthétisant les résultats techniques
- 2011-2012 : finalisation du concours, synthèse de l'enquête sur les pratiques pédagogiques, groupes de travail "évolution des systèmes de cultures" et "innovations pédagogiques"
- 2010-2013 : suivi des innovations pédagogiques, plan de communication
Partenariats techniques/financiers
- Chambre d'agriculture de Seine-et-Marne, agriculteurs du territoire
- INRA Dijon, INRA Grignon
- Agro Transfert
- DDT
- Agence de l'eau Seine-Normandie
- Aquibrie
- Conseil général de Seine-et-Marne
Traitement d'effluents vinicoles (Avize - Marne)
Nom de la structure
Lycée Viticole de la Champagne (EPLEFPA d'Avize)
Téléphone
03 26 57 50 42
Contact (courriel)
Nicolas.ROBERT@educagri.fr
Contact2 (courriel)
Michel.VERON@educagri.fr
Code postal
51190
Ville
Avize
Département
Marne
Type d'initiative
- traitement des effluents
- qualité de l'eau
Contexte
De 1995 à 2008, le Lycée Viticole de la Champagne, a mené au niveau de sa coopérative vinicole, le Champagne SANGER, une démarche expérimentale, visant à l'épuration totale de ses effluents vinicoles.
De 1995 à 2008, le Lycée Viticole de la Champagne, a mené au niveau de sa coopérative vinicole, le Champagne SANGER, une démarche expérimentale, visant à l'épuration totale de ses effluents vinicoles.
Description de l'action
1995 - 2000 : traitement des effluents vinicoles. La première partie du projet, qui fait l'objet du premier poster (télécharger ci après), a consisté à mettre en place un système d'épuration et de recyclage performant des 80 m3 d'eau rejetée par la coopérative.
2005 - 2008 : traitement des boues d'effluents vinicoles. La deuxième partie du projet, qui fait l'objet du deuxième poster (télécharger ci après), a eu pour but d'étudier le traitement et le recyclage des boues issues du traitement des effluents vinicoles, pour aller jusqu'au bout de la démarche d'épuration des effluents vinicoles.
2005 - 2008 : traitement des boues d'effluents vinicoles. La deuxième partie du projet, qui fait l'objet du deuxième poster (télécharger ci après), a eu pour but d'étudier le traitement et le recyclage des boues issues du traitement des effluents vinicoles, pour aller jusqu'au bout de la démarche d'épuration des effluents vinicoles.
Résultats
- Traitement et recyclage complet des effluents vinicoles.
- Utilisation pédagogique
- Sensibilisation des élèves et étudiants par rapport à une démarche environnementale
- Sensibilisation des professionnels
Partenariats techniques/financiers
Cet essai a été mené dans le cadre du « Réseau Champardennais des Exploitations des Lycées Agricoles »
Cet essai a été mené dans le cadre du « Réseau Champardennais des Exploitations des Lycées Agricoles »
- Ministère de l'Agriculture et de la pêche
- Région Champagne-Ardenne
- Lycée Viticole de la Champagne et son exploitation
- Champagne SANGER
- FEOGA
- Agence de l'Eau Seine Normandie
- ADEME
Fichier : fichierinitiative1_poster_Avize_effluents_vini.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative2_poster_Avize_boues.pdf
Télécharger
Transition agroécologique en faveur du sol, de la biodiversité et de la protection de l'eau (Château-Salins - Moselle)
Nom de la structure
EPLEFPA Château-Salins
Téléphone
03 87 05 12 39
Contact (courriel)
marie.laflotte@educagri.fr
Code postal
57170
Ville
Château-Salins
Département
Moselle
Type d'initiative
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
Partant du constat initial en 2016 que le système d’exploitation de la ferme du lycée agricole (polyculture-élevage bovin lait + écurie active, 175 ha) était arrivé "au bout" (monoculture de mais, colza-blé-orge), le besoin d'une transition forte a été posé et une mutation opérée, pour améliorer la viabilité et la pérennité du site par les infrastructures agroécologiques et la diversification. La ferme déploie donc une démarche de gestion globale guidée par la nécessité d’apporter (rapidement) des réponses fortes aux enjeux de stockage carbone, de préservation des ressources en eau (le site est parcouru par La petite Seille, en zone natura 2000 au sein du Parc naturel régional de Lorraine), d'autonomie fourragère, d’alimentation locale de qualité, de renouvellement des générations, ...
Objectif
Allier rentabilité, santé du vivant, cadre de vie et adaptation au changement climatique
Description de l'action
- augmentation des surfaces en herbe, passées de 54% à 85% avec la mise en place d’un pâturage tournant dynamique favorable à une production d’herbe en quantité et qualité et assurant une autonomie fourragère de l’exploitation.
- plantation de haies, développement de l’agroforesterie fruitière intra-parcellaire (pour fournir nôtre restauration collective en fruits locaux et assurer le bien être en été des animaux au pâturage), gestion de 175 ha en agriculture biologique (arrêt des intrants de synthèse)
- réalisation de fauches tardives (au 1er juillet) pour la préservation de la flore et du courlis cendré
- plantation de haies, développement de l’agroforesterie fruitière intra-parcellaire (pour fournir nôtre restauration collective en fruits locaux et assurer le bien être en été des animaux au pâturage), gestion de 175 ha en agriculture biologique (arrêt des intrants de synthèse)
- réalisation de fauches tardives (au 1er juillet) pour la préservation de la flore et du courlis cendré
Résultats
- les observations réalisées démontrent une augmentation des insectes, des auxiliaires et une diversification de la flore
- les produits de l’exploitation (viande, produits laitiers, fruits) sont valorisés à la cantine scolaire - des contacts ont été pris pour étendre cette diffusion dans le cadre du plan d’alimentation territorial
- maintien des paysages et des traditionnels pré-vergers lorrains pour le tourisme et le bien vivre des habitants
- qualité de l'air
- les produits de l’exploitation (viande, produits laitiers, fruits) sont valorisés à la cantine scolaire - des contacts ont été pris pour étendre cette diffusion dans le cadre du plan d’alimentation territorial
- maintien des paysages et des traditionnels pré-vergers lorrains pour le tourisme et le bien vivre des habitants
- qualité de l'air
Utilisation pédagogique
La force de notre site est la complémentarité du travail entre l'équipe de la ferme, l'équipe enseignante et les élèves qui n'hésitent pas à se porter volontaires sur de nombreux projets participatifs.
Autre valorisation
Grand prix des Trophées de l'eau 2023 de la part de l'Agence de l'eau Rhin Meuse : voir la vidéo de promotion (2023)
article "Château-Salins : une journée technique pour concilier agriculture et préservation de l’environnement" (2022)
article "Château-Salins : redonner le goût à l’élevage laitier" (2022)
vidéo : "Transition agroécologique et adaptation au changement climatique sur l’exploitation agricole (ferme de la Marchande)" (2022)
article "Château-Salins : une journée technique pour concilier agriculture et préservation de l’environnement" (2022)
article "Château-Salins : redonner le goût à l’élevage laitier" (2022)
vidéo : "Transition agroécologique et adaptation au changement climatique sur l’exploitation agricole (ferme de la Marchande)" (2022)
Perspective
Développement de l'agroforesterie intra-parcellaire, projet d'étude sur les baissières (sur les parcelles les plus séchantes), construction d'un séchage en grange solaire pour améliorer la qualité des fourrages et pérenniser nos surfaces en prairies ainsi que la qualité du lait produit pour le futur projet de transformation laitière.
Projet national en cours (CASDAR Praidiv : impact de la flore de prairies diversifiées sur la santé animale).
Projet national en cours (CASDAR Praidiv : impact de la flore de prairies diversifiées sur la santé animale).
Partenariats techniques/financiers
Parc naturel Régional de Lorraine, Chambre Régionale d'Agriculture, Chambre d'agriculture de Moselle, GAB57, Bio en Grand Est, Région Grand Est, CAAA, BTPL, Aquaseille, Agri mieux
Agence de l'eau Rhin Meuse
Agence de l'eau Rhin Meuse


Lien vers vidéo de présentation (1)
https://www.dailymotion.com/video/x8pg6xb
Lien vers vidéo de présentation(2)
https://www.youtube.com/watch?v=rBPuR5aGmAE
Vidéo de présentation (1)
Vidéo de présentation (2)
Une ZTHA pour limiter les transferts de pesticides (Yvetot - Seine Maritime)
Nom de la structure
EPLEFPA de Seine Maritime
Téléphone
02 35 95 94 80
Contact (courriel)
arnaud.izabelle@educagri.fr
Contact2 (courriel)
olivier.leconte@educagri.fr
Contact3 (courriel)
thierry.degrave@educagri.fr
Site Web
http://www.eplefpa76.educagri.fr
Code postal
76196
Ville
Yvetot
Département
Seine-Maritime
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- milieu naturel
- qualité de l'eau
Contexte
En Normandie, 55 % des masses d’eau souterraines sont sous le risque de pollutions ponctuelles de la ressource par ruissellements de pesticides. La lutte contre ce risque s’appuie sur deux volets complémentaires : la limitation des usages d’une part et la mise en place d’aménagements pour intercepter les transferts par écoulement d’autre part.
La zone tampon humide artificielle aménagée depuis 2015 (par l'association AREAS) est située sur la plaine dite « du parc », dans la mouillère en amont de la mare sur une parcelle du lycée située sur la commune de Valliquerville. Elle capte un petit bassin versant de 32 ha, entièrement cultivé par 3 agriculteurs. L’aménagement, implanté de manière à collecter les eaux de ruissellement du bassin versant, combine plusieurs processus qui participent à la dégradation de pesticides tels que l’adsorption sur la matière organique, l’absorption par les végétaux, la photodégradation ainsi que la dégradation par les micro-organismes associés aux plantes.
La zone tampon humide artificielle aménagée depuis 2015 (par l'association AREAS) est située sur la plaine dite « du parc », dans la mouillère en amont de la mare sur une parcelle du lycée située sur la commune de Valliquerville. Elle capte un petit bassin versant de 32 ha, entièrement cultivé par 3 agriculteurs. L’aménagement, implanté de manière à collecter les eaux de ruissellement du bassin versant, combine plusieurs processus qui participent à la dégradation de pesticides tels que l’adsorption sur la matière organique, l’absorption par les végétaux, la photodégradation ainsi que la dégradation par les micro-organismes associés aux plantes.
Objectif
- protéger la ressource en eau d'un bassin d’alimentation de captage classé Grenelle (prioritaire)
- favoriser la biodiversité
- créer un outil pédagogique à l’attention des responsables de l’aménagement du territoire, des étudiants, des élus et des animateurs de syndicats de bassin versant…
Description de l'action
La zone tampon représente 2 500 m² (soit 0.8 % de la surface du bassin versant).
Elle a une capacité de stockage de 1 000 m3 ce qui lui permet de stocker une lame ruisselée de 3 mm/ha (crue annuelle).
Le débit régulé en sortie de la zone tampon (débit de fuite vres mare existante) est calibré de manière à obtenir un temps de séjour de l’eau de 8 à 10 jours pour une hauteur d'eau de 20 à 70 cm, ce qui correspond au temps nécessaire pour pouvoir abattre de manière significative les pesticides présents dans les eaux de ruissellement et avant leur infiltration.
Elle a une capacité de stockage de 1 000 m3 ce qui lui permet de stocker une lame ruisselée de 3 mm/ha (crue annuelle).
Le débit régulé en sortie de la zone tampon (débit de fuite vres mare existante) est calibré de manière à obtenir un temps de séjour de l’eau de 8 à 10 jours pour une hauteur d'eau de 20 à 70 cm, ce qui correspond au temps nécessaire pour pouvoir abattre de manière significative les pesticides présents dans les eaux de ruissellement et avant leur infiltration.
Résultats
- suivi de la biodiversité (faune et flore) sur la mare en 2015-2017 et sur la ZTHA en 2018, avec le même protocole
- mesures de débits et prélèvements automatiques : après un hiver 2016-2017 très sec, la remplissage a été correct en 2017-2018, permettant 3 périodes de prélèvements (mi-décembre 2017, fin janvier et fin avril 2018). 21 molécules de pesticides ont été quantifiées au total (dont glyphosate et AMPA récurrents), en rapport avec les produits épandus par les agriculteurs, et avec des concentrations inférieures en sortie (dégradation et dilution)
- fiabilisation des sites de mesures réalisée fin 2018
- mesures de débits et prélèvements automatiques : après un hiver 2016-2017 très sec, la remplissage a été correct en 2017-2018, permettant 3 périodes de prélèvements (mi-décembre 2017, fin janvier et fin avril 2018). 21 molécules de pesticides ont été quantifiées au total (dont glyphosate et AMPA récurrents), en rapport avec les produits épandus par les agriculteurs, et avec des concentrations inférieures en sortie (dégradation et dilution)
- fiabilisation des sites de mesures réalisée fin 2018
Utilisation pédagogique
La ZTHA est utilisée comme support pédagogique vers les apprenants
Autre valorisation
- articles presse : Région Normandie, Agri-Culture.fr, Paris Normandie, EAP Normandie
- panneau d'information in situ
- journée de démonstration vers les professionnels du territoire
- organisation en 2019, à l'occasion du centenaire de l'établissement, d'une journée autour des enjeux de l'eau avec des conférences
- panneau d'information in situ
- journée de démonstration vers les professionnels du territoire
- organisation en 2019, à l'occasion du centenaire de l'établissement, d'une journée autour des enjeux de l'eau avec des conférences
Calendrier
mise en service et inauguration septembre 2017, fin du financement de l'AREAS en 2019
Perspective
- recherche de financements pour continuer l'appui de l'AREAS, notamment sur la poursuite sur plusieurs années des mesures et de prélèvements
- entretien de la ZTHA et des abords par l'exploitation (écopâturage)
- poursuite du suivi de la biodiversité, afin de disposer d'une évolution sur le long terme
- appropriation complète par l'ensemble du personnel et des apprenants de l'établissement (par la création de supports pédagogiques notamment)
- création de références permettant de mettre en place d'autres ZTHA en région Normandie
- entretien de la ZTHA et des abords par l'exploitation (écopâturage)
- poursuite du suivi de la biodiversité, afin de disposer d'une évolution sur le long terme
- appropriation complète par l'ensemble du personnel et des apprenants de l'établissement (par la création de supports pédagogiques notamment)
- création de références permettant de mettre en place d'autres ZTHA en région Normandie
Partenariats techniques/financiers
- Association AREAS
- Agence de l'eau Seine-Normandie
- Conseil régional Normandie
- Fédération de chasse 76 et bureau d'étude Fauna Flora


Unité mobile de prétraitement des graisses animales (Albi - Tarn)
Nom de la structure
PFT GH2O - EPL Albi
Téléphone
05 63 49 43 70
Contact (courriel)
nicolas.alvarez@educagri.fr
Code postal
81000
Ville
Albi
Département
Tarn
Type d'initiative
- traitement des effluents
- qualité de l'eau
Contexte
Les ateliers de transformation agroalimentaire et les restaurants sont confrontés à l'élimination des graisses piégées dans leur ouvrage de prétraitement des effluents (généralement un «bac à graisses»), qui ne peuvent être déversées directement dans le réseau d'assainissement (colmatage et incompatibilité avec les procédés d'épuration) et doivent faire l'objet d'un traitement spécifique au coût élevé (plus de 120 euros / tonne).
Les utilisateurs cibles sont les boucheries charcuteries artisanales, les ateliers fermiers de transformation animale, les PME PMI agroalimentaires, les restaurants et cuisines centrales
Les utilisateurs cibles sont les boucheries charcuteries artisanales, les ateliers fermiers de transformation animale, les PME PMI agroalimentaires, les restaurants et cuisines centrales
Description de l'action
Une unité mobile de prétraitement des graisses animales a été conçue et réalisée par la PFT GH2O d'Albi. L'idée est de transformer le contenu des bacs à graisses par saponification, en vue d'un rejet direct en réseau ou station d'épuration, les graisses saponifiées étant facilement biodégradables par les procédés de traitement biologiques des eaux usées. On économise ainsi l'intervention d'un hydrocureur ainsi que les frais de transport et d'admission dans une unité spécialisée de traitement des graisses.
Le second prototype, actuellement opérationnel, comporte une pompe, une cuve, un système automatisé d'injection et de mélange de soude, le tout embarqué sur un véhicule utilitaire afin de pouvoir réaliser des tournées.
Le second prototype, actuellement opérationnel, comporte une pompe, une cuve, un système automatisé d'injection et de mélange de soude, le tout embarqué sur un véhicule utilitaire afin de pouvoir réaliser des tournées.
Résultats
Lauréat du concours Midi-Pyrénées Innovation : décembre 2006
Utilisation pédagogique
- Stages de conception, réalisation, essais par des étudiants de BTSA Gestion et maîtrise de l'eau et Licence Professionnelle « eau, boue, déchet »
- Automatisation par des étudiants de BTS du lycée Rascol (Education Nationale)
Autre valorisation
- Juin 2008 : présentation au colloque développement durable (Université Champollion Albi)
- Novembre 2008 : présentation journée Innovation de l'ARIA (Rodez)
- Janvier 2009 : démonstration lors de la journée technique de la semaine de l'eau du lycée Fonlabour d'Albi
- Décembre 2009 : restitution des essais sur sites (Bozouls)
- Avril 2010 : intervention à la semaine du développement durable (Université Champollion-Albi)
- Septembre 2011 : journée technique « Traitement et valorisation sur site des déchets gras » (Lot Développement)
- Décembre 2011 : démonstration (PFT Viandes et Salaisons-Rodez)
- Mai 2012 : Ecoinnovations au service de la gestion des déchets de l'IAA (MPI-Toulouse)
- Janvier 2014 : présentation au salon MIDINNOV-Toulouse
Calendrier
- 2005 : caractérisation des effluents, étude de faisabilité
- 2006 à 2007 : construction et automatisation du prototype
- 2008 à 2011 : essais de validation sur site (16 sites en Aveyron- 7 sites en Albigeois))
- 2012 à 2013 : industrialisation et transfert de technologie
- 2013 : essaimage industriel du projet, création d'une entreprise innovante SAPOVAL
Partenariats techniques/financiers
- PFT Viandes et Salaisons de Rodez
- PFT du lycée Rascol d'Albi pour l'automatisation
- Entreprise OCEO Environnement
- CRITT GPTE de Toulouse (Génie des Procédés et Techniques Environnementales)
- CRITT DIACT (Diagnostic Ingénierie Analyse Castres)
- CRITT Bio-industries Midi-Pyrénées (Toulouse)
- SATESE de l'Aveyron (Service d'assistance technique des exploitants de station d'épuration) : suivi du traitement des graisses saponifiées en station dépuration
- Communes de Bozouls (12) et Saint Jean du Bruel (12)
- Communauté d'Agglomérations de l'Albigeois (C2A)
- Conseil Régional Midi-Pyrénées,
- Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche,
- Ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt,
- Autofinancement des PFT GH2O et Viandes et Salaisons,
- Participation des structures bénéficiant des essais sur site.
Fichier : fichierinitiative1_poster_Albi_graisses_animales.pdf
Télécharger


Unité pilote de lombricompostage d'effluents de pisciculture (La Canourgue - Lozère)
Nom de la structure
Lycée Louis Pasteur / Ferme aquacole Source du Frézal (EPLEFPA Lozère)
Téléphone
04 66 32 83 54
Contact (courriel)
philippe.leroy@educagri.fr
Contact2 (courriel)
catherine.lejolivet@educagri.fr
Site Web
https://www.epl-lozere.fr
Code postal
48500
Ville
La Canourgue
Département
Lozère
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- traitement des effluents
- milieu naturel
- qualité de l'eau
Contexte
La gestion des boues est un enjeu majeur pour les installations aquacoles continentales. L'évacuation de ces boues (très liquides) se fait généralement par tracteur et tonne à lisier (coût d'évacuation et impact carbone). L'épandage agricole est actuellement la principale voie d'élimination (sans traitement) de ces boues. Sur le plan législatif et règlementaire, l'aquaculteur est responsable des boues, mais il ne peut garantir leur traçabilité et leur innocuité pour l'environnement...
Objectif
- dépasser la problématique de l'évacuation des boues par une véritable valorisation, conjointe à celle des déchets verts sur un territoire
- transformer des déchets (boues et déchets verts) en produits : compost, engrais liquide ("lombrithé") et lombrics
- transformer des déchets (boues et déchets verts) en produits : compost, engrais liquide ("lombrithé") et lombrics
Description de l'action
Le site de démonstration de La Canourgue est partie prenante du projet Innoqua, qui réunit une expertise multidisciplinaire de 20 partenaires autour du traitement des eaux usées basé sur la capacité d'épuration naturelle de macro et micro-organismes.
Le système de traitement est réalisé en deux phases :
1/ Au niveau de l'abri :
pompage et décantation des boues liquides de la pisciculture (et des boues ultimes de la serre d'aquaponie) dans des conteneurs > épaississement avec des copeaux de bois (non traités) > malaxage avec des déchets verts broyés et macération
2/ Au niveau du hangar :
compostage thermophile (fermentation chaude) sans vers de terre pendant 2 semaines > inoculation des lombriciens (Eisenia fetida et Eisenia andrei) dans les conteneurs > lombricompostage (maturation) pendant 10 semaines > criblage (maille 5 mm pour récupérer les lombrics) et séchage (soufflerie) du compost > mise en sachets et valorisation
Le système de traitement est réalisé en deux phases :
1/ Au niveau de l'abri :
pompage et décantation des boues liquides de la pisciculture (et des boues ultimes de la serre d'aquaponie) dans des conteneurs > épaississement avec des copeaux de bois (non traités) > malaxage avec des déchets verts broyés et macération
2/ Au niveau du hangar :
compostage thermophile (fermentation chaude) sans vers de terre pendant 2 semaines > inoculation des lombriciens (Eisenia fetida et Eisenia andrei) dans les conteneurs > lombricompostage (maturation) pendant 10 semaines > criblage (maille 5 mm pour récupérer les lombrics) et séchage (soufflerie) du compost > mise en sachets et valorisation
Résultats
Capacité de traitement actuelle : 60 m3 de déchets/an (40 % de boue piscicole soit 24 m3/an + 60% de déchets verts soit 36 m3/an)
capacité de production de lombricompost escomptée : 20 m3/an
Objectif de qualification du lombricompost conforme à la norme NFU 44-051 (AB)
capacité de production de lombricompost escomptée : 20 m3/an
Objectif de qualification du lombricompost conforme à la norme NFU 44-051 (AB)
Utilisation pédagogique
Liens avec les formations dispensées : bac pro et BTSA aquaculture, BTSA GEMEAU
Autre valorisation
- cf. plaquette et vidéo
- via la plateforme technologique régionale GH20
- journé technique 9 décembre 2021 "Biorésidus aquacoles et économie circulaire : une innovation territoriale"
- via la plateforme technologique régionale GH20
- journé technique 9 décembre 2021 "Biorésidus aquacoles et économie circulaire : une innovation territoriale"
Partenariats techniques/financiers
Partenariats techniques : Association Lombriteck, communauté de communes
Partenariats financiers : Union européenne (programme Horizon 2020), Agence de l'eau Adour-Garonne, région Occitanie, conseil départemental Lozère, SDEE (Syndicat Départemental d'Energie et d'Equipement de la Lozère)
Partenariats financiers : Union européenne (programme Horizon 2020), Agence de l'eau Adour-Garonne, région Occitanie, conseil départemental Lozère, SDEE (Syndicat Départemental d'Energie et d'Equipement de la Lozère)
Fichier : UnitePiloteDeLombricompostageDEffluentsDe_fichierinitiative1_plaquette_lombricompostage.pdf
Télécharger
Lien vers vidéo de présentation (1)
https://www.dailymotion.com/video/k5VKDKlTULsNxExsd6k
Vidéo de présentation (1)
Utilisation des eaux pluviales en production horticole (Tournus - Saône-et-Loire)
Nom de la structure
EPL Tournus
Téléphone
03 85 32 26 00
Contact (courriel)
francois.pelletier@educagri.fr
Contact2 (courriel)
nathalie.delara@educagri.fr
Contact3 (courriel)
christophe.rebillard@educagri.fr
Code postal
71700
Ville
Tournus
Département
Saône-et-Loire
Type d'initiative
- économie d'eau
Contexte
La ressource en eau pour la production horticole est un des axes d'amélioration constante pour l'exploitation en terme de gestion, d'utilisation et de réutilisation.
Cette unité de production horticole dispose d'abris variés : une serre verre de 914 m² (avec galerie, serre tempérée et serre chaude), une serre multi chapelle de 716 m², 3 tunnels (200,250 et 280 m²), un hangar de 200 m² et une serre de collection de 80 m². Cet outil est complété par un jardin maraîcher pédagogique de 500 m2 et un verger écologique de 2.7 hectares.
La ressource en eau pour la production horticole est un des axes d'amélioration constante pour l'exploitation en terme de gestion, d'utilisation et de réutilisation.
Cette unité de production horticole dispose d'abris variés : une serre verre de 914 m² (avec galerie, serre tempérée et serre chaude), une serre multi chapelle de 716 m², 3 tunnels (200,250 et 280 m²), un hangar de 200 m² et une serre de collection de 80 m². Cet outil est complété par un jardin maraîcher pédagogique de 500 m2 et un verger écologique de 2.7 hectares.
Objectif
- faire des économies sur l'utilisation d'eau du réseau
- engager l'équipe de direction et toute la communauté éducative dans l'Agenda 21 de l'établissement, à travers notamment la thématique de l'eau (mais aussi des déchets, de l'énergie, de la biodiversité et de la gouvernance)
- faire de la pédagogie par l'action
Description de l'action
Les toitures des serres de l'exploitation horticole (serre verre, multi chapelle et hangar) collectent l'eau de pluie sur une surface de 2000 m2 dans un bassin de rétention de 350 m3.
Celui-ci est équipé d'une géo-membrane posée sur un géotextile.
Avant d'arriver dans la retenue colinéaire, l'eau de pluie ainsi que l'eau d'arrosage de la serre verre qui sont récupérées circulent dans de larges tuyaux et sont filtrées dans un bac de décantation. Celui-ci nécessite d'être nettoyé une fois par an.
En cas de trop plein ou de débordement, les eaux rejoignent les eaux de pluie gérées par la commune et dont une installation jouxte le bassin.
La pompe de surface est installée dans un bâtiment en bois à proximité du bassin. La pompe aspire l'eau de la retenue collinaire et refoule en direction de la serre.
L'eau est ensuite réutilisée pour l'arrosage des végétaux de l'exploitation, le nettoyage des engins et outils.
Un autre dispositif associé au système de récupération, et piloté par un logiciel, est celui de deux cuves enterrées de 3 000 litres : l'eau pompée dans ces cuves permettra un arrosage par sub-irrigation sur une période programmée (système type « Marée montante / Marée descendante » pendant 14 minutes par exemple) des plantes de la serre verre (serre tempérée et serre chaude). L'arrosage par aspersion est aussi relié à ce système. L'eau ainsi utilisée redescend dans les cuves.
Les cuves sont alimentées par l'eau de la retenue collinaire (eaux pluviales). Elles fonctionnent en système fermé et sont vidangées tous les cinq ans.
Les toitures des serres de l'exploitation horticole (serre verre, multi chapelle et hangar) collectent l'eau de pluie sur une surface de 2000 m2 dans un bassin de rétention de 350 m3.
Celui-ci est équipé d'une géo-membrane posée sur un géotextile.
Avant d'arriver dans la retenue colinéaire, l'eau de pluie ainsi que l'eau d'arrosage de la serre verre qui sont récupérées circulent dans de larges tuyaux et sont filtrées dans un bac de décantation. Celui-ci nécessite d'être nettoyé une fois par an.
En cas de trop plein ou de débordement, les eaux rejoignent les eaux de pluie gérées par la commune et dont une installation jouxte le bassin.
La pompe de surface est installée dans un bâtiment en bois à proximité du bassin. La pompe aspire l'eau de la retenue collinaire et refoule en direction de la serre.
L'eau est ensuite réutilisée pour l'arrosage des végétaux de l'exploitation, le nettoyage des engins et outils.
Un autre dispositif associé au système de récupération, et piloté par un logiciel, est celui de deux cuves enterrées de 3 000 litres : l'eau pompée dans ces cuves permettra un arrosage par sub-irrigation sur une période programmée (système type « Marée montante / Marée descendante » pendant 14 minutes par exemple) des plantes de la serre verre (serre tempérée et serre chaude). L'arrosage par aspersion est aussi relié à ce système. L'eau ainsi utilisée redescend dans les cuves.
Les cuves sont alimentées par l'eau de la retenue collinaire (eaux pluviales). Elles fonctionnent en système fermé et sont vidangées tous les cinq ans.
Utilisation pédagogique
- Principalement dans la formation du Bac pro Production horticole dans les enseignements techniques : techniques horticoles et agroéquipement
- En Développement durable, initialement un module spécifique à l'EPL et depuis 2010 en EATDD avec les 2GT
Autre valorisation
Cette réflexion et ses réalisations sont valorisées :
. dans la rédaction d'une fiche AGENDA 21 distribuée dans les dossiers d'inscription
. sur le site Internet de l'EPL
Le poste EAUX USEES a été examiné dans le Bilan carbone® réalisé d'une part pour l'exploitation et d'autre part pour le lycée pour l'année de référence 2010. L'approche retenue pour la quantification des émissions de GES est la méthode Bilan Carbone® Version 6 développée par l'ADEME en collaboration avec Jean-Marc JANCOVICI.
Cette réflexion et ses réalisations sont valorisées :
. dans la rédaction d'une fiche AGENDA 21 distribuée dans les dossiers d'inscription
. sur le site Internet de l'EPL
Le poste EAUX USEES a été examiné dans le Bilan carbone® réalisé d'une part pour l'exploitation et d'autre part pour le lycée pour l'année de référence 2010. L'approche retenue pour la quantification des émissions de GES est la méthode Bilan Carbone® Version 6 développée par l'ADEME en collaboration avec Jean-Marc JANCOVICI.
Perspective
- Mesurer la quantité d'eau disponible dans le bassin à un temps donné : une sonde de niveau fonctionnant à partir de la conductivité de l'eau a été réalisé avec les élèves et le professeur d'agroéquipement et doit être testée.
- Récupérer les eaux d'arrosage du sol de la serre multi chapelle (mais le système de réseau de chauffage est installé à 18 cm en profondeur sur cette surface)
- Sensibiliser plus largement le grand public (dont les 4500 clients annuels de la serre, les visiteurs lors des Journées portes ouvertes et des différentes manifestations ayant lieu dans l'EPL) dans le cadre d'un "projet innovant" validé par le Conseil régional de Bourgogne en 2012 : le "Parcours découverte du développement durable" du lycée de l'Horticulture et du Paysage de Tournus.
Partenariats techniques/financiers
. la pompe et sa structure abri en bois
. la bâche de recouvrement, dans le cadre des microprojets de l'Agenda 21 en 2009
. le parcours "Découverte du développement durable" dans le cadre des Projets innovants 2012
- Technique : technicien horticole de la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire
- Financier : Conseil régional de Bourgogne pour :
. la pompe et sa structure abri en bois
. la bâche de recouvrement, dans le cadre des microprojets de l'Agenda 21 en 2009
. le parcours "Découverte du développement durable" dans le cadre des Projets innovants 2012
Fichier : fichierinitiative1_Photos_eaux_pluie_EA.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative2_Schema_eaux_pluie_EA.pdf
Télécharger
Utilisation du jeu Concert'eau avec une classe de BTSA GPN (Carcassonne - Aude)
Nom de la structure
LEGTA Carcassonne
Téléphone
04 68 119 119
Contact (courriel)
simone.serriere@educagri.fr
Contact2 (courriel)
isabelle.le-roch@educagri.fr
Adresse postale
Lycée Charlemagne
Adresse (suite)
route de Saint-Hilaire
Code postal
11000
Ville
CARCASSONNE
Département
Aude
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- milieu naturel
Contexte
En BTSA Gestion et Protection de la Nature, le référentiel prévoit un module M52 centré sur la concertation territoriale dans le cadre de la protection et gestion de la nature. Ce module doit s'appuyer sur un cas concret. J'ai choisi de m'appuyer sur la mise en place d'un SAGE dans la haute vallée de l'Aude. Dans ce cadre, le jeu Concert'eau nous est apparu (je travaille avec ma collègue d'ESC) tout particulièrement indiqué : cf. fiche-ressource Concert'eau
En BTSA Gestion et Protection de la Nature, le référentiel prévoit un module M52 centré sur la concertation territoriale dans le cadre de la protection et gestion de la nature. Ce module doit s'appuyer sur un cas concret. J'ai choisi de m'appuyer sur la mise en place d'un SAGE dans la haute vallée de l'Aude. Dans ce cadre, le jeu Concert'eau nous est apparu (je travaille avec ma collègue d'ESC) tout particulièrement indiqué : cf. fiche-ressource Concert'eau
Objectif
- Faire prendre conscience aux étudiants de l'existence de différentes logiques d'acteurs, de leurs conséquences sur des décisions à prendre concernant des espaces naturels.
- Les mettre en situation de concertation, d'argumentation, ce qui est difficile sur le terrain (d'où le choix d'un jeu de rôle).
Description de l'action
Sur une demi-journée, en demi-groupe (de 15 à 16 étudiants), pratique du jeu Concert'eau.
Sur une demi-journée, en demi-groupe (de 15 à 16 étudiants), pratique du jeu Concert'eau.
Résultats
Des étudiants en grande majorité contents de jouer, jouant bien le jeu (les deux fois, quelques élèves en retrait, participant peu à pas du tout, ce qui était rendu possible par un nombre de joueurs trop élevés,... mais la classe comprend 32 élèves).
Une exploitation du jeu intéressante, sur les différentes logiques, valeurs, sur la concertation,...
Des étudiants en grande majorité contents de jouer, jouant bien le jeu (les deux fois, quelques élèves en retrait, participant peu à pas du tout, ce qui était rendu possible par un nombre de joueurs trop élevés,... mais la classe comprend 32 élèves).
Une exploitation du jeu intéressante, sur les différentes logiques, valeurs, sur la concertation,...
Utilisation pédagogique
Module de formation du BTS GPN M52 sur la concertation d'acteurs....
Module de formation du BTS GPN M52 sur la concertation d'acteurs....
Autre valorisation
Présentation du jeu à notre partenaire, l'animatrice du SAGE "Haute vallée de l'Aude" qui souhaiterait que des étudiants fassent faire le jeu à des acteurs du territoires. A suivre pour, peut-être, octobre 2012.
Présentation du jeu à notre partenaire, l'animatrice du SAGE "Haute vallée de l'Aude" qui souhaiterait que des étudiants fassent faire le jeu à des acteurs du territoires. A suivre pour, peut-être, octobre 2012.
Calendrier
Séances de jeu faites en janvier et février 2012 (une demie-journée par groupe).
Séances de jeu faites en janvier et février 2012 (une demie-journée par groupe).
Perspective
Séance avec des acteurs du territoire vers octobre - novembre 2012.
Séance avec des acteurs du territoire vers octobre - novembre 2012.
Partenariats techniques/financiers
partenaire de notre suivi de SAGE : SMMAR (Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières)
partenaire de notre suivi de SAGE : SMMAR (Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières)
Utilisation du kit de jeu Wat-a-Game pour simuler un processus de médiation environnementale en lien avec la gestion de l'eau (Perpignan - Pyrénées Orientales)
Nom de la structure
LEGTPA François Rabelais de Saint Chély d'Apcher (48) - LEGTA Federico Garcia Lorca de Théza (66)
Téléphone
0468379937
Contact (courriel)
patrice.robin@educagri.fr
Adresse postale
LEGTA Federico Garcia Lorca
Adresse (suite)
RN 114
Code postal
66200
Ville
THEZA
Département
Pyrénées-Orientales
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- économie d'eau
- qualité de l'eau
Contexte
L'action s'est déroulée avec une classe de BTSA GPN du Lycée François Rabelais de Saint Chély d'Apcher, dans le cadre du module M52 "Participer à un processus de concertation pour la protection et la valorisation de la nature".
L'action s'est déroulée avec une classe de BTSA GPN du Lycée François Rabelais de Saint Chély d'Apcher, dans le cadre du module M52 "Participer à un processus de concertation pour la protection et la valorisation de la nature".
Objectif
Il s'agissait de construire et animer une séance permettant de simuler un processus de médiation environnementale dans le cadre d'un conflit lié à l'eau sur un territoire, en utilisant le kit de jeu "Wat-a-Game" (voir la fiche initiative consacrée à ce kit de jeu : http://www.reseau-eau.educagri.fr/wakka.php?wiki=GestionConcerteeDeLeauEnMilieuMediterran).
Il s'agissait de construire et animer une séance permettant de simuler un processus de médiation environnementale dans le cadre d'un conflit lié à l'eau sur un territoire, en utilisant le kit de jeu "Wat-a-Game" (voir la fiche initiative consacrée à ce kit de jeu : http://www.reseau-eau.educagri.fr/wakka.php?wiki=GestionConcerteeDeLeauEnMilieuMediterran).
Description de l'action
La séance s'est déroulée sur une journée entière. La construction de la séance a été conçue afin d'aborder différentes phases d'une médiation environnementale : définition des acteurs participant à la médiation, mise en place de la médiation, construction d'une représentation partagée du problème par les participants, recherche d'un accord. Le principe est celui d'un jeu de rôle : les étudiants jouent le rôle d'un acteur (y compris le rôle de médiateur).
La séance s'est déroulée sur une journée entière. La construction de la séance a été conçue afin d'aborder différentes phases d'une médiation environnementale : définition des acteurs participant à la médiation, mise en place de la médiation, construction d'une représentation partagée du problème par les participants, recherche d'un accord. Le principe est celui d'un jeu de rôle : les étudiants jouent le rôle d'un acteur (y compris le rôle de médiateur).
Résultats
Voir documents joints pour un bilan détaillé de l'action.
Voir documents joints pour un bilan détaillé de l'action.
Perspective
Construire et réaliser d'autres situations pédagogiques utilisant le kit de jeu "Wat-a-Game".
Construire et réaliser d'autres situations pédagogiques utilisant le kit de jeu "Wat-a-Game".
Partenariats techniques/financiers
Action pédagogique financée par les établissements dans le cadre d'une convention.
Un appui méthodologique a été fourni par l'UMR G-Eau, IRSTEA de Montpellier.
Action pédagogique financée par les établissements dans le cadre d'une convention.
Un appui méthodologique a été fourni par l'UMR G-Eau, IRSTEA de Montpellier.
Fichier : fichierinitiative1_observer_report_saintchely_5decembre2013_french.pdf
Télécharger
Fichier : fichierinitiative2_Bilan_questionnaire_ex-post_donne_aux_etudiants.pdf
Télécharger
Valorisation de prairies humides d'expansion des crues par pastoralisme extensif (Rodez - Aveyron)
Nom de la structure
Agricampus La Roque (EPLEFPA Rodez)
Téléphone
05 65 77 75 00
Contact (courriel)
carole.bes@educagri.fr
Contact2 (courriel)
marion.sudres@aveyronamont.fr
Site Web
http://agricampuslaroque.fr/
Code postal
12000
Ville
Rodez
Département
Aveyron
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- milieu naturel
- qualité de l'eau
- risques
- systèmes de culture
Contexte
La zone humide de Nostre Seigne, située à l’interaction entre des zones urbaines et agricoles sur la Commune d'Onet-le Château, dans l'agglomération de Rodez, bénéficie d'une vaste opération de restauration et de valorisation. Les parcelles situées au cœur du projet ont été acquises par la commune d’Onet-le-Chateau, sous une forte pression foncière.
Les objectifs de ces aménagements sont de préserver et mettre en valeur les champs d’expansion des crues de la rivière Auterne, en contribuant au maintien du rôle hydrologique du site et en préservant les habitats et la biodiversité.
Le plan de gestion de la zone humide, élaboré par la Cellule d'Assistance Technique Zones Humides (CATZH), a permis d’identifier les divers aménagements à mettre en place afin de concilier préservation de la zone humide et gestion du site par une activité agricole de pâture ou de fauche. En particulier, une convention de mise à disposition des parcelles pour une gestion de la zone pare pastoralisme extensif a été conclue entre le maître d'ouvrage (Syndicat mixte du bassin versant Aveyron Amont) et le lycée agricole Agricampus de Rodez-La Roque
Les objectifs de ces aménagements sont de préserver et mettre en valeur les champs d’expansion des crues de la rivière Auterne, en contribuant au maintien du rôle hydrologique du site et en préservant les habitats et la biodiversité.
Le plan de gestion de la zone humide, élaboré par la Cellule d'Assistance Technique Zones Humides (CATZH), a permis d’identifier les divers aménagements à mettre en place afin de concilier préservation de la zone humide et gestion du site par une activité agricole de pâture ou de fauche. En particulier, une convention de mise à disposition des parcelles pour une gestion de la zone pare pastoralisme extensif a été conclue entre le maître d'ouvrage (Syndicat mixte du bassin versant Aveyron Amont) et le lycée agricole Agricampus de Rodez-La Roque
Objectif
- entretenir, notamment grâce à une activité économique, les zones d'expansion de crue
- expérimenter de nouvelles pratiques, donner des références techniques locales
- porter des projets pédagogiques sur la préservation, la gestion et la valorisation des zones humides
- expérimenter de nouvelles pratiques, donner des références techniques locales
- porter des projets pédagogiques sur la préservation, la gestion et la valorisation des zones humides
Description de l'action
- clôturage : 5,5 km linéaires, 9 barrières
- création de 8 points d'abreuvement (raccordés à l'eau potable), 1 rampe aménagée
- implantation d'une haie (fruitière)
- pâturage tournant : depuis 2018, 25 couples mères/veaux sont alimentés durant la période de pousse de l’herbe, ce qui permet de profiter d’une ressource herbagère abondante, notamment pendant la période sèche
- fauchage l'été (2020 : 7,5 ha à raison de 3,8 t/ha MS)
- références techniques : réalisation d'un suivi sur le troupeau concernant le parasitisme interne des bovins (analyses coprologiques, en partenariat avec le laboratoire Zoetis) et valeur alimentaire de l'herbe pâturée ainsi que des fourrages récoltés sur la zone (analyses)
- création de 8 points d'abreuvement (raccordés à l'eau potable), 1 rampe aménagée
- implantation d'une haie (fruitière)
- pâturage tournant : depuis 2018, 25 couples mères/veaux sont alimentés durant la période de pousse de l’herbe, ce qui permet de profiter d’une ressource herbagère abondante, notamment pendant la période sèche
- fauchage l'été (2020 : 7,5 ha à raison de 3,8 t/ha MS)
- références techniques : réalisation d'un suivi sur le troupeau concernant le parasitisme interne des bovins (analyses coprologiques, en partenariat avec le laboratoire Zoetis) et valeur alimentaire de l'herbe pâturée ainsi que des fourrages récoltés sur la zone (analyses)
Utilisation pédagogique
- environ 100 à 200 élèves par an impliqués sur le projet :
- . présentation des intérêts des zones humides (pluri STAV, 2nd EATDD, term spécialité AET)
- . plantation de haie (pluri STAV)
- . création de références techniques sur le pâturage (tournant) et la valeur alimentaire de ces fourrages ; prélèvements sanguins et coprologiques pour évaluer la charge parasitaire du troupeau (bac pro CGEA du CFPPA et PA1 en TP) ; analyses des prélèvements coprologiques pour comparaison avec résultats des labos agréés (BTS ANABIOTECH en TP)
- . réalisation et traitement d’enquêtes auprès des usagers et riverains afin de collecter leurs impressions (MIL BTS PA1 "Connaissance de l’élevage régional et de sa problématique": thème 2020 : "quel(s) retour(s) des usagers du site Nostre Seigne suite à la mise en place du projet")
Autre valorisation
- mise en place d'un parcours (pontons, bancs, tables...) et panneaux de sensibilisation pour le grand public (par le SMBV2A)
- participation à une grande journée d'animation pour le grand public et le public scolaire : cf. film (https://www.youtube.com/watch?v=ej64Qi_VkjA) et teaser (https://www.youtube.com/watch?v=oc9KUxJyu68)
- article en ligne sur le site de l'agricampus (http://agricampuslaroque.fr/index.php/2020/11/27/nostre-seigne-un-projet-a-haute-valeur-pedagogique/)
- visites d'étudiants et présentations du projet auprès d'autres lycées agricoles
- visites de groupes d'élèves écoles primaires
- participation à une grande journée d'animation pour le grand public et le public scolaire : cf. film (https://www.youtube.com/watch?v=ej64Qi_VkjA) et teaser (https://www.youtube.com/watch?v=oc9KUxJyu68)
- article en ligne sur le site de l'agricampus (http://agricampuslaroque.fr/index.php/2020/11/27/nostre-seigne-un-projet-a-haute-valeur-pedagogique/)
- visites d'étudiants et présentations du projet auprès d'autres lycées agricoles
- visites de groupes d'élèves écoles primaires
Partenariats techniques/financiers
- financiers : Agence de l’Eau Adour Garonne et Conseil Régional Occitanie (appel à projets « préservons et restaurons les zones d’expansions de crues »), Commune d’Onet le Château, Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron Amont, Conseil Départemental de l’Aveyron
- techniques : Commune d’Onet-le-Château, Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron Amont, Rodez Agglomération, Cellule d’Assistance Zone Humide, laboratoire Zoetis, Association Arbres Haies Paysages, Services régionaux et départementaux d'archéologie, Association locale d'archéologie, Ligue pour la Protection des Oiseaux, Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques, Fédération Départementale des Chasseurs, Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement, Conseil départemental de l’Aveyron
- techniques : Commune d’Onet-le-Château, Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron Amont, Rodez Agglomération, Cellule d’Assistance Zone Humide, laboratoire Zoetis, Association Arbres Haies Paysages, Services régionaux et départementaux d'archéologie, Association locale d'archéologie, Ligue pour la Protection des Oiseaux, Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques, Fédération Départementale des Chasseurs, Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement, Conseil départemental de l’Aveyron


Lien vers vidéo de présentation (1)
https://www.youtube.com/watch?v=ej64Qi_VkjA
Lien vers vidéo de présentation(2)
https://www.youtube.com/watch?v=ej64Qi_VkjA
Vidéo de présentation (1)
Vidéo de présentation (2)
Valorisation des effluents d'élevage par le compostage (Chaumont - Haute Marne / Rethel - Ardennes)
Nom de la structure
EPLEFPA de RETHEL - EPLEFPA de Chaumont
Téléphone
03 24 39 60 00
Contact (courriel)
Etienne.ROUSSEL@educagri.fr
Contact2 (courriel)
Stephane.HIRTZBERGER@educagri.fr
Site Web
http://www.lyceeagricole-rethel.fr
Code postal
08300
Ville
Rethel
Département
Ardennes
Type d'initiative
- traitement des effluents
- qualité de l'eau
- systèmes de culture
Contexte
Cette action a été mise en place sur des exploitations de polyculture-élevage.
Cette action a été mise en place sur des exploitations de polyculture-élevage.
Description de l'action
Deux exploitations d'EPLEFPA ont mis en place un essai afin de comparer 2 modalités de fertilisation fractionnées en 3 apports (minéral, minéral et compost, minéral) sur 2 bandes parcellaires.
Deux exploitations d'EPLEFPA ont mis en place un essai afin de comparer 2 modalités de fertilisation fractionnées en 3 apports (minéral, minéral et compost, minéral) sur 2 bandes parcellaires.
Résultats
Aucune différence sur le rendement du blé n'a été constatée quel que soit le type de fertilisation. L'impact du compost a moyen terme, avec un suivi de l'arrière effet de la matière organique sur la fourniture en azote du sol reste a évaluer. Aucun problème d'adventices n'a été identifié plus particulièrement sur la bande ayant reçu du compost.
Aucune différence sur le rendement du blé n'a été constatée quel que soit le type de fertilisation. L'impact du compost a moyen terme, avec un suivi de l'arrière effet de la matière organique sur la fourniture en azote du sol reste a évaluer. Aucun problème d'adventices n'a été identifié plus particulièrement sur la bande ayant reçu du compost.
Utilisation pédagogique
Les apprenants ont participé à la mise en place de l'action de démonstration et à son suivi.
Les apprenants ont participé à la mise en place de l'action de démonstration et à son suivi.
Autre valorisation
L'action a été présentée dans le cadre des journées portes ouvertes.
L'action a été présentée dans le cadre des journées portes ouvertes.
Calendrier
action terminée (2005-2006)
action terminée (2005-2006)
Partenariats techniques/financiers
Action intégrée dans le cadre du réseau des exploitations des EPLEFPA de Champagne-Ardenne
Action intégrée dans le cadre du réseau des exploitations des EPLEFPA de Champagne-Ardenne
- Agence de l'Eau Seine-Normandie
- Conseil Régional de Champagne-Ardenne
Fichier : fichierinitiative1_poster_Rethel-Chaumont_compost-effluents.pdf
Télécharger
Valorisation des effluents piscicoles et biodéchets par le procédé de lombricompostage et lombriculture (Château-Chinon - Nièvre)
Nom de la structure
EPLEFPA du Morvan à Château-Chinon
Téléphone
03 86 79 49 80
Contact (courriel)
valerie.blandin@educagri.fr
Contact2 (courriel)
florian.guillet@educagri.fr
Contact3 (courriel)
christelle.renault@educagri.fr
Site Web
https://www.morvanformations.com
Code postal
58120
Ville
Château-Chinon
Département
Nièvre
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- traitement des effluents
- milieu naturel
- qualité de l'eau
Contexte
l’EPLFPA du Morvan, riche de ses deux piscicultures rénovées, souhaite s'engager pour le développement d’une agriculture et aquaculture durables sur le territoire, au vu des enjeux forts pour les pouvoirs publics et pour les professionnels.
L'évacuation des boues piscicoles se fait actuellement principalement via épandage agricole sans traitement préalable, ce qui induit un coût d'évacuation et un impact carbone non négligeable.
La création d’une plateforme de lombricompostage sur le site de la pisciculture de Vermenoux va donc permettre dans un premier temps de traiter les boues piscicoles in situ (environ 36 tonnes produites/an) puis de les transformer en produits à forte valeur ajoutée.
L'hygiénisation et la valorisation par compostage de proximité des boues de la pisciculture avec une récupération et un traitement de biodéchets de divers partenaires du territoire représentent une ressource importante en matière, en énergie et en stockage du carbone ainsi qu’une source de revenus.
L'évacuation des boues piscicoles se fait actuellement principalement via épandage agricole sans traitement préalable, ce qui induit un coût d'évacuation et un impact carbone non négligeable.
La création d’une plateforme de lombricompostage sur le site de la pisciculture de Vermenoux va donc permettre dans un premier temps de traiter les boues piscicoles in situ (environ 36 tonnes produites/an) puis de les transformer en produits à forte valeur ajoutée.
L'hygiénisation et la valorisation par compostage de proximité des boues de la pisciculture avec une récupération et un traitement de biodéchets de divers partenaires du territoire représentent une ressource importante en matière, en énergie et en stockage du carbone ainsi qu’une source de revenus.
Objectif
- Améliorer la gestion des boues des piscicultures de l'établissement pour une réduction des gaz à effet de serre, une protection de l’eau, une restauration des sols et un stockage du carbone
- Créer une synergie collective avec d’autres acteurs du territoire afin de récupérer et traiter en circuit court des biodéchets et de créer des produits à forte valeur ajoutée (lombricompost, lombrithé, vers de compost, vers de pêche)
- Valoriser le sentiment d’appartenance à un territoire en fédérant les différents acteurs atour d’une thématique agroéconomique porteuse d’enjeux économiques, sociaux et environnementaux
- Rendre les apprenants « Consom’acteurs » en les incluant dès la réflexion afin qu’ils s’approprient le projet, coopèrent activement et acquièrent de nouvelles compétences.
- Créer une synergie collective avec d’autres acteurs du territoire afin de récupérer et traiter en circuit court des biodéchets et de créer des produits à forte valeur ajoutée (lombricompost, lombrithé, vers de compost, vers de pêche)
- Valoriser le sentiment d’appartenance à un territoire en fédérant les différents acteurs atour d’une thématique agroéconomique porteuse d’enjeux économiques, sociaux et environnementaux
- Rendre les apprenants « Consom’acteurs » en les incluant dès la réflexion afin qu’ils s’approprient le projet, coopèrent activement et acquièrent de nouvelles compétences.
Description de l'action
Au cours de l’année 2022, Jean-Nicolas Folliet (formateur au CFPPA) avait déjà mis en place dans le cadre du BPREA agroécologie avec l’association Terrestris une expérimentation de valorisation du fumier issu d’un centre équestre proche du lycée avec un résultat très positif (4 andains créés). il s'agit dans ce nouveau projet d'adapter la méthode aux effluents de pisciculture (sur une parcelle jouxtant les bassins), avec des techniques simples, facilement transposables pour les professionnels, sans phase thermophile.
Actions prévues
2024-2025 :
- Mise en place du Copil
- Mise en place d’une plantation de saules (sur 50 m2)afin de gérer les éventuels lixiviats
- Expérimentation afin de trouver le bon équilibre des différents intrants (boues, BRF)
- Réalisation de BRF (bois raméal fragmenté) récupéré lors de l’entretien de la parcelle afin qu’il soit colonisé par les détritivores (bactéries, champignons et invertébrés ) avant d’être incorporé aux boues
- Enquête auprès des professionnels de la région pour déterminer leurs attentes et besoins quant à la valorisation des biodéchets et leur présenter le projet
- Mise en place de la plateforme de lombricompostage (printemps 2025)
- Recherche de partenaires financiers pour augmenter la capacité de traitement des boues et améliorer le système (Avis positif par le PEI-Agri 2024 Phase 1 dossier technique)
- Restauration de la ripisylve du bras de contournement de la rivière au niveau de la parcelle
- Mise en place des partenariats pour la récupération de biodéchets
- Mise en place d’un partenariats pour la récupération de biodéchets avec la commune de Château-Chinon
2025-2026 :
- Poursuite des actions éducatives
- Nouveaux investissements matériels grâce aux partenaires financiers et amélioration du process
- Mise en place de l’expérimentation vers de pêche : MIL micro-entreprise BTS1 AQUA
- Réflexion sur la valorisation du thé de compost en interne ou en externe
- Distribution en interne et aux partenaires du premier lombricompost
- Travail sur la commercialisation des produits
- Evaluation des actions mises en place
- Construction du hangar pour tamisage, entreposage et mise en sac du lombricompost
2026-2027 :
- Poursuite des actions éducatives
- Création d’un petit chalet pour l’accueil du public et la vente des produits (lombricompost et vers de compost) à côté de la plateforme de lombricompostage
- Commercialisation du lombricompostage et vers de compost
- Création de panneaux sur le site de Vermenoux pour communiquer sur le processus de valorisation des boues
- Construction d’une enquête par les BTS aqua à destination des professionnels de la région pour déterminer leurs attentes et besoins quant à la valorisation des biodéchets
- Transmission de l’expertise aux professionnels.
- Évaluation du projet
Actions prévues
2024-2025 :
- Mise en place du Copil
- Mise en place d’une plantation de saules (sur 50 m2)afin de gérer les éventuels lixiviats
- Expérimentation afin de trouver le bon équilibre des différents intrants (boues, BRF)
- Réalisation de BRF (bois raméal fragmenté) récupéré lors de l’entretien de la parcelle afin qu’il soit colonisé par les détritivores (bactéries, champignons et invertébrés ) avant d’être incorporé aux boues
- Enquête auprès des professionnels de la région pour déterminer leurs attentes et besoins quant à la valorisation des biodéchets et leur présenter le projet
- Mise en place de la plateforme de lombricompostage (printemps 2025)
- Recherche de partenaires financiers pour augmenter la capacité de traitement des boues et améliorer le système (Avis positif par le PEI-Agri 2024 Phase 1 dossier technique)
- Restauration de la ripisylve du bras de contournement de la rivière au niveau de la parcelle
- Mise en place des partenariats pour la récupération de biodéchets
- Mise en place d’un partenariats pour la récupération de biodéchets avec la commune de Château-Chinon
2025-2026 :
- Poursuite des actions éducatives
- Nouveaux investissements matériels grâce aux partenaires financiers et amélioration du process
- Mise en place de l’expérimentation vers de pêche : MIL micro-entreprise BTS1 AQUA
- Réflexion sur la valorisation du thé de compost en interne ou en externe
- Distribution en interne et aux partenaires du premier lombricompost
- Travail sur la commercialisation des produits
- Evaluation des actions mises en place
- Construction du hangar pour tamisage, entreposage et mise en sac du lombricompost
2026-2027 :
- Poursuite des actions éducatives
- Création d’un petit chalet pour l’accueil du public et la vente des produits (lombricompost et vers de compost) à côté de la plateforme de lombricompostage
- Commercialisation du lombricompostage et vers de compost
- Création de panneaux sur le site de Vermenoux pour communiquer sur le processus de valorisation des boues
- Construction d’une enquête par les BTS aqua à destination des professionnels de la région pour déterminer leurs attentes et besoins quant à la valorisation des biodéchets
- Transmission de l’expertise aux professionnels.
- Évaluation du projet
Utilisation pédagogique
- Implication de l’équipe d’écodélégués afin de co-construire le projet
- Classe de 4ème et 3ème : récupération des cartons avec les agents techniques
- Travail en commun seconde agri et seconde aqua : comparaison des spécificités des biodéchets issus des élevages
- TP conception de la plateforme de lombricompostage avec les classes de première et terminale aqua
- TP Marketing avec les BTS TC sur le packaging et la distribution du lombricompost
- TP BPREA agroécologie pour entretien du site et récupération du BRF
- élèves de toutes les filières pour les visites du site lors de l’accueil de partenaires ou de classes scolaires
- Vente de vers de pêche par les BTS aqua aux usagers du territoire
- Mise en place de formation à la lombriculture par le CFPPA
- Classe de 4ème et 3ème : récupération des cartons avec les agents techniques
- Travail en commun seconde agri et seconde aqua : comparaison des spécificités des biodéchets issus des élevages
- TP conception de la plateforme de lombricompostage avec les classes de première et terminale aqua
- TP Marketing avec les BTS TC sur le packaging et la distribution du lombricompost
- TP BPREA agroécologie pour entretien du site et récupération du BRF
- élèves de toutes les filières pour les visites du site lors de l’accueil de partenaires ou de classes scolaires
- Vente de vers de pêche par les BTS aqua aux usagers du territoire
- Mise en place de formation à la lombriculture par le CFPPA
Autre valorisation
- Photos et vidéos des TP publiées sur le site du lycée afin de valoriser les actions pédagogiques et les démarches d’économie circulaire et d’aquaécologie
- Page dédiée sur le site de l'établissement (https://www.morvanformations.com/le-projet-lombric/)
- Mise en place de panneaux expliquant le processus sur le site de la pisciculture
- Journées Portes ouvertes : démonstration du processus
- Journées de démonstration et organisation de conférences à destination des professionnels et partenaires du territoire
- Page dédiée sur le site de l'établissement (https://www.morvanformations.com/le-projet-lombric/)
- Mise en place de panneaux expliquant le processus sur le site de la pisciculture
- Journées Portes ouvertes : démonstration du processus
- Journées de démonstration et organisation de conférences à destination des professionnels et partenaires du territoire
Calendrier
2024-2027
Perspective
Vente de lombricompost : environ 27,50 euros/25 kg
(1 tonne de boues + BRF > 200 kgs de compost)
Vente de vers (eisenia fetida) pour ensemencements : 50 euros/kg
(1 tonne de boues + BRF > 200 kgs de compost)
Vente de vers (eisenia fetida) pour ensemencements : 50 euros/kg
Partenariats techniques/financiers
effectifs :
- Association Terrestris
- OFB
envisagés :
- Parc régional du Morvan
- Commune de Corancy et de Château-Chinon
- Centres équestres
- Scierie de Château-Chinon
- Syndicat des aquaculteurs Bourgogne - Franche-Comté
- Communauté de commune Morvan Sommets et Grands Lacs
- Agence de l'eau Seine Normandie
- EPLEFPA de la Lozère (cf. fiche-action "unité pilote de lombricompostage d'effluents piscicoles")
Le projet bénéficie du dispositif d'aide "porteur de projet de développement" de la DGER pour 2024-2027
- Association Terrestris
- OFB
envisagés :
- Parc régional du Morvan
- Commune de Corancy et de Château-Chinon
- Centres équestres
- Scierie de Château-Chinon
- Syndicat des aquaculteurs Bourgogne - Franche-Comté
- Communauté de commune Morvan Sommets et Grands Lacs
- Agence de l'eau Seine Normandie
- EPLEFPA de la Lozère (cf. fiche-action "unité pilote de lombricompostage d'effluents piscicoles")
Le projet bénéficie du dispositif d'aide "porteur de projet de développement" de la DGER pour 2024-2027
Fichier : presentation_projet_lombricompostage.pdf
Télécharger

Valoriser les effluents de pisciculture en Bourgogne- Franche Comté (Château-Chinon - Nièvre)
Nom de la structure
EPLEFPA du Morvan
Téléphone
03 86 79 49 80
Contact (courriel)
jean-noel.bernard@educagri.fr
Contact2 (courriel)
florian.guillet@educagri.fr
Site Web
https://www.morvanformations.com
Code postal
58120
Ville
Château-Chinon
Département
Nièvre
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- traitement des effluents
- milieu naturel
- qualité de l'eau
Contexte
Les piscicultures de Vermenoux et Corancy sont les deux exploitations du lycée agricole du Morvan à Château-Chinon (élevages de 20 tonnes/an de truites arc-en-ciel et fario). Dans le cadre leur rénovation, la construction d'une plateforme expérimentale d'environ 40 m2 bétonnée avec une alimentation électrique et pourvue d'un écoulement des eaux usées est en cours de validation auprès du Conseil régional.
Cette plate-forme qui sera construite à Vermenoux à côté de la station de traitement des effluents d'élevage, devrait être ensuite utilisée pour réaliser des essais de traitement et de valorisation des effluents d'élevage...
Cette plate-forme qui sera construite à Vermenoux à côté de la station de traitement des effluents d'élevage, devrait être ensuite utilisée pour réaliser des essais de traitement et de valorisation des effluents d'élevage...
Objectif
- créer ou s'approcher d'un système d 'économie circulaire (les déchets devenant des aliments ou de l'énergie), dans une approche agro-écologique
- développer les partenariats de territoire
- développer les partenariats de territoire
Description de l'action
Plusieurs pistes d 'essais sont étudiées et pourront être testées sur cette plate-forme :
- la production d'algues et l'élevage de daphnies qui pourrait servir de
proies vivantes pour le démarrage alimentaire des alevins de truites mais aussi en aquariologie,
- l'aquaponie (cf. fiche-action expérience de l'EPLEFPA Lozère) : production de plantes aquatiques et tropicales (vanille, chataigne d'eau,...) commercialisables
- la biométhanisation 3e génération (projet plus ambitieux en collaboration avec l'ADEME, à partir de cultures algales),
- le compostage (avec mouches "soldat noir"), le lombricompostage,
- l'élevage de larves d'insectes, secteur le plus prometteur et le plus pertinent par rapport à la pisciculture (alimentation des poissons : jusqu'à 50 % des farines animales à partir des farines d'insectes)
- la production d'algues et l'élevage de daphnies qui pourrait servir de
proies vivantes pour le démarrage alimentaire des alevins de truites mais aussi en aquariologie,
- l'aquaponie (cf. fiche-action expérience de l'EPLEFPA Lozère) : production de plantes aquatiques et tropicales (vanille, chataigne d'eau,...) commercialisables
- la biométhanisation 3e génération (projet plus ambitieux en collaboration avec l'ADEME, à partir de cultures algales),
- le compostage (avec mouches "soldat noir"), le lombricompostage,
- l'élevage de larves d'insectes, secteur le plus prometteur et le plus pertinent par rapport à la pisciculture (alimentation des poissons : jusqu'à 50 % des farines animales à partir des farines d'insectes)
Utilisation pédagogique
Intégration des expérimentations (premiers tests) ou productions dans les modules d'enseignement : lombricompostage sur le fumier de lapin de l'atelier 4è-3è, élevage de mouches "soldat noir" en 3e et 2e, de daphnies en MIL "expérimentations" pour les BTSA Aquaculture, commercialisation de vers de pêche en EIE "pêche",...
Autre valorisation
- newsletter à parution régulière
- référencement sur GIS "piscicultures de demain" de l'INRA
- référencement sur GIS "piscicultures de demain" de l'INRA
Perspective
participation au projet "Ninaqua" (par l'intermédiaire de l'ITAVI) pour concevoir les aliments de demain en pisciculture
Partenariats techniques/financiers
Ce projet s'inscrit dans le cadre du dispositif "tiers-temps" de la DGER.
Autres partenaires : Conseil régional Bourgogne - Franche-Comté, entreprise Ynsect, groupe Triskalia (société Algae), ADEME,...
Autres partenaires : Conseil régional Bourgogne - Franche-Comté, entreprise Ynsect, groupe Triskalia (société Algae), ADEME,...
Valoriser les zones humides en élevage : le TP Pâtur’Ajuste au lycée du Paraclet (Amiens - Somme)
Nom de la structure
EPLEFPA Amiens
Téléphone
03 22 35 30 00
Contact (courriel)
caroline.bono@educagri.fr
Contact2 (courriel)
guillaume.champion@educagri.fr
Contact3 (courriel)
hugo.puech@educagri.fr
Site Web
https://www.leparacletamiens.com/
Code postal
80440
Ville
Cottenchy
Département
Somme
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- milieu naturel
- systèmes de culture
Contexte
Le lycée agricole du Paraclet utilise 85 ha de marais (espaces naturels sensibles) qui sont pâturés par le troupeau de vaches de race Nantaise du lycée. Ces marais communaux sont gérés par le Cen Hauts de France, qui accompagne des exploitations agricoles - dont celle du lycée du Paraclet - à la gestion agricole des zones humides dans le cadre du PMAZH (Programme de maintien de l’agriculture en zones humides, porté par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et de nombreux partenaires).
Alors que l’élevage à l’herbe est peu commun dans la vallée de la Somme où dominent les grandes cultures et où l’élevage valorise peu les prairies (<10 % de la SAU), l’objectif est de proposer aux apprenants un exemple de mode d’élevage qui soit à la fois productif et économe, et qui réponde aux enjeux de maintien des milieux humides.
La formation nationale « Prairies naturelles et parcours : un levier pour favoriser l’autonomie alimentaire en élevage - démarche ‘Pâtur’Ajuste’ » qui a eu lieu au lycée agricole du Paraclet en 2023, et plus largement l’accompagnement réalisé dans le cadre du PMAZH et la mise à disposition d’une mallette pédagogique sur l’agriculture en zone humide, ont outillé l’équipe du lycée pour améliorer la gestion du pâturage des bovins sur prairies naturelles, et mettre en place une démarche pédagogique auprès de plusieurs classes : BTSA GEMEAU, Bac pro CGEA, 1ère STAV production. En particulier, le TP « Pâtur’Ajuste » mis en place en 2023-2024 avec les Bac Pro STAV par Caroline Bono (enseignante en zootechnie) et Julie Duchatel (enseignante en agronomie) et conjointement avec Hugo Puech (Directeur de l'exploitation agricole - DEA - du lycée), a permis d’aborder la valorisation des zones humides (et plus largement des prairies naturelles) en élevage.
Alors que l’élevage à l’herbe est peu commun dans la vallée de la Somme où dominent les grandes cultures et où l’élevage valorise peu les prairies (<10 % de la SAU), l’objectif est de proposer aux apprenants un exemple de mode d’élevage qui soit à la fois productif et économe, et qui réponde aux enjeux de maintien des milieux humides.
La formation nationale « Prairies naturelles et parcours : un levier pour favoriser l’autonomie alimentaire en élevage - démarche ‘Pâtur’Ajuste’ » qui a eu lieu au lycée agricole du Paraclet en 2023, et plus largement l’accompagnement réalisé dans le cadre du PMAZH et la mise à disposition d’une mallette pédagogique sur l’agriculture en zone humide, ont outillé l’équipe du lycée pour améliorer la gestion du pâturage des bovins sur prairies naturelles, et mettre en place une démarche pédagogique auprès de plusieurs classes : BTSA GEMEAU, Bac pro CGEA, 1ère STAV production. En particulier, le TP « Pâtur’Ajuste » mis en place en 2023-2024 avec les Bac Pro STAV par Caroline Bono (enseignante en zootechnie) et Julie Duchatel (enseignante en agronomie) et conjointement avec Hugo Puech (Directeur de l'exploitation agricole - DEA - du lycée), a permis d’aborder la valorisation des zones humides (et plus largement des prairies naturelles) en élevage.
Objectif
- Comprendre les enjeux des zones humides ;
- apprendre à observer (le troupeau, la végétation et sa dynamique à l’échelle de la parcelle) ;
- aborder les notions liées au pâturage en prairies naturelles ;
- comprendre l’intérêt des prairies naturelles (dont les zones humides) dans le système d’alimentation du troupeau à l’échelle de l’exploitation.
- apprendre à observer (le troupeau, la végétation et sa dynamique à l’échelle de la parcelle) ;
- aborder les notions liées au pâturage en prairies naturelles ;
- comprendre l’intérêt des prairies naturelles (dont les zones humides) dans le système d’alimentation du troupeau à l’échelle de l’exploitation.
Description de l'action
Le TP Pâtur’Ajuste se déroule en 4 séances - pour un total d’environ 10h sur l’année scolaire (cf. document à télécharger ci-dessous) :
Séance n°1 (3h en octobre/novembre) : Présentation de l’exploitation et des objectifs
Objectif : Comprendre le système de production à l’échelle de l’exploitation du lycée et les objectifs de production.
Déroulé :
- Présentation de l’exploitation (ateliers de production, troupeaux, parcellaire, système d’alimentation, commercialisation) et des objectifs de production par le DEA (en salle).
- Visite de l’exploitation, observation du troupeau et comparaison des deux races (Nantaises et Rouges des prés) vis-à-vis de leurs compétences et capacités à valoriser les zones humides.
- Réalisation du calendrier de production et de reproduction, représentation de la chaîne de pâturage.
Séance n°2 (2h au printemps) : Diagnostic prairial sur la parcelle du verger
Objectifs : Aborder les notions de survie, reproduction et mortalité des plantes, amener les élèves à observer des indices de la dynamique de végétation, les faire constater le prélèvement des ligneux par les bovins.
Déroulé :
- Le verger est divisé en 6 paddocks, chaque groupe de 3 élèves réalise le diagnostic sur un paddock, à partir d’un extrait du guide de terrain pour apprendre à caractériser les végétations naturelles : évaluation du prélèvement sur les strates herbacée et ligneuse, indicateurs de zones dégradées, de cicatrisation, de refus, etc.
- Le groupe entier repasse sur l’ensemble des paddocks pour une restitution des observations (qui seront ensuite rapportées au DEA) et une brève analyse de la gestion des paddocks.
Séance n°3 (2h au printemps) : Présentation des zones humides en Hauts de France
Objectif : Prendre connaissance des enjeux des zones humides et en particulier en Hauts de France
Déroulé : En prenant appui sur la mallette pédagogique du PMAZH (documents, vidéos, etc.) et en répondant à un questionnaire, les élèves sont amenés à définir les zones humides et à réfléchir à leurs enjeux écologiques et agricoles (en salle).
Séance n°4 (2h30 à 3h au printemps) : Observation du pâturage du troupeau Nantais sur le marais
Objectif : Comprendre l’intérêt du pâturage du marais pour l’exploitation, aborder les notions de disponibilité de la ressource, observer certaines espèces spécifiques aux zones humides.
Déroulé :
- Interventions de Matthieu Franquin (Cen Hauts de France) et Hugo Puech (DEA du Paraclet) dans les parcelles de marais du lycée, en présence du troupeau de vaches Nantaises.
- Rédaction d’un article par les élèves pour la newsletter du lycée (cf. valorisation).
Séance n°1 (3h en octobre/novembre) : Présentation de l’exploitation et des objectifs
Objectif : Comprendre le système de production à l’échelle de l’exploitation du lycée et les objectifs de production.
Déroulé :
- Présentation de l’exploitation (ateliers de production, troupeaux, parcellaire, système d’alimentation, commercialisation) et des objectifs de production par le DEA (en salle).
- Visite de l’exploitation, observation du troupeau et comparaison des deux races (Nantaises et Rouges des prés) vis-à-vis de leurs compétences et capacités à valoriser les zones humides.
- Réalisation du calendrier de production et de reproduction, représentation de la chaîne de pâturage.
Séance n°2 (2h au printemps) : Diagnostic prairial sur la parcelle du verger
Objectifs : Aborder les notions de survie, reproduction et mortalité des plantes, amener les élèves à observer des indices de la dynamique de végétation, les faire constater le prélèvement des ligneux par les bovins.
Déroulé :
- Le verger est divisé en 6 paddocks, chaque groupe de 3 élèves réalise le diagnostic sur un paddock, à partir d’un extrait du guide de terrain pour apprendre à caractériser les végétations naturelles : évaluation du prélèvement sur les strates herbacée et ligneuse, indicateurs de zones dégradées, de cicatrisation, de refus, etc.
- Le groupe entier repasse sur l’ensemble des paddocks pour une restitution des observations (qui seront ensuite rapportées au DEA) et une brève analyse de la gestion des paddocks.
Séance n°3 (2h au printemps) : Présentation des zones humides en Hauts de France
Objectif : Prendre connaissance des enjeux des zones humides et en particulier en Hauts de France
Déroulé : En prenant appui sur la mallette pédagogique du PMAZH (documents, vidéos, etc.) et en répondant à un questionnaire, les élèves sont amenés à définir les zones humides et à réfléchir à leurs enjeux écologiques et agricoles (en salle).
Séance n°4 (2h30 à 3h au printemps) : Observation du pâturage du troupeau Nantais sur le marais
Objectif : Comprendre l’intérêt du pâturage du marais pour l’exploitation, aborder les notions de disponibilité de la ressource, observer certaines espèces spécifiques aux zones humides.
Déroulé :
- Interventions de Matthieu Franquin (Cen Hauts de France) et Hugo Puech (DEA du Paraclet) dans les parcelles de marais du lycée, en présence du troupeau de vaches Nantaises.
- Rédaction d’un article par les élèves pour la newsletter du lycée (cf. valorisation).
Résultats
Bilan globalement positif, à reproduire les années prochaines, reviendra également dessus ponctuellement en Terminale.
Conseils pour ne pas « braquer » les apprenants :
- Y aller progressivement
- Faire des liens avec ce qu’ils font chez eux (notions génériques, observations singulières)
Conseils pour ne pas « braquer » les apprenants :
- Y aller progressivement
- Faire des liens avec ce qu’ils font chez eux (notions génériques, observations singulières)
Autre valorisation
Calendrier
2023-2024
Perspective
- Ajouter un volet ‘identification des espèces’ lors du diagnostic prairial dans la parcelle du verger
- Réflexion sur la saison préférentielle d’usage des paddocks
- Entrée technico-économique avec calculs des marges brutes
- Engagement de classes dans le Concours des jeunes jurés des pratiques agroécologiques
Partenariats techniques/financiers
PMAZH (AERMC, IDELE, CEN Hauts de France, CA NPC, Scopela, PNR des Ardennes, IA Campus de Florac,...)
Fichier : deroule_pedagogique_patur039ajust.pdf
Télécharger
Fichier : Guide_terrain_vegetations_naturelles_PASSTEC.pdf
Télécharger
Fichier : paturajuste2024_guidepedagogiquelycees_pro.pdf
Télécharger
Vers un plan de gestion des espaces naturels et productifs de l'établissement (Dardilly - Rhône)
Nom de la structure
EPL Lyon-Dardilly-Ecully
Téléphone
04.78.66.64.29
Contact (courriel)
xavier.bunker@educagri.fr
Contact2 (courriel)
pierre.delhommeau@educagri.fr
Contact3 (courriel)
laurent.bariot@educagri.fr
Code postal
69570
Ville
Dardilly
Département
Rhône
Type d'initiative
- économie d'eau
- milieu naturel
Contexte
L'EPL de Lyon-Dardilly dispose de 20 hectares de terrain, diversifié, riche en zones humides naturelles, en limite de territoire protégé par un zonage intercommunal. Il comporte une multiplicité de sites favorables à des études pluri-disciplinaires sur le thème de l'eau, notamment un étang qui récupère les eaux de pluie des toitures de serre, utilisées pour l'arrosage du terrain de sport ou de la pépinière.
Les productions de l'exploitation (pépinière, maraîchage, horticulture) sont dépendantes de l'eau pour l'arrosage, avec une forte motivation pour évoluer dans les pratiques : utilisation d'alternatives aux pesticides, parcelles de maraîchage biologique,...
Les nouveaux bâtiments du lycée sont équipés de toitures végétalisées ou de collecteur d'eau pluviale.
Un bassin de décantation des eaux d'autoroute est présent sur le site de l'exploitation (pollution de l'eau et des sédiments par le trafic routier)...
Les productions de l'exploitation (pépinière, maraîchage, horticulture) sont dépendantes de l'eau pour l'arrosage, avec une forte motivation pour évoluer dans les pratiques : utilisation d'alternatives aux pesticides, parcelles de maraîchage biologique,...
Les nouveaux bâtiments du lycée sont équipés de toitures végétalisées ou de collecteur d'eau pluviale.
Un bassin de décantation des eaux d'autoroute est présent sur le site de l'exploitation (pollution de l'eau et des sédiments par le trafic routier)...
Objectif
Mettre en place un plan de gestion durable de la ressource en eau sur le site
Description de l'action
. schémas de circulation d'eau (par le bureau d'étude EPT'EAU et par l'IRSTEA)
. plantes résistantes à la sécheresse et aux situations de stress hydrique
. procédés innovants de paillages du sol
. techniques alternatives au désherbage chimique en espaces verts
en partenariat avec le syndicat du Vallon de Serres et Planches, des communes de Dardilly, Ecully et Charbonnières :
. suivi des zones humides de l'exploitation et de leur réhabilitation,
. suivi des batraciens
. collecte d'eau pluviale des serres de l'exploitation vers l'étang et utilisation pour l'arrosage
. réalisation d'un terrain de sport très économe en eau
- Phase diagnostics et études (2008/2009) :
. schémas de circulation d'eau (par le bureau d'étude EPT'EAU et par l'IRSTEA)
- Phase expérimentation (2009) :
. plantes résistantes à la sécheresse et aux situations de stress hydrique
. procédés innovants de paillages du sol
. techniques alternatives au désherbage chimique en espaces verts
en partenariat avec le syndicat du Vallon de Serres et Planches, des communes de Dardilly, Ecully et Charbonnières :
. suivi des zones humides de l'exploitation et de leur réhabilitation,
. suivi des batraciens
- Phase travaux et réalisations concrètes (depuis 2009) :
. collecte d'eau pluviale des serres de l'exploitation vers l'étang et utilisation pour l'arrosage
. réalisation d'un terrain de sport très économe en eau
Résultats
Nous évaluons nos méthodes de travail et nos orientations techniques à l'aide d'outils d'évaluation : lycée écoresponsable, bilan planète (CO2), bilan carbone (ACV), bilan biodiversité (IBEA),...
Les projets d'établissement et d'exploitation évoquent clairement la nécessité d'obtention de résultats vers une gestion durable de la ressource en eau...
Les projets d'établissement et d'exploitation évoquent clairement la nécessité d'obtention de résultats vers une gestion durable de la ressource en eau...
Utilisation pédagogique
Le plan de gestion des espaces naturels et productifs de l'établissement est un excellent support des activités pédagogiques : toutes les classes de l'EPL (formation initiale et continue) sont mobilisées pour des actions concrètes sur l'exploitation, sous forme de PUS, MIL, PIC, TP, TD ou temps pluridisciplinaires.
Autre valorisation
Sur l'EPL :
- Semaine de réduction des déchets (novembre 2008)
- organisation de visites et d'expositions
- Semaine du développement durable (avril 2009)
- Semaine de l'eau (juin 2009)
- Accueil de publics scolaires en visite sur le thème de l'eau
- Accueil de visiteurs sur l'exploitation
Perspective
- amélioration de la station de pompage (avec crépine auto-nettoyante) sur l'étang, et du réseau enterré, dysconnecteur eau de l'étang/eau du réseau eau potable
- curage de l'étang et retraitement des boues
- cuve de stockage et de traitement des eaux de pluies récupérées sur les serres et des eaux usées issues de la sub-irrigation
- rénovation du système d'aspersion dans certaines serres et pose d'un système goutte-à-goutte sur les plateformes extérieures
- obtention du label "écojardin" et actions de démonstrations vers les professionnels
Partenariats techniques/financiers
- Grand Lyon
- villes de Lyon, de Dardilly et d'Ecully
- DDT, DRAAF-SRFD
- Chambre d'Agriculture du Rhône
- Conseil Régional Rhône-Alpes
- réseau des CFPPA et des exploitations agricoles des EPL Rhône-Alpes, CRIPT Rhône-Alpes
- SIVU
- IRSTEA
- ONEMA
- CORA
- Groupe Echos-paysage
- Plante et cité
- bureau d'études EPT'EAU
- association RATHO et Station d'Expérimentation et d'Information Rhône-Alpes Légumes (SERAIL)
- dispositif "demain en main", environnement et développement durable
- dispositif environnement et éco-responsabilité
- Action "coup de pouce" Crédit mutuel
Fichier : fichierinitiative1_poster_Lyon_gestion_eau.pdf
Télécharger
Lien vers vidéo de présentation (1)
http://www.dailymotion.com/video/xvmqa5_vers-une-gestion-durable-de-l-eau-sur-l-etablissement-epl-lyon_school
Vidéo de présentation (1)
Vulnérabilité des exploitations agricoles aux inondations : modélisation (Nîmes - Gard)
Nom de la structure
EPLFPA de Nîmes-Rodilhan
Téléphone
04 66 20 67 67
Contact (courriel)
pauline.bremond@irstea.fr
Site Web
http://www.epl.nimes.educagri.fr
Code postal
30230
Ville
Rodilhan
Département
Gard
Type d'initiative
- risques
Contexte
Le volet de gestion des inondations du Plan Rhône prévoit un programme de réduction de la vulnérabilité des exploitations agricoles en zone inondable. Une liste de mesures devraient être appliquées sur la zone aval du Rhône. L'étude vise à développer une méthodologie pour l'évaluation économique de ce type de programme par analyse coût bénéfice.
3000 exploitations agricoles sont potentiellement concernées par le risque d'inondation. La réduction de la vulnérabilité des exploitations agricoles permet de diminuer les dommages subis sans modifier l'aléa.
Le volet de gestion des inondations du Plan Rhône prévoit un programme de réduction de la vulnérabilité des exploitations agricoles en zone inondable. Une liste de mesures devraient être appliquées sur la zone aval du Rhône. L'étude vise à développer une méthodologie pour l'évaluation économique de ce type de programme par analyse coût bénéfice.
3000 exploitations agricoles sont potentiellement concernées par le risque d'inondation. La réduction de la vulnérabilité des exploitations agricoles permet de diminuer les dommages subis sans modifier l'aléa.
Description de l'action
Afin d'évaluer les effets des inondations sur les exploitations agricoles en prenant en compte les dimensions spatiales (répartition des parcelles, du matériel, des stocks), organisationnelles (organisation des tâches de production et de remise en état suite à l'inondation sur l'exploitation) et temporelles (effets à court, moyen et long termes), un modèle conceptuel en UML (Unified Modelling Language) est développé.
Afin d'évaluer les effets des inondations sur les exploitations agricoles en prenant en compte les dimensions spatiales (répartition des parcelles, du matériel, des stocks), organisationnelles (organisation des tâches de production et de remise en état suite à l'inondation sur l'exploitation) et temporelles (effets à court, moyen et long termes), un modèle conceptuel en UML (Unified Modelling Language) est développé.
Perspective
Après avoir déterminé une typologie des exploitations, les effets de différents scénarios d'inondation sont comparés avec et sans la mise en place des mesures de réduction de la vulnérabilité. L'efficience des mesures devra permettre de comparer le coût de mise en place aux bénéfices mesurés en termes de dommages évités.
Après avoir déterminé une typologie des exploitations, les effets de différents scénarios d'inondation sont comparés avec et sans la mise en place des mesures de réduction de la vulnérabilité. L'efficience des mesures devra permettre de comparer le coût de mise en place aux bénéfices mesurés en termes de dommages évités.
Fichier : fichierinitiative1_Inondations_modelisation_Nimes.pdf
Télécharger
Zones humides et santé humaine (Airion - Oise)
Nom de la structure
EPLEFPA de l'Oise à Airion
Téléphone
03 44 50 84 40
Contact (courriel)
angelique.prins@educagri.fr
Site Web
https://www.lyceeagricoledeloise.fr/
Code postal
60600
Ville
Airion
Département
Oise
Type d'initiative
- animation territoire/classe d'eau
- milieu naturel
Contexte
L’équipe pédagogique de la classe de première Bac professionnel Gestion des Milieux Naturels et de la Faune a décidé pour cette promotion de dédier la Semaine "Santé et développement durable" à une initiation à l’écologie de la santé pour diversifier les thématiques abordées et répondre à des interrogations des élèves.
Le lycée a développé de multiples partenariats en lien avec les milieux naturels et les élèves sont donc régulièrement en chantier dans des zones humides. En début de chantier, les intervenants rappellent régulièrement les consignes de sécurité liées à la manipulation du matériel et parfois rappellent « rapidement » les risques sanitaires dans ces milieux. En faisant les restitutions de chantier, l’équipe pédagogique s’est rendu compte que les élèves se posaient beaucoup de questions sur ces risques sanitaires qu’ils ne comprenaient pas bien. Parallèlement à cela, revenait souvent dans les discours des gestionnaires le fait que les zones humides avaient été « assainies » parce qu’elles avaient une mauvaise réputation sanitaire tenace au-delà de leurs multiples vertus :réservoirs de biodiversité, auto-épuration des eaux, contribution majeure à la santé publique, atténuation des effets du changement climatique sur le cycle de l’eau, approvisionnement et productions alimentaires, tourisme, loisirs et activités économiques d’accueil, contribution à la lutte contre le réchauffement climatique, aménités paysagères, contributrices au bien-être quotidien.
L’occasion pour l’équipe de s’emparer de cette problématique et d’essayer de l’explorer lors d’une Semaine santé, en l'intègrant dans le concept du "One Health" (Une seule santé)
> Quels problèmes sanitaires aujourd’hui sont réellement liés aux zones humides ? Comment les zones humides concourent-elles à notre bien-être, à notre santé ? Comment les hommes menacent ils aujourd’hui les zones humides, avec quels risques ? Et aujourd’hui quelles sont les actions à mener pour une meilleure gestion des zones humides sur notre territoire ?
Le lycée a développé de multiples partenariats en lien avec les milieux naturels et les élèves sont donc régulièrement en chantier dans des zones humides. En début de chantier, les intervenants rappellent régulièrement les consignes de sécurité liées à la manipulation du matériel et parfois rappellent « rapidement » les risques sanitaires dans ces milieux. En faisant les restitutions de chantier, l’équipe pédagogique s’est rendu compte que les élèves se posaient beaucoup de questions sur ces risques sanitaires qu’ils ne comprenaient pas bien. Parallèlement à cela, revenait souvent dans les discours des gestionnaires le fait que les zones humides avaient été « assainies » parce qu’elles avaient une mauvaise réputation sanitaire tenace au-delà de leurs multiples vertus :réservoirs de biodiversité, auto-épuration des eaux, contribution majeure à la santé publique, atténuation des effets du changement climatique sur le cycle de l’eau, approvisionnement et productions alimentaires, tourisme, loisirs et activités économiques d’accueil, contribution à la lutte contre le réchauffement climatique, aménités paysagères, contributrices au bien-être quotidien.
L’occasion pour l’équipe de s’emparer de cette problématique et d’essayer de l’explorer lors d’une Semaine santé, en l'intègrant dans le concept du "One Health" (Une seule santé)
> Quels problèmes sanitaires aujourd’hui sont réellement liés aux zones humides ? Comment les zones humides concourent-elles à notre bien-être, à notre santé ? Comment les hommes menacent ils aujourd’hui les zones humides, avec quels risques ? Et aujourd’hui quelles sont les actions à mener pour une meilleure gestion des zones humides sur notre territoire ?
Objectif
Les élèves ont co-construit les objectifs de la Semaine, avec les professionnels, les enseignants d'EPS, l'infirmière :
- Organiser la semaine sous forme de chantiers pour participer à la gestion des zones humides et être acteurs. Approfondir les problématiques rencontrées par des travaux d’observation en laboratoire
- Pour une majeure partie de la classe, partager leur passion des zones humides avec d’autres classes (Seconde générale et Seconde nature jardin paysage forêt) pour échanger sur ces thématiques et sensibiliser d’autres élèves aux vertus de ces zones humides
- Explorer une diversité de milieux et rencontrer des acteurs multiples
- Permettre à chacun d’être acteur et de développer un certain nombre de compétences (organisation du travail, gestion du matériel, chef d’équipe, prise en charge d’élèves d’autres classes, communication)
- Apporter des savoirs au fil de l’eau en fonction des besoins ; ré-investir des apprentissages sur les gestes et postures en chantier
- Ré-interroger l’atteinte des objectifs initiaux lors de la restitution finale
- Organiser la semaine sous forme de chantiers pour participer à la gestion des zones humides et être acteurs. Approfondir les problématiques rencontrées par des travaux d’observation en laboratoire
- Pour une majeure partie de la classe, partager leur passion des zones humides avec d’autres classes (Seconde générale et Seconde nature jardin paysage forêt) pour échanger sur ces thématiques et sensibiliser d’autres élèves aux vertus de ces zones humides
- Explorer une diversité de milieux et rencontrer des acteurs multiples
- Permettre à chacun d’être acteur et de développer un certain nombre de compétences (organisation du travail, gestion du matériel, chef d’équipe, prise en charge d’élèves d’autres classes, communication)
- Apporter des savoirs au fil de l’eau en fonction des besoins ; ré-investir des apprentissages sur les gestes et postures en chantier
- Ré-interroger l’atteinte des objectifs initiaux lors de la restitution finale
Description de l'action
lundi :
Matin : Entretien de cressonnières à Bazicourt
Après midi : TP biologie sur les parasites des cressonnières et recherche documentaire
Le Syndicat Mixte Oise Aronde est un partenaire avec lequel les équipes des classes professionnelles travaillent très régulièrement : entretien de rivières, restauration de mares, de zones humides et interventions sur les marais de Sacy (entretien des clôtures pour les buffles, protocoles de gestion d’Espèces Exotiques Envahissantes) et entretien d’anciennes cressonnières pour préserver le patrimoine agricole local. Les cressonnières constituent un support pédagogique privilégié pour l’aspect veille sanitaire particulièrement adapté au thème de la semaine. Elles symbolisent également la multifonctionnalité des zones humides aujourd’hui et l’évolution de leurs usages. Elles témoignent aussi de la pénibilité du travail du cressonnier : une des raisons du déclin de cette activité.
mardi :
Chantier Sacy avec le CEN Hauts de France : Réouverture de la prairie humide de Villers Saint Sepulcre (suite à l’abandon de l’élevage)
L’objectif de ce chantier était de mettre en évidence l’une des menaces qui pèse sur les zones humides en particulier les prairies humides : la fermeture de milieu par suite de l’abandon de l’élevage. Il s’agissait donc de couper les ligneux qui envahissent la pâture à haute valeur patrimoniale et de les broyer. Un chantier sur zone totalement inondée illustrant bien l’intérêt des zones humides dans la gestion de l’eau et la protection des zones urbaines environnantes …
mercredi :
Chantier de restauration de mares forestières en forêt de Compiègne
Les élèves sont intervenus pour ré-ouvrir deux mares en forêt de Compiègne avec Madame Frangeul de l’ONF. L’occasion de faire le point sur l’importance des zones humides en forêt et de l’impact de la sylviculture sur ces zones. Enfin, l’intérêt des zones humides vis-à-vis du changement climatique a été mis en évidence (le changement climatique impacte très fortement les peuplements de chênes dans cette forêt). L’intérêt pédagogique était également que les premières encadrent en sécurité les élèves de seconde générale.
jeudi :
Chantier carrières Lafarge (avec les secondes NJPF) : lutte contre les Espèces exotiques envahissantes (EEE) dans les zones humides (ici, le buddleia)
vendredi :
Matin : Entretien de haies et fascines sur le marais de Sacy (chantier participatif), dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides (JMZH)
Après midi : Travaux de groupes et restitution
La problématique de l’érosion des sols est un phénomène majeur sur le territoire des marais de Sacy, reconnus à l’échelle internationale pour leur intérêt ornithologique. Un partenariat a été signé entre le syndicat mixte Oise Aronde (SMOA), la commune de Sacy et le lycée d’Airion pour que les élèves entretiennent les infrastructures anti-érosives mises en place. Une opportunité pour que les élèves puissent découvrir le marais, ses richesses mais également les différentes menaces qui pèsent sur lui aujourd’hui et les aménagements réalisés pour contrer ces phénomènes.
Matin : Entretien de cressonnières à Bazicourt
Après midi : TP biologie sur les parasites des cressonnières et recherche documentaire
Le Syndicat Mixte Oise Aronde est un partenaire avec lequel les équipes des classes professionnelles travaillent très régulièrement : entretien de rivières, restauration de mares, de zones humides et interventions sur les marais de Sacy (entretien des clôtures pour les buffles, protocoles de gestion d’Espèces Exotiques Envahissantes) et entretien d’anciennes cressonnières pour préserver le patrimoine agricole local. Les cressonnières constituent un support pédagogique privilégié pour l’aspect veille sanitaire particulièrement adapté au thème de la semaine. Elles symbolisent également la multifonctionnalité des zones humides aujourd’hui et l’évolution de leurs usages. Elles témoignent aussi de la pénibilité du travail du cressonnier : une des raisons du déclin de cette activité.
mardi :
Chantier Sacy avec le CEN Hauts de France : Réouverture de la prairie humide de Villers Saint Sepulcre (suite à l’abandon de l’élevage)
L’objectif de ce chantier était de mettre en évidence l’une des menaces qui pèse sur les zones humides en particulier les prairies humides : la fermeture de milieu par suite de l’abandon de l’élevage. Il s’agissait donc de couper les ligneux qui envahissent la pâture à haute valeur patrimoniale et de les broyer. Un chantier sur zone totalement inondée illustrant bien l’intérêt des zones humides dans la gestion de l’eau et la protection des zones urbaines environnantes …
mercredi :
Chantier de restauration de mares forestières en forêt de Compiègne
Les élèves sont intervenus pour ré-ouvrir deux mares en forêt de Compiègne avec Madame Frangeul de l’ONF. L’occasion de faire le point sur l’importance des zones humides en forêt et de l’impact de la sylviculture sur ces zones. Enfin, l’intérêt des zones humides vis-à-vis du changement climatique a été mis en évidence (le changement climatique impacte très fortement les peuplements de chênes dans cette forêt). L’intérêt pédagogique était également que les premières encadrent en sécurité les élèves de seconde générale.
jeudi :
Chantier carrières Lafarge (avec les secondes NJPF) : lutte contre les Espèces exotiques envahissantes (EEE) dans les zones humides (ici, le buddleia)
vendredi :
Matin : Entretien de haies et fascines sur le marais de Sacy (chantier participatif), dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides (JMZH)
Après midi : Travaux de groupes et restitution
La problématique de l’érosion des sols est un phénomène majeur sur le territoire des marais de Sacy, reconnus à l’échelle internationale pour leur intérêt ornithologique. Un partenariat a été signé entre le syndicat mixte Oise Aronde (SMOA), la commune de Sacy et le lycée d’Airion pour que les élèves entretiennent les infrastructures anti-érosives mises en place. Une opportunité pour que les élèves puissent découvrir le marais, ses richesses mais également les différentes menaces qui pèsent sur lui aujourd’hui et les aménagements réalisés pour contrer ces phénomènes.
Utilisation pédagogique
Les premières bac pro GMNF ont impliqué et pris en charge sur des activités de terrain des élèves d'autres calsse (Seconde générale et Seconde Nature jardin paysage forêt)
Autre valorisation
Participation au festival des Marais de Sacy le 26 avril 2025
Calendrier
du 3 au 7 février 2025
Partenariats techniques/financiers
Syndicat mixte Oise Aronde, CEN Hauts de France, ONF, Lafarge, commune de Sacy